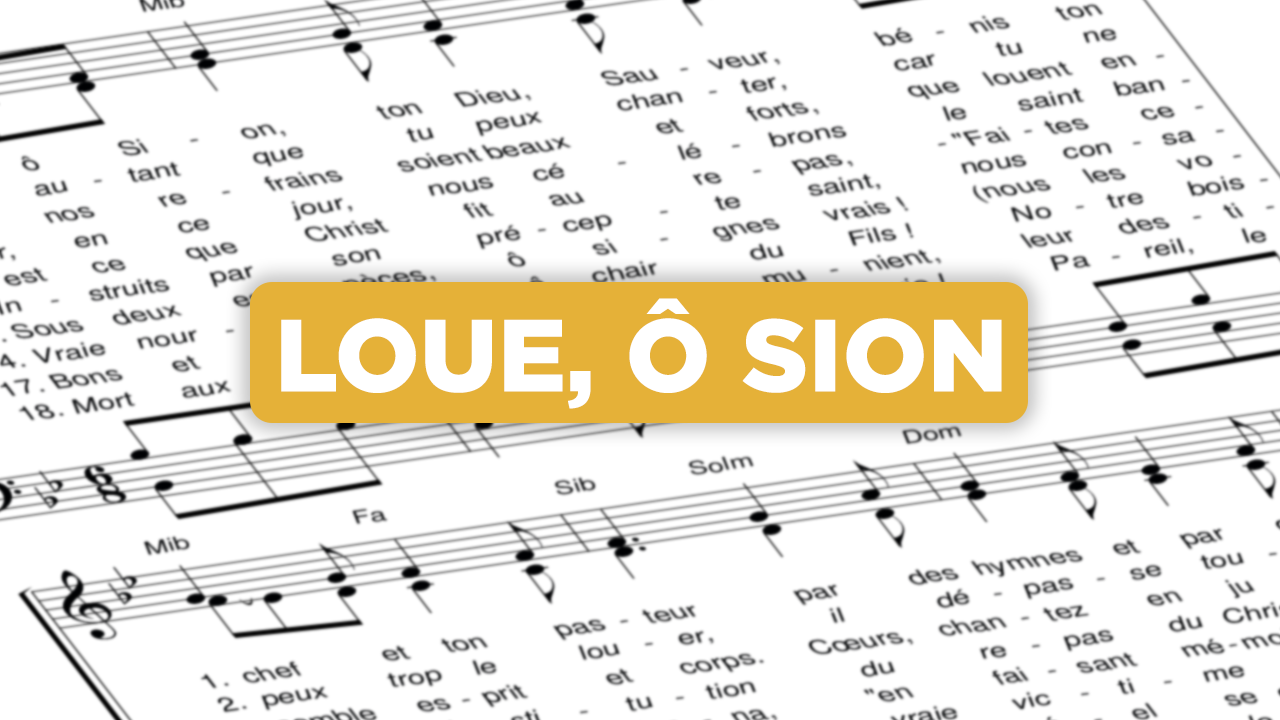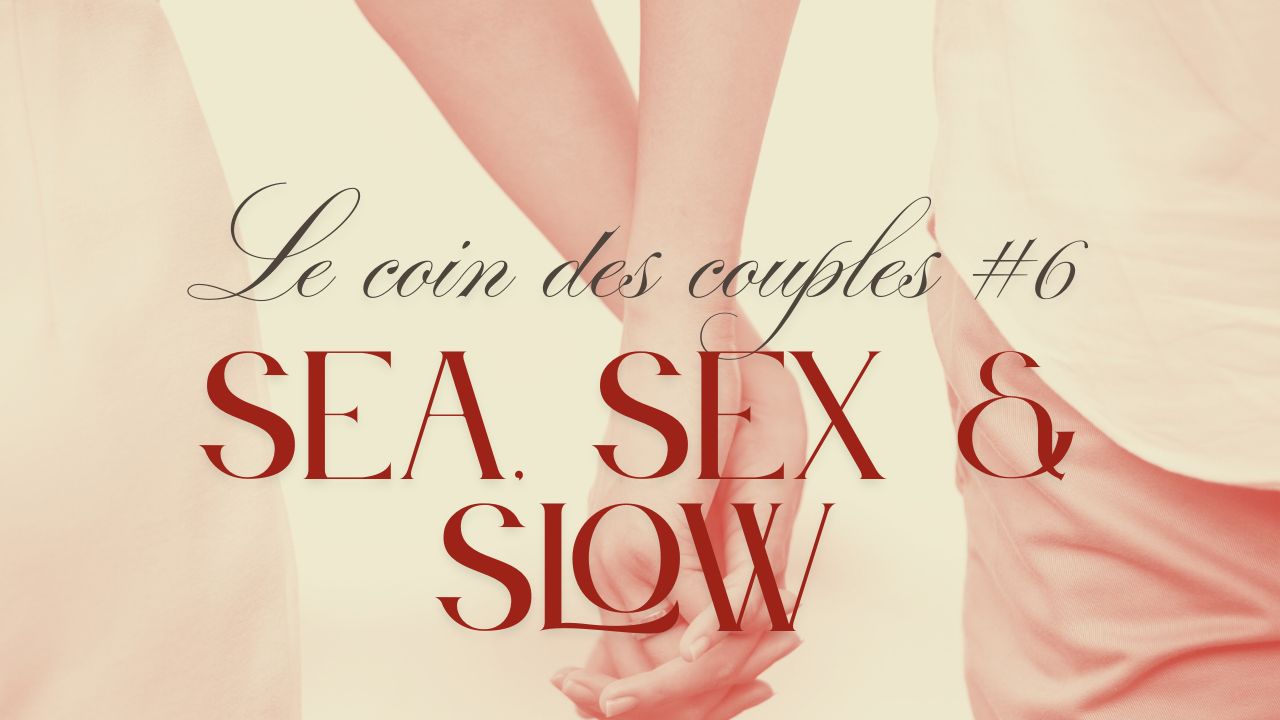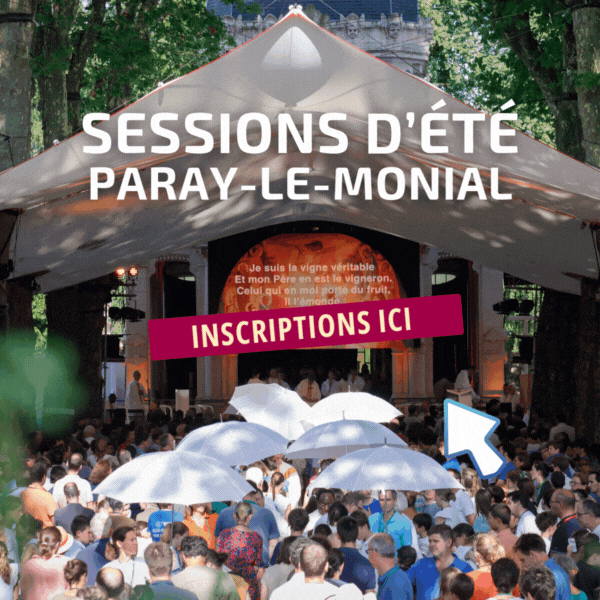Toute relation humaine semble vulnérable à la tentation d’utiliser l’autre pour son propre bien. Pour nous ré-ouvrir le chemin de l’amour authentique, le Père Pascal Ide a écrit Aimer l’autre sans l’utiliser, un livre qui est aussi un parcours de conversion de nos relations. Explications du Père Ide.
 Quelle est l’intuition centrale du livre ?
Quelle est l’intuition centrale du livre ?
Nous nous comportons à l’égard de l’autre de deux manières et seulement de deux manières : soit nous l’aimons, soit nous l’utilisons. Et, dans le second cas, nous avons souvent l’air d’être tourné vers autrui, mais, en réalité, au final, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Par exemple, je peux écouter quelqu’un en donnant l’impression que je m’intéresse à lui ; mais, au fond, je soutire des informations. Or, utiliser l’autre pour soi-même détruit le lien et réduit l’autre à un moyen. Un ami vous invite à passer dans sa maison de campagne. À votre arrivée, vous le trouvez en train de repeindre sa cuisine et vous demander avec insistance de l’aider. Comment vous sentez-vous ? Bien évidemment, nous n’agissons jamais ainsi !
Sur quel constat vous êtes-vous appuyé pour vous lancer dans l’écriture de ce livre ?
J’ai découvert cette distinction il y a 35 ans dans le livre d’un certain Karol Wojtyla, Amour et responsabilité. Il y introduit une distinction très précieuse entre deux normes : personnaliste et utilitariste. Elle correspond aux deux attitudes : aimer ou utiliser. Traiter l’autre comme une personne, c’est au fond la reconnaître dans sa valeur et l’aimer. Et le futur saint Jean-Paul II explique pourquoi, dans l’autre sens, l’utilitarisme est déshumanisant : nous sommes des personnes, donc des êtres libres. Or, un être libre choisit sa finalité, ce qui n’est pas le cas d’une chose. Je peux utiliser une tasse, mais pas une personne.
Mais ce n’est que récemment, en dialoguant avec les responsables d’Amour & Vérité que j’ai compris combien ces deux normes étaient un critère très simple pour éclairer toutes les relations au sein du couple et de la famille. Par exemple, le mari ou la femme qui est très gentil et très serviable, pour aboutir à ses fins (avoir un moment d’intimité, etc.), agit de manière utilitariste. Et l’autre, qui le ressent sans pouvoir forcément le nommer, le vit comme une violence.
Enfin, en élargissant ce constat, je me suis rendu compte que ces deux normes peuvent s’étendre à toutes nos relations : certes, aux autres, mais aussi à Dieu et à moi-même.
Peut-on réellement se passer de la norme utilitariste, c’est-à-dire de l’amour intéressé ?
Non seulement, on le peut, mais on le doit ! Cela suppose de cesser d’agir automatiquement. Combien de couples sont guidés par un secret utilitarisme réciproque : je conduis l’aînée chez l’orthophoniste et (si !) tu fais les comptes. Il en est de même dans le choix des amis : c’est l’amitié du manuel et de l’intellectuel, de l’optimiste et du pessimiste, etc.
Cela requiert aussi d’analyser ses intentions. « Quand vous avez dit à votre petit-fils de ne pas se resservir, au fond, quelle était votre motivation ? » La grand-mère à qui son père spirituel posait la question a répondu spontanément : « Parce que c’est mal élevé ! » Mais, soudain, elle s’est ressaisie, a rougi et a continué humblement, c’est-à-dire en vérité : « En fait, je viens de réaliser que c’est aussi parce que je n’aimerais pas que, s’il y avait des invités, ils voient que mes petits-enfants font mauvaise impression. Au fond, j’aime bien que l’on en dise du bien, et que l’on pense du bien de moi. Donc, au fond, c’est pour moi. Merci de m’avoir aidée à en prendre conscience ».
Cela veut-il dire que l’on ne peut plus rien demander à l’autre ; que, si je trouve du plaisir à rencontrer mes amis, je suis utilitariste ?
Bien sûr que non ! Mais celui qui agit selon la norme personnaliste, recevra cette joie par surcroît ; il ne rencontre pas son ami d’abord pour y trouver son plaisir, mais pour l’écouter, prendre des nouvelles, bref, en se centrant sur le bien de son ami.
Bien évidemment aussi, les amis, les couples, les membres d’une communauté, etc., se rendent service. Mais d’abord, cela suppose que nous demandions de l’aide et non pas que, secrètement, nous l’exigions, donc que nous soyons capable d’entendre que l’autre dise « non » et que nous ne fassions pas subtilement pression (« Je t’ai demandé parce que t’es le meilleur ! »). Ensuite, cela suppose de rendre la pareille : celui qui répond volontiers aux invitations invite-t-il lui-même ? Cela requiert enfin et surtout que nos relations conjugales, amicales, fraternelles, soient d’abord, et la majorité du temps, placées sous le signe de la gratuité.
Quelle différence faites-vous entre Aimer l’autre ou l’utiliser et votre livre sur les manipulateurs ?
Le verbe « utiliser » est, en effet, trompeur. Le manipulateur ou, pour être plus précis, la personnalité narcissique, ignore les relations désintéressées ; même si elle ne l’avoue ni ne se l’avoue, elle est toujours utilitariste. Mais avoir une personnalité narcissique et avoir des traits narcissiques n’est pas la même chose. Tous, malheureusement, à un moment ou à un autre, nous instrumentalisons l’autre. Par exemple, comme prêtre, je suis parfois tenté d’employer mon temps de prière pour préparer ma prochaine homélie.
Nous n’arriverons pas d’emblée à purifier nos intentions. Ici s’applique la loi de gradualité chère à nos trois derniers papes. À quelqu’un qui va habituellement à des soirées seulement pour avoir des contacts ou se distraire, je conseillerai, pour commencer, de décider de rencontrer une personne pendant un quart d’heure en s’intéressant réellement à elle.
Quel bien pouvons-nous tirer de votre livre pour notre vie quotidienne ?
Me demander si j’agis seulement pour moi ou pour l’autre transforme les relations et rend heureux. Utiliser l’autre procure un plaisir momentané (et aliénant), mais me centrer sur l’autre, et donc l’aimer, fait entrer dans une joie durable.
La double norme est aussi un moyen très simple pour me convertir. Elle appelle seulement à me demander avant chaque relation à autrui quelle est mon intention : « Quand je demande à mon fils de se lever de table pour chercher le sel, est-ce pour son bien ou pour moi ? »
En fait, choisir de vivre selon la norme personnaliste, c’est tout bonnement choisir la sainteté. La petite Thérèse formulait son amour de Dieu par une expression parlante : « Faire plaisir au bon Dieu ». Si elle est montée si vite et si haut dans l’union à Dieu, c’est parce qu’elle s’est de plus en plus décentrée d’elle-même pour ne plus faire que la volonté du Père (cf. Jn 6,34).
Extrait du livre
Chapitre 2 – Aimer l’autre
« Je pense que je suis souvent utilitariste, sourit Armand. En tout cas, il y a un cas où je ne le suis vraiment pas : c’est lorsque, dans mon entreprise, je vais aux toilettes, je ferme la porte, et que je nettoie à fond la cuvette pour le suivant ! Je ne me vois pas faire de la pub. Là, personne ne le sait ! »
Ève et Richard sont mariés depuis une quinzaine d’années. Comme chaque été, Richard part pendant une semaine faire une virée moto avec quelques amis. « Chic, songe Ève, je vais ainsi pouvoir nettoyer à fond son bureau sans le déranger. » Elle y passe plusieurs heures tant il est sale et finit en plaçant quelques fleurs dans un vase sur le bureau. Quand il rentre, ravi de sa balade, Richard note la présence du bouquet, remercie son épouse de la délicate attention, mais ne voit pas que le bureau est propre. Ève ne relève pas. Le soir, quand elle se couche, elle est heureuse que son mari ait vu son geste et ait exprimé sa gratitude, ce qu’il ne faisait pas au début de leur mariage. Elle a nettoyé le bureau d’abord pour que son mari s’y trouve bien, même s’il ne sait pas pourquoi ; elle l’a aussi fait pour entretenir la maison et parce qu’elle aime la propreté.
Comme chaque matin, Anne vient prier longuement dans son oratoire. Elle s’agenouille devant le tabernacle (son mari et elle ont obtenu l’autorisation de leur évêque d’avoir la Présence réelle) et alors qu’elle s’apprête à fermer les yeux, elle est attirée par une couleur jaune, sur le côté. Intriguée, elle regarde et que voit-elle ? Deux pâquerettes et un bouton d’or, posés devant la porte du tabernacle. Un sourire très ému monte à ses lèvres, sourire qui affleure à nouveau lorsqu’elle me raconte l’épisode : « C’était très probablement le cadeau d’un de mes petits-fils, 4 ans et demi. Que j’étais touchée par cet acte ! Je lui avais expliqué que Jésus était présent dans le tabernacle. Et il a déposé ce bouquet, juste pour le Bon Dieu, seulement pour Lui. »
Aînée de quatre d’une famille d’Annecy-le-Vieux, la vénérable Anne de Guigné (1911-1922) était souvent désobéissante, orgueilleuse, colérique et jalouse. Utilitariste, elle faisait tourner le monde autour d’elle. Alors qu’elle a 4 ans, son père meurt lors de la Grande Guerre. Sa mère n’est plus capable de supporter les rébellions de sa petite fille : « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » À partir de cet instant, la petite Anne va multiplier les actes pour devenir bonne. C’est ainsi que, lorsqu’une colère la prend face aux frustrations et aux contrariétés, elle devient rouge et serre ses petits poings pour ne pas exploser. Progressivement, ses fréquentes crises s’espacent et elle change en profondeur. Et, lorsqu’une très douloureuse méningite l’atteindra, elle mènera une vie héroïque. Par amour pour sa mère, Anne a donc pris conscience que son attitude la faisait souffrir et a décidé de la consoler en devenant bonne. D’un mot, elle a vécu ce que nous appellerons une conversion personnaliste.
Être aimé par l’autre
Ces quelques exemples ne vous ont peut-être pas laissé indifférent. Peut-être aussi vous ont-ils suggéré des souvenirs personnels.
Comme au chapitre précédent, je vous propose de vous arrêter un moment après cette lecture. Cet arrêt contrarie le désir d’avancer dans celle-ci. Mais ce que vous perdez en découverte de contenus nouveaux, vous le gagnez en profondeur, c’est-à‑dire en appropriation.
Faites mémoire d’un acte d’amour désintéressé dont vous avez fait l’objet. Il peut être récent ou ancien. L’essentiel est que le souvenir soit concret, précis. Une personne que vous connaissiez ou non s’est arrêtée pour vous rendre service, vous a fait un cadeau, vous a souri, s’est intéressée à vous pour vous, sans aucune arrière-pensée, etc. Là encore, prenez le temps de détailler l’acte. Voyez le visage de la personne, entendez sa voix.
Puis goûtez ce moment et demandez-vous ce que vous ressentez. Prenez le temps d’éprouver la paix, la joie simple, voire débordante, la gratitude qui montent en vous. Pour cela, de nouveau, prenez contact avec votre corps : dans quelle partie de votre organisme (région du cœur, abdomen, etc.) ressentez-vous cette reconnaissance ? Nos sentiments agréables nous font du bien : c’est leur destination !
Derechef, aimer l’autre
Et maintenant, faites l’exercice dans l’autre sens. Rappelez-vous un acte d’amour uniquement tourné vers l’autre que vous avez posé. Ne cherchez pas un acte exceptionnel, héroïque.
L’essentiel est que, dans cet acte, vous vous soyez détaché de vous-même, que vous n’ayez en rien cherché un retour, que vous vous soyez uniquement attaché au bien de l’autre, bref, que la personne de l’autre ait mobilisé votre attention. Ce peut être une simple question (« Ton mal de tête est-il passé ? » « As-tu passé une bonne nuit ? »), un geste (un sourire gratuit adressé à un inconnu, tenir la porte à celui qui nous suit, ranger la vaisselle à l’insu de tous), etc.
Maintenant, savourez ce moment pour lui-même. Avoir posé un acte d’amour, c’est-à‑dire vous être donné, procure toujours une paix et une joie. Celle-ci n’est pas forcément débordante, elle peut demeurer discrète. Du moins se présente-t‑elle souvent comme une dilatation intérieure.
Ce souvenir soulève parfois aussi en vous une fierté. Celle-ci est légitime. De fait, l’être humain est fait pour aimer, plus, il ne s’accomplit qu’en se donnant, ainsi que nous allons le redire.
Enfin, ce don peut éveiller en nous une attente (sera-t‑il reconnu ?), un désir de retour (répondra-t‑il à mon mail ?) qui est l’attente d’un échange, une tristesse mesurée (je regrette qu’aucun voisin ne m’ait rendu mon invitation). Ces sentiments sont eux aussi légitimes : le don est pour la communion. Toutefois, si cette attente se transforme en inquiétude, voire suscite une exigence ou une amertume, alors ces réactions signalent un secret utilitarisme : j’ai donné pour, en définitive, recevoir un retour, donc pour moi.
Quatre marqueurs affectifs
Nous reviendrons sur ce point important. Pour l’instant, résumons les quatre attitudes décrites dans ces deux premiers chapitres (être utilisé par l’autre, utiliser l’autre ; être aimé par l’autre, aimer l’autre) à partir de leurs signatures affectives.
Être utilisé par l’autre attriste toujours et, d’abord, suscite la colère. Utiliser l’autre peut causer un certain plaisir, mais peu durable et mêlé de tristesse. Surtout, chez la personne qui n’a pas anesthésié toute conscience morale, cet utilitarisme engendre la culpabilité et le remords.
En revanche, être aimé de manière désintéressée nous touche au cœur et nous réjouit. Au sommet de cette échelle émotionnelle, aimer l’autre (ce que nous allons appeler agir selon la norme personnaliste) nous fait éprouver une joie profonde, durable et sans mélange.
Les deux attitudes que nous avons brièvement décrites illustrent ce que, à partir du chapitre 5, le reste du livre va appeler norme utilitariste et norme personnaliste. Mais, pour bien les comprendre, sortir d’un simplisme manichéen (je suis 100 % utilitariste ou 100 % personnaliste) et du moralisme culpabilisant, il est nécessaire de montrer sur quelle vision de l’homme elles s’appuient. Ce sera l’objet des deux prochains chapitres.