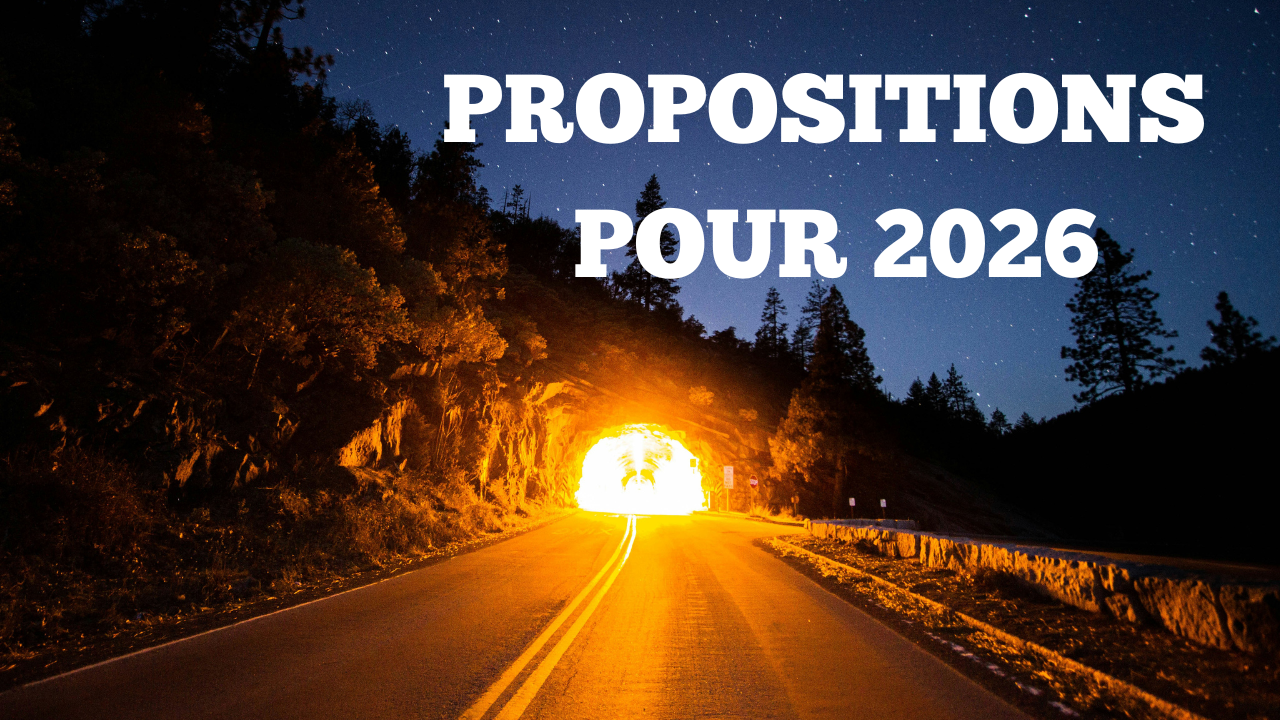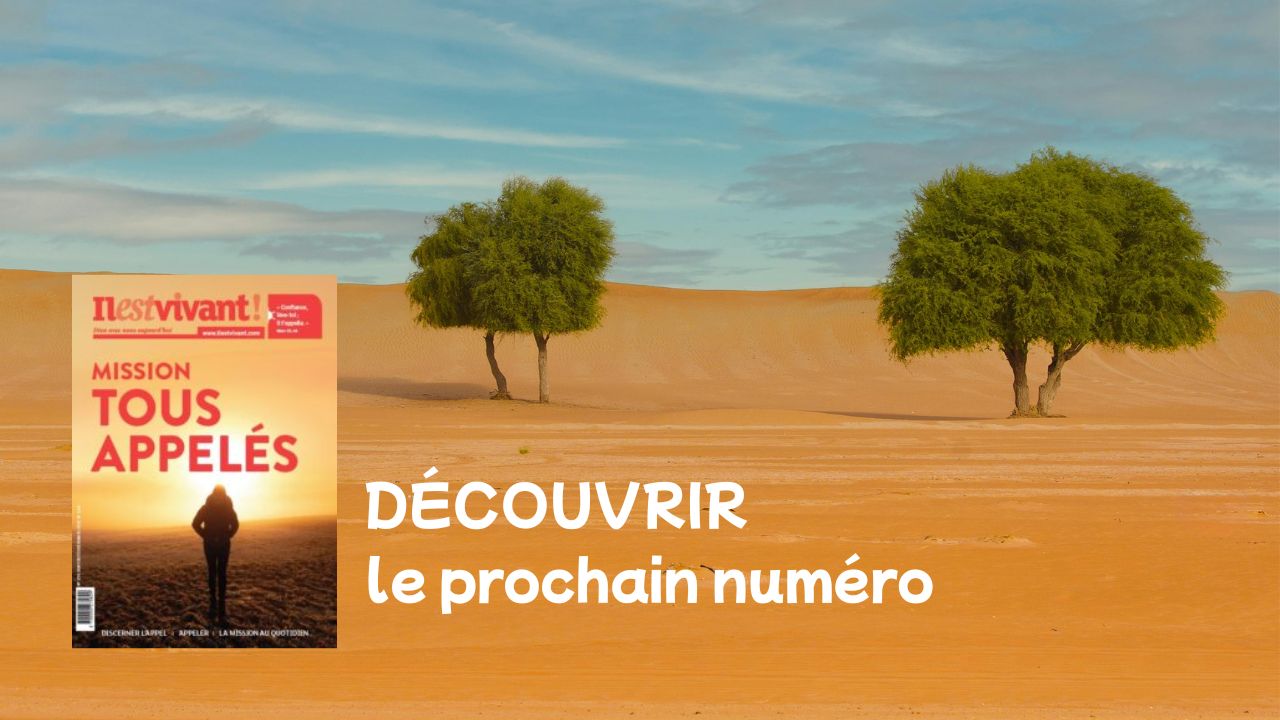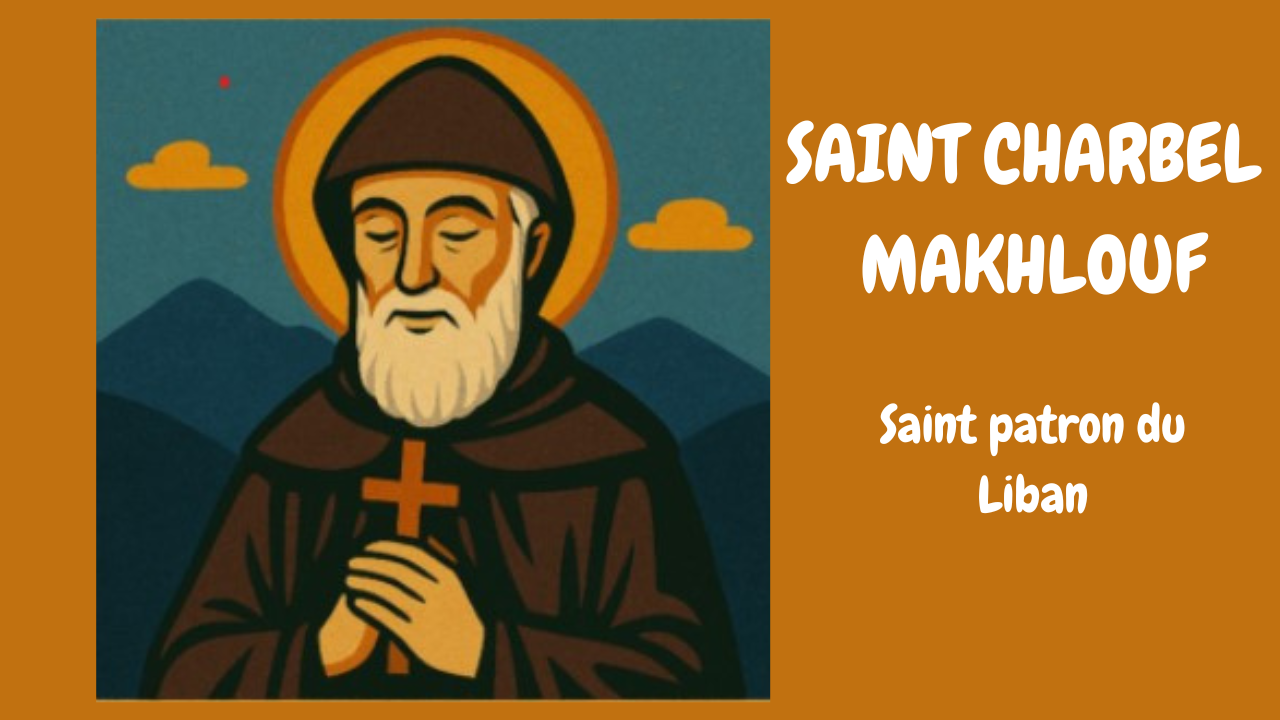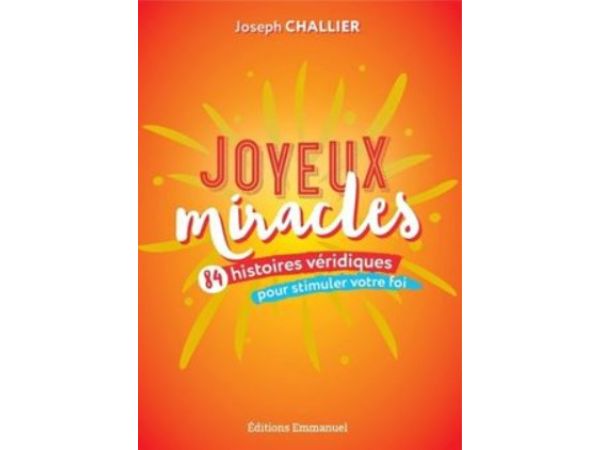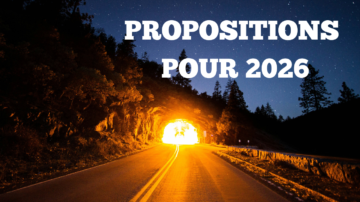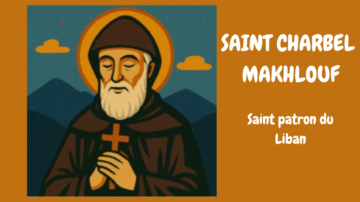Si la liturgie sanctifie le temps, c’est pour mieux nous apprendre à le transcender. Pour nous apprivoiser à la vie avec Dieu, à la vie en Dieu en qui tout ce monde passera.
Par SŒUR MARIE-LAURE, F.M.J.
 À des oreilles attentives se dévoile un mot qui scande la liturgie : aujourd’hui. Quel est cet aujourd’hui qui contracte le temps et, en même temps, le dilate à l’infini ? Comment informe-t-il l’aujourd’hui de ma vie quotidienne ?
À des oreilles attentives se dévoile un mot qui scande la liturgie : aujourd’hui. Quel est cet aujourd’hui qui contracte le temps et, en même temps, le dilate à l’infini ? Comment informe-t-il l’aujourd’hui de ma vie quotidienne ?
Un cycle annuel
Cet aujourd’hui est d’abord celui des mystères du Christ. Celui que le cycle annuel de la liturgie nous donne à entendre chaque fois qu’une fête est célébrée : aujourd’hui le Christ est né, aujourd’hui il est présenté au Temple ; aujourd’hui le Christ est mis en croix, aujourd’hui le Christ est ressuscité, aujourd’hui il est remonté dans la gloire ; aujourd’hui l’Esprit est répandu sur les disciples, etc. Chaque année la répétition de ces mystères rappelle la grande geste du Fils de Dieu fait homme pour notre salut. Elle nous les fait remémorer puisque « les jours de sa chair » (He 5, 7) sont passés, mais, en même temps, elle nous en fait contemporains. C’est aujourd’hui que je m’émerveille devant l’Enfant de la crèche, devenu si petit pour me faire monter jusqu’à sa grandeur. C’est aujourd’hui que je suis mon Sauveur portant sa croix, que je déplore mon péché qui le crucifie encore, et que je sens déjà la joie sourde de la vie plus forte qui jaillit du sommeil du tombeau. C’est aujourd’hui que j’éclate de joie, avec toute la création renouvelée au matin de Pâques, et aujourd’hui que l’Esprit renouvelle en moi ses dons. Ainsi le mystère, chaque année, me dévoile d’autres richesses ; ainsi le cycle liturgique ne m’inscrit pas dans un enfermement dans le passé ou un retour du même qui se révélerait vite mortifère, mais au contraire forme des cercles qui vont s’approfondissant ou s’élevant – peu importe la métaphore – vers une compréhension plus grande et surtout une transformation progressive, un renouvellement de tout mon être. Ainsi la liturgie permet, pour parler comme Paul, de quitter l’homme ancien pour laisser advenir l’homme nouveau (Ep 4, 22-24). Priée au long des jours et plusieurs fois par jour, elle nous fait peu à peu devenir ce qu’elle célèbre, selon le vieil adage repris par les Pères depuis saint Irénée : « Dieu s’est fait homme pour qu’en lui l’homme soit divinisé. »

Un cycle quotidien
Au long des jours et plusieurs fois par jour, disions-nous, car à ce cycle annuel se superpose un cycle quotidien. Depuis les premières générations chrétiennes et suivant en cela la tradition juive, on se tourne vers Dieu à tous les moments charnières du jour : à la tombée du soir et au coucher, lorsque la lumière revient, avant chaque repas… La tradition bénédictine a fixé cette coutume en sept heures, sept offices qui ponctuent et délimitent les temps de travail, d’étude ou de repos, et aident à ramener régulièrement ses pas et son cœur vers le centre du monastère : l’église et Celui qui l’habite. Pour nous, moines citadins, les offices – moins nombreux mais plus développés – gardent le souci de rythmer le temps et de lui donner sens, dans la louange qui fait tout remonter en offrande vers le Créateur, et dans l’intercession qui lui présente nos semblables, nos frères. « Prie au matin, demande notre Livre de Vie, avec tes frères et sœurs, avant d’aller au travail, avec ceux qui vont au travail, redisant : ‘Je devance l’aurore et j’implore, Seigneur, j’espère en ta parole’ (Ps 118,147). Prie au milieu du jour, au milieu du travail, avec ceux qui sont au travail, à la sixième heure, où Jésus offrit sa vie pour toi et pour le salut du monde. Prie le soir avec ceux qui rentrent du travail, au seuil de la nuit, et au commencement des veilles, faisant de tout Eucharistie » (Jérusalem – Livre de Vie, Cerf, 2014, § 20). Le chant des psaumes participe à cette appropriation du temps, en rappelant que tout se vit sous le regard de Dieu et en Dieu : « C’est toi que je prie, Seigneur, au matin tu m’éveilles » (Ps 5,3) ; « Que ma prière vers toi s’élève comme un encens, et mes mains comme l’offrande du soir » (Ps 140,2) ; « En paix je me couche, aussitôt je m’endors ; toi seul, Seigneur, tu m’établis en sûreté » (Ps 4,9).
Un cycle hebdomadaire
Un troisième cycle enfin vient croiser les deux autres : le cycle hebdomadaire attesté dès la Genèse. On sait que l’œuvre créatrice est distribuée, selon son langage symbolique, en six jours couronnés par un septième où « Dieu conclut l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième jour, se reposa après tout l’ouvrage qu’il avait fait » (Gn 2,2). Le cycle de la semaine, codifié par la loi mosaïque, fait de son dernier jour un temps où l’homme, créé à la ressemblance de Dieu, se repose, lui aussi du travail des six jours précédents. « Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier » (Ex 20,8). Il s’agit donc moins d’interdire les travaux que d’en remettre le fruit à Dieu, d’en faire non un jour d’oisiveté, mais de consécration. En Jésus Christ, cette temporalité, comme toute chose, est, non pas abolie, mais « accomplie » (cf. Mt 5, 17), et cet accomplissement retentit encore dans mon existence : en relation avec le triduum pascal – les trois jours saints de la passion du Christ – chaque jeudi prend une coloration eucharistique en commémoration du repas de la Cène ; chaque vendredi a une tonalité plus pénitentielle qui accompagne le chemin vers la croix du Sauveur ; et le samedi peut se vivre dans le silence et le recueillement du grand sabbat qui suivit la mise au tombeau. Mais ici éclate la nouveauté car, au lendemain de ce sabbat, ce n’est pas une semaine ordinaire qui recommence. « Le premier jour de la semaine », comme le notent les quatre évangélistes, est aussi le huitième jour, le jour de la résurrection, le premier de la création nouvelle. Ce jour nouveau de la résurrection brise le cycle comme un coin d’éternité enfoncé dans le temps ; ce huitième jour devient « le jour du Seigneur » (Ap 1,10), notre dimanche. La liturgie de nos Fraternités rappelle et signifie cela par le choix des psaumes, adaptés au caractère particulier de chacun de ces jours, par l’adoration eucharistique, prolongée toute la nuit du jeudi, en souvenir de la prière de Jésus avec ses disciples et de l’agonie de Gethsémani, par le jeûne et la sobriété plus grande des offices du vendredi, par un office de la résurrection chanté au matin du dimanche à la manière de nos frères d’Orient. Le mystère pascal ainsi revécu chaque semaine s’inscrit peu à peu profondément dans la mémoire de l’âme et du corps et aide à apprendre à vivre au quotidien en ressuscités. « Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d’en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu » (Col 3, 1-3).
De même que le premier jour devenu le huitième jour introduit l’éternité dans le temps de la semaine, de même la liturgie fait entrer l’éternité dans la vie quotidienne. Si elle sanctifie le temps – et par là même tout ce qu’il contient : travail et loisirs, peines et joies, intériorité et ouverture à l’autre –, c’est pour mieux nous apprendre à le transcender. Pour nous apprivoiser à la vie avec Dieu, à la vie en Dieu en qui tout ce monde passera – au sens non d’une destruction, mais d’un passage, d’une pâque. Pour nous habituer à ce que sera notre éternité heureuse : une louange joyeuse et incessante à la gloire de Dieu. ¨