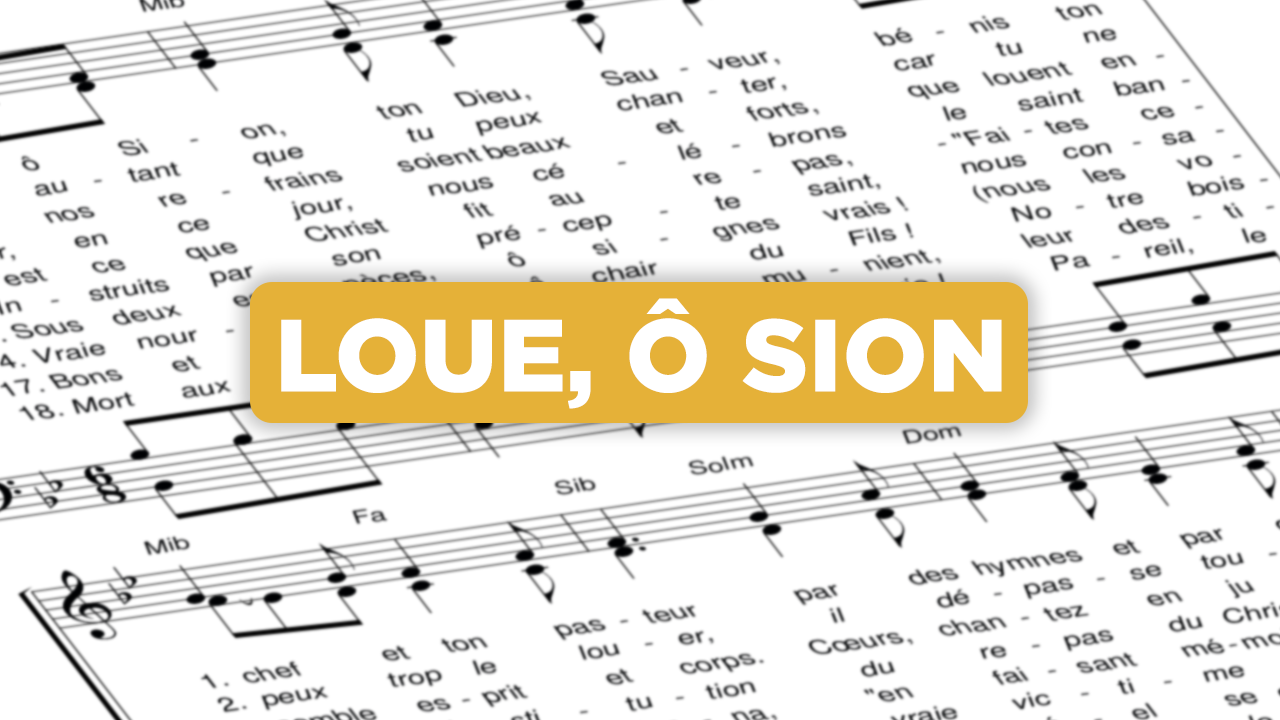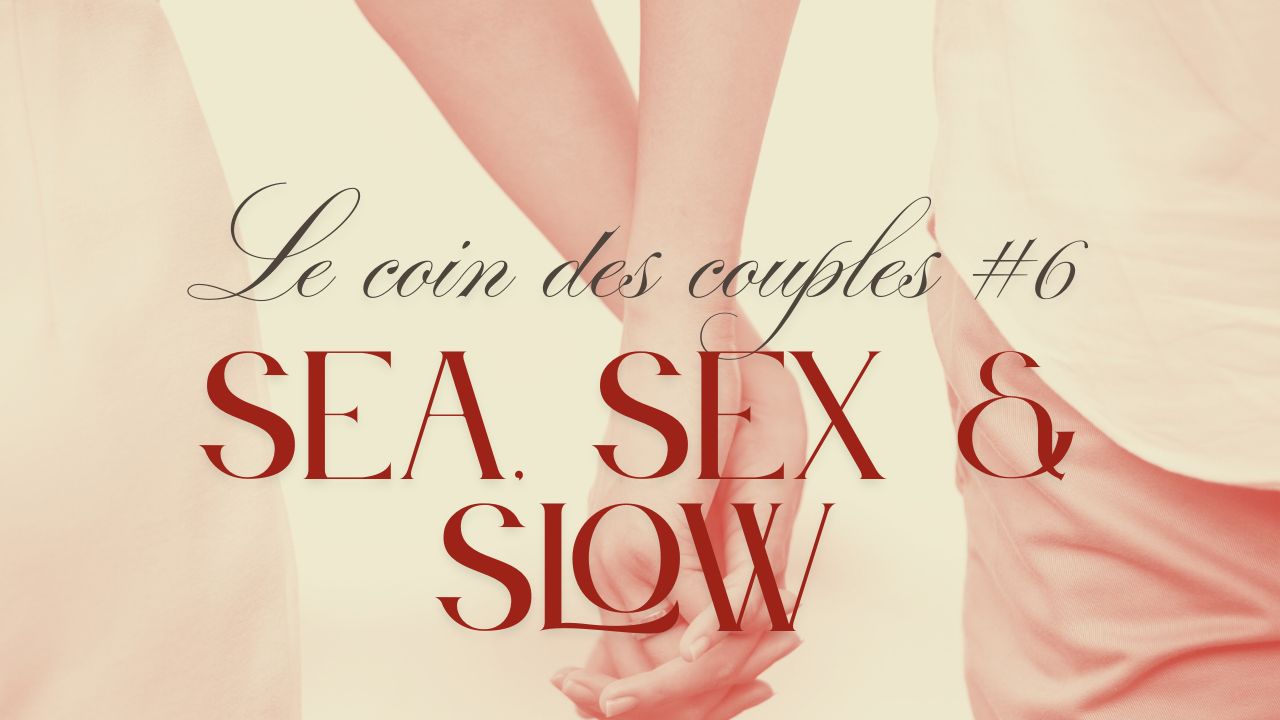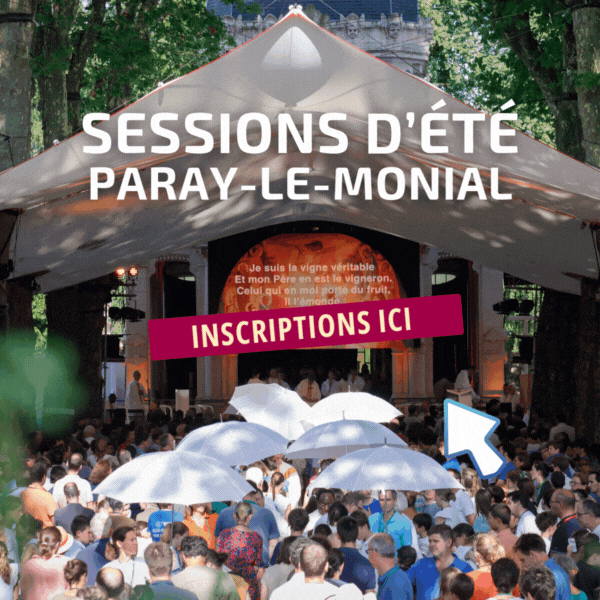Animé d’un zèle missionnaire exemplaire, François de Sales a su renouveler en profondeur l’esprit sacerdotal dans un contexte particulièrement difficile.
Par THOMAS GUEYDIER
Cet article est paru dans la revue Il est vivant! n°363
Maître du clergé en France selon saint Paul VI, saint François de Sales représente, avec le saint curé d’Ars, l’une des figures ecclésiastiques les plus marquantes de l’histoire de l’Église. Animé d’un zèle missionnaire exemplaire, il a su renouveler en profondeur l’esprit sacerdotal dans un contexte particulièrement difficile, d’abord comme prêtre puis comme évêque.
Dans quel contexte saint François de Sales (1567-1622) a-t-il vécu son sacerdoce ? Il naît quelques années seulement après le Concile de Trente. Il s’agit alors de réformer l’Église de Rome à la suite d’une crise sans précédent marquée par les vives interpellations de la Réforme. En cette fin de XVIe siècle, force est de constater que l’annonce de la Bonne Nouvelle se trouve quelque peu brouillée par une présentation rigoriste de l’enfer et du péché. De manière générale, le modèle de chrétienté issu du Moyen Âge s’effondre inexorablement sous les coups de boutoir de l’humanisme renaissant. Quant au siège épiscopal de Genève que saint François de Sales occupera à partir de 1602, il a dû s’exiler à Annecy sous la pression protestante, à une époque où le duché de Savoie se trouve aux prises avec une instabilité politico-religieuse apparemment irréductible.
Quel genre de prêtre et d’évêque fut-il ? La vocation de saint François de Sales n’est pas un long fleuve tranquille. À vingt ans, tandis que mûrit son projet de devenir prêtre, il traverse une profonde crise spirituelle. À Paris, où son père l’a envoyé étudier la philosophie, le jeune François se croit alors prédestiné à la damnation éternelle.
Il lui faudra attendre de longs mois de tourment et d’angoisse pour pouvoir s’exclamer, dans un élan d’abandon total : « Quoi que vous ayez arrêté à mon égard […], je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s’il ne m’est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle. »
Fort de cette expérience libératrice et sans négliger la nécessité d’une sainte crainte de Dieu indispensable à toute vie spirituelle authentique, le prêtre puis l’évêque François de Sales n’aura de cesse de faire découvrir la beauté, la bonté et l’amour divins, avant toute chose. À cette fin, il publie, en 1608, l’un des best-sellers du XVIIe siècle : l’Introduction à la vie dévote puis, en 1616, le Traité de l’Amour de Dieu, pour les âmes déjà avancées sur le chemin de la perfection. Il confie dans la préface de cet ouvrage : « […] J’ai seulement pensé à représenter simplement et naïvement, sans art et encore plus sans fard, l’histoire de la naissance, du progrès, de la décadence, des opérations, propriétés, avantages et excellences de l’amour divin. »
Une telle option théologique et pastorale apparaît clairement dans les avis qu’il donnera aux confesseurs de son diocèse.
Dieu possède « une bonté infinie », leur explique-t-il. Il est « Celui qui ne peut entendre crier la moindre de ses créatures sans lui donner du secours, et qui se rend à la première larme qui sort d’un cœur véritablement contrit ».
De ce point de vue, l’évêque de Genève fait figure de précurseur.
Il procure un précieux antidote au jansénisme à venir et annonce, plus lointainement, l’œuvre de sainte Thérèse de Lisieux, qui se livrera sans scrupule à l’abandon, ce « fruit délicieux de l’amour ».
Comme a-t-il concrètement relevé les défis de la mission en ces temps si troublés ? D’abord, au début de son ministère, saint François de Sales dialogue loyalement avec ceux auprès desquels son évêque l’envoie en mission, à savoir les protestants de la région du Chablais. Empêché de prêcher, il décide de rédiger des feuilles volantes. Ces espèces de tracts feront de lui le saint patron des journalistes. Il y répond point par point aux objections formulées à l’encontre de la foi catholique en se référant à une grande figure qui fait l’unanimité de part et d’autre : saint Augustin. Saint Paul VI verra dans un tel dialogue les prémisses de l’œcuménisme.
Ensuite, une fois devenu prévôt, c’est-à-dire vicaire général de son diocèse, il affronte avec courage et lucidité les contre-témoignages des catholiques et des ecclésiastiques, en particulier. Il est convaincu que de telles infidélités ne font qu’alimenter l’opposition des protestants à l’Église. « C’est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé chaque jour parmi les nations ! », ose-t-il s’exclamer à la suite du prophète Isaïe, du prophète Ezéchiel et de saint Paul.
Comme évêque, saint François accorde une grande attention à l’accompagnement des prêtres. Il met aussi sur pied un véritable apostolat de terrain. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, il n’hésite pas à aller visiter à cheval les paroisses les plus reculées de son diocèse, juchées dans les montagnes parfois hostiles de la Savoie. Les synodes annuels qu’il organise sont assortis de décisions et d’instructions très précises concernant l’administration des sacrements, notamment. La formation du clergé est l’une de ses préoccupations principales. Faute de moyens financiers, il ne fonde pas de séminaire, comme le préconise pourtant le Concile de Trente. Il veille cependant à ce que les clercs dont il a la charge soient à la fois instruits et édifiés par l’étude, qu’il désigne comme le « huitième sacrement » du prêtre.
On peut lire dans son Exhortation aux ecclésiastiques pour qu’ils s’appliquent à l’étude : « Et puisque la divine Providence, sans avoir égard à mon incapacité, m’a ordonné votre évêque, je vous exhorte à étudier tout de bon, afin qu’étant doctes et de bonne vie, vous soyez irréprochables et prêts à répondre à tous ceux qui vous interrogeront des choses de la foi. »
En outre, afin de favoriser ce que nous appellerions aujourd’hui le dialogue entre foi et culture, l’évêque de Genève va même jusqu’à fonder une académie à Annecy, avant même que notre Académie française ne voie le jour. Dans le même esprit, saint François de Sales encourage vivement un prêtre de son diocèse qui a pour projet de rédiger des textes visant à répondre aux grandes interpellations de son époque. À la fin de sa vie, il lui écrit ces mots : « Je dois vous dire que la connaissance que je prends tous les jours des humeurs du monde me fait souhaiter passionnément que la divine Bonté inspire quelques-uns de ses serviteurs d’écrire au goût de ce pauvre monde »1.
Comment envisage-t-il les rapports entre prêtres et laïcs ? L’union à Dieu dans l’oraison se présente dans les traités de dévotion salésiens comme une expérience spirituelle accessible à tous. Le pasteur François de Sales demeure donc « devant » mais aussi « aux côtés » de son troupeau. Son amitié spirituelle avec sainte Jeanne de Chantal, qui fonde l’ordre des Visitandines avec lui, est un bel exemple de « coresponsabilité », dirait-on aujourd’hui.
Il existe, de manière générale, une grande consonance entre la pastorale de saint François de Sales et la réflexion actuelle de l’Église sur la synodalité. Bref, comme prêtre et comme évêque, saint François de Sales aura su sentir, de toute évidence, « l’odeur de ses brebis » ! ¨
1. Cet exemple est cité par le pape François dans Totum amoris est, la lettre apostolique qu’il rédigea le 28 décembre 2022, à l’occasion du 400e anniversaire de la mort de saint François de Sales.
L’auteur
Marié et père de famille, Thomas Gueydier est directeur des études au séminaire Saint-Yves (Rennes) où il enseigne la théologie. Il est aussi responsable de l’Institut de formation théologique (IFT) du diocèse de Rennes. Il a consacré sa thèse à L’Augustin de François de Sales (éd. du Cerf, 2021).