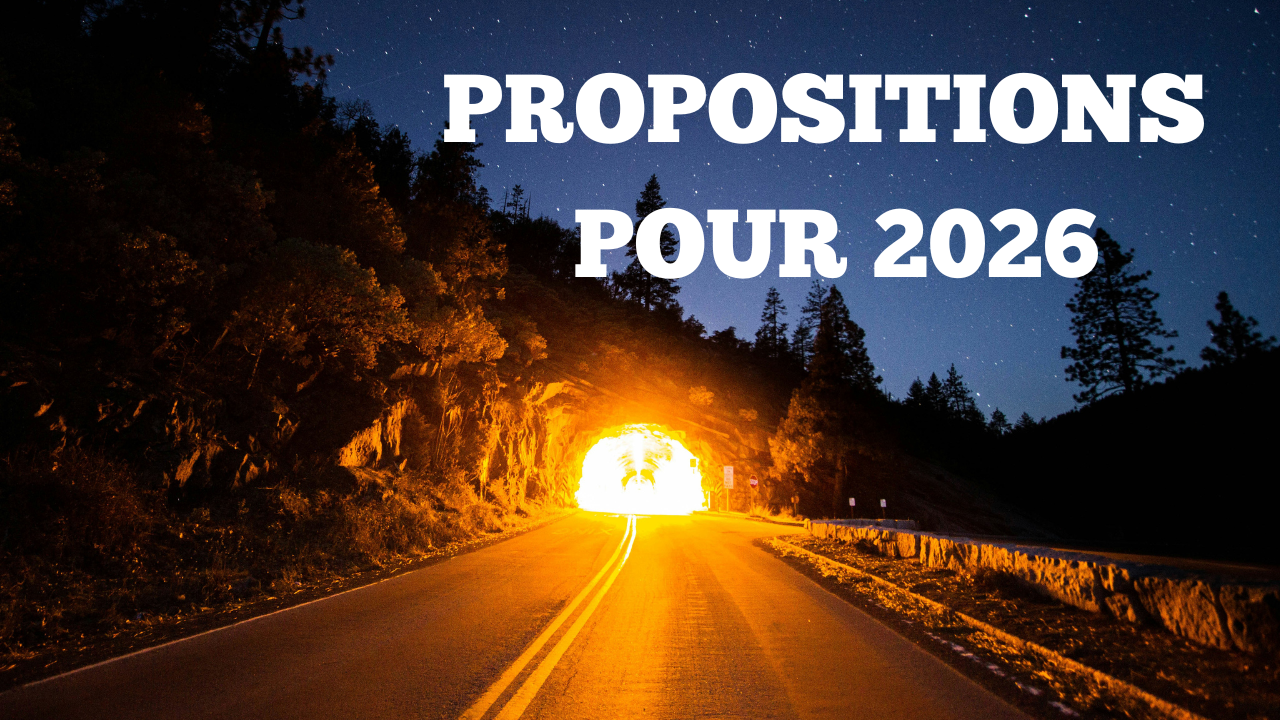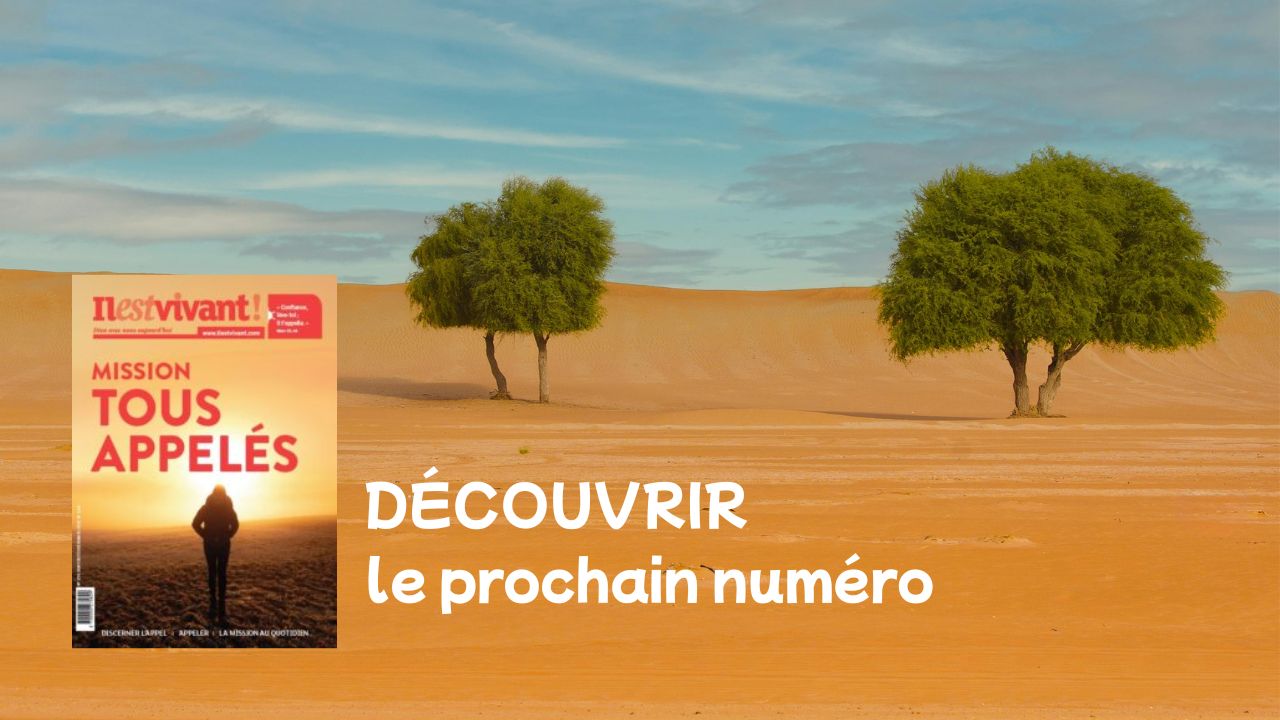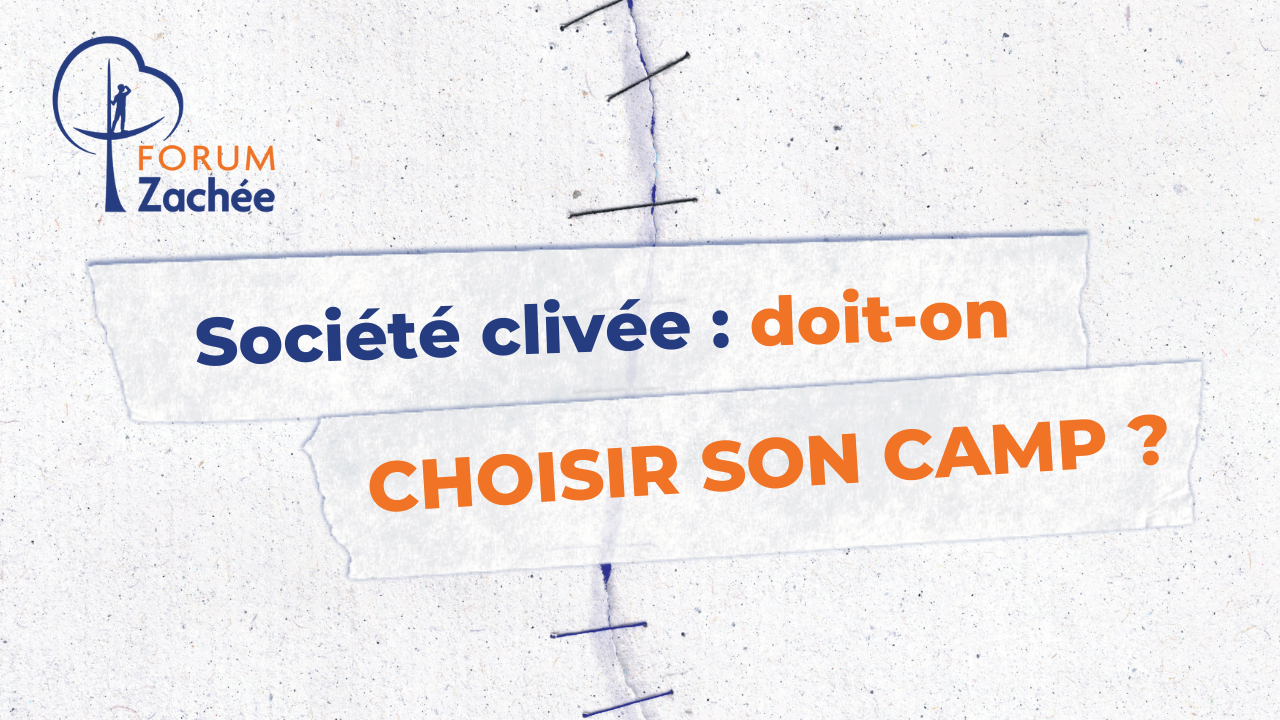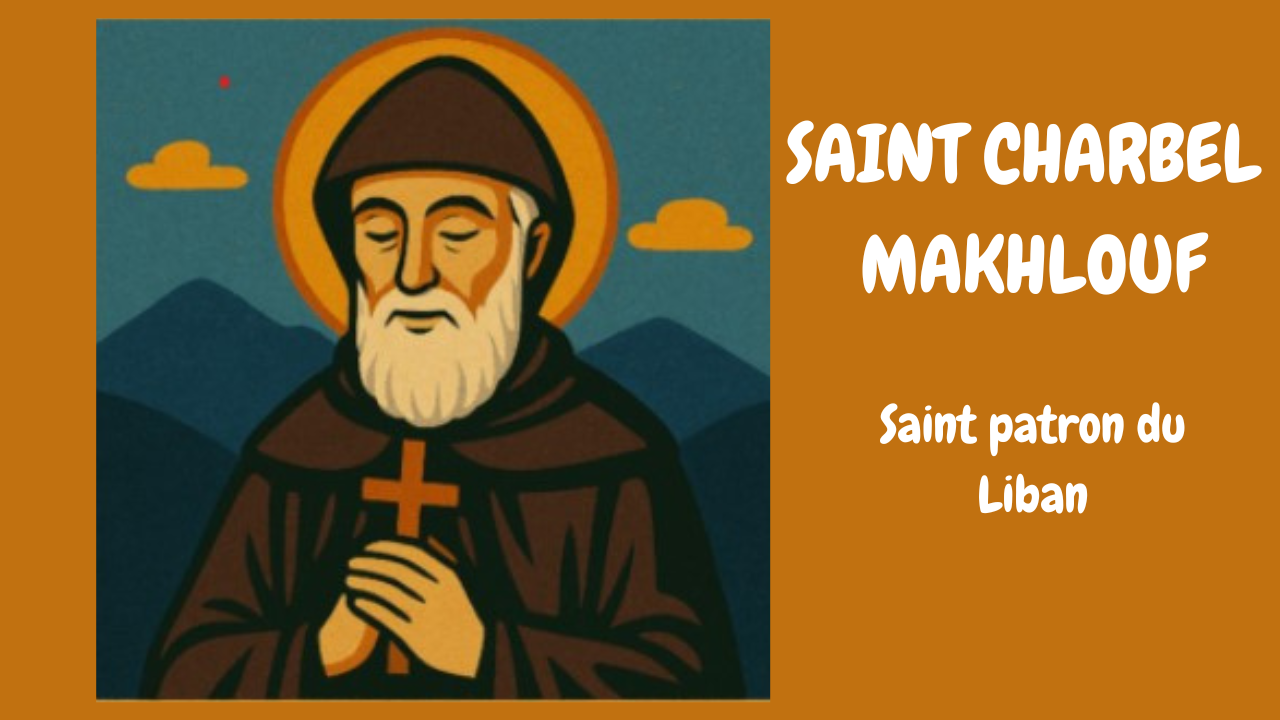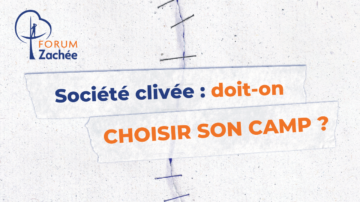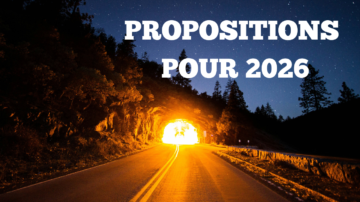Le 22 mai prochain, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon, sa ville natale. Toute sa vie, elle a su déployer une créativité missionnaire par amour de Dieu et des pauvres, qui a eu un rayonnement mondial.
Par L’Abbé PIERRE PEYRET
Prêtre du diocèse de Lyon, l’abbé Pierre Peyret est délégué de l’évêque pour les causes de canonisation.
Tout le monde ne peut pas être de Lyon, il en faut bien d’un peu partout ailleurs (La plaisante sagesse lyonnaise). Pauline-Marie Jaricot sera de Lyon, sa bonne ville qu’elle ne quittera que peu, mais aussi tournée vers un ailleurs toujours plus vaste, jusqu’à l’infini de la charité de Dieu. Avoir des racines n’empêche pas d’être ouvert à l’universel et de vouloir lui porter ce qu’il y a de meilleur, l’amour sauveur de Jésus Christ. Comment réaliser un bien plus large si nous ne commençons pas par faire celui qui est à notre portée ? La réponse à cette question, Pauline l’a donnée de manière concrète par toute sa vie.
Une jeunesse dorée
Pauline naît le 22 juillet 1799 dans une famille de soyeux lyonnais. Elle vit une enfance heureuse portée par la tendre affection et la foi profonde de ses parents. Antoine, son père, issu d’un milieu agricole, s’est tourné vers la soie à 14 ans comme apprenti plieur de soie. Il réussira par son travail et investira dans l’immobilier. Il rencontre sa future épouse, Jeanne, lors d’un chemin de Croix sur les pentes de la colline de Fourvière. Le lieu et les circonstances sont-ils prémonitoires pour leur fille ? Ils soulignent au moins une continuité. De leur union naîtront 7 enfants. Comme souvent au XIXe siècle les enfants communient tardivement et Pauline n’échappe pas à cette règle. Le 16 avril 1812, elle reçoit les sacrements de la confirmation et de l’Eucharistie en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Lyon. De 13 à 17 ans, elle fréquente le monde exclusif des soyeux. Elle mène une vie mondaine et festive entre la maison paternelle et celles de ses deux sœurs mariées, la propriété de Tassin, domaine de Sophie devenue madame Zacharie Perrin – riche fabricant en soie – et le château de Saint-Vallier où réside Marie- Laurence, épouse de monsieur Chartron, le principal industriel en soierie de la localité. Pauline rayonne de son éclatante jeunesse, dans l’insouciance de la richesse familiale et son goût prononcé pour la coquetterie. Mais, commente monseigneur Cristiani, l’un de ses biographes, il y a chez elle un fond de sérieux et de tragique sous l’aspect de la coquetterie et de la légèreté. « Vanité des vanités, tout est vanité », dit l’Ecclésiaste. Séduite par les illusions du monde mais non conquise ni vaincue, elle ne va pas tarder à prendre résolument le chemin de la liberté qu’offre l’Évangile. Le dimanche des Rameaux 1816, Pauline se rend avec sa sœur Sophie en l’église Saint-Nizier pour participer à la célébration eucharistique. Ce jour-là, l’Abbé Würtz prêche sur « les illusions de la vanité, l’être et le paraître ». Pauline se sent interpellée. Elle demande conseil au prêtre qui lui dit « Offrez-vous sincèrement à Notre Seigneur pour qu’il puisse accomplir ses desseins sur vous ». Ce jour resta dans la mémoire de Pauline comme celui de sa conversion (tiré de la biographie publiée par Julia Maurin en 1892).
Un changement de vie radical
Pauline brise alors avec ses goûts et ses habitudes. Elle abandonne bijoux et belles parures. Une transformation intérieure s’opère et elle change radicalement de vie. Elle décide de se vêtir comme les ouvrières en soierie de la Croix-Rousse, les canuses. Elle s’active à visiter les pauvres, les détenus dans les prisons, à soigner les malades, à recueillir les enfants des rues. Elle vient en aide aux prostituées qui arpentent la rue Mercière. Elle en fait embaucher un certain nombre dans l’usine de Saint-Vallier que dirige son beau-frère. La famille Jaricot, en 1815, avait déménagé 21 rue Puits Gaillot, dans une maison située entre la paroisse Saint-Nizier, tout près de l’Hôtel de Ville, et la paroisse Saint-Polycarpe, sur les pentes de la Croix- Rousse. Il suffit de traverser quelques rues pour parvenir là où demeurent les artisans de la soie, les canuts, avec leur métier Jacquard autour duquel gravite toute leur vie. Elle ne peut pas ignorer les conditions de vie et de travail de cette population déshéritée, souvent méprisée et exploitée, tissant 17 heures par jour et dont le salaire ne suffit pas toujours à nourrir tout le monde. Pauline est sensible à cette injustice sociale. Les pauvres, elle les côtoyait déjà avec ses parents qui donnaient l’aumône. Mais maintenant elle fait le vœu de se dédier à eux. L’Hôtel-Dieu n’est pas loin du domicile familial, elle s’y rend pour aider, elle le fait au nom du Christ, son Seigneur. Elle veut que les pauvres retrouvent leur dignité, par le travail, et un travail qui ne les épuise pas. Elle va les faire embaucher par sa famille, permettre aux canuses de quitter la prostitution. Les besoins primaires étant honorés, elle va s’occuper de leur âme. Elle partage ce qu’il y a de plus simple : leur fait la lecture, chante les psaumes, à la manière de saint Louis-Marie Grignion de Monfort, composant des chants sacrés sur des airs de chants profanes que ces femmes connaissaient. Le 25 décembre 1816 pendant la messe de Noël en la chapelle Notre-Dame de Fourvière elle fait secrètement le vœu de chasteté perpétuelle et s’engage à consacrer sa vie à Dieu et aux autres. Elle réunit autour d’elle quelques-unes de ses canuses, avec lesquelles elle crée Les réparatrices du Cœur méconnu et méprisé de Jésus, son « bataillon sacré » comme elle dira. Ensemble elles mènent une vie de prière et de charité.
Le premier réseau social missionnaire
En 1818, son frère Philéas dont elle est si proche depuis leur enfance, qui est entré au séminaire à Saint-Sulpice à Paris, lui demande une aide financière pour les Missions en Chine, soutenues par les Pères des Missions étrangères de Paris de la rue du Bac. C’est la naissance du Sou hebdomadaire une quête de personne connue à personne connue que Pauline met en œuvre avec les Réparatrices et les 200 ouvrières de l’usine de Saint-Vallier. Certaines diront « à la messe je resterai debout pour que le sou de la chaise soit donné » ou alors « je porterai un bonnet noir au lieu d’un blanc pour moins aller à la blanchisserie » : quelle belle manière chrétienne de vivre la sobriété, une petite pénitence du quotidien pour une bonne œuvre. À l’automne 1819, Pauline élabore un mode d’organisation qui allie aide matérielle et réveil des valeurs spirituelles. Sa volonté est de ne pas agir seule, de conscientiser chaque personne aux questions missionnaires. « Il s’agit, écrit-elle, de créer des dizaines d’associés avec des chefs de dizaines, ces dernières se rassemblant en centaines puis en millièmes. » Cette action fera tache d’huile. Les offrandes afflueront et seront reversées intégralement aux Missions étrangères de Paris. Les Missions d’Amérique, informées, s’associeront à cette démarche et, le 3 mai 1822, l’Œuvre de la Propagation de la Foi est fondée officiellement à Lyon. Pauline n’a que 19 ans et elle est à l’origine du “premier réseau social missionnaire”. Elle fait connaître les besoins des missionnaires, invite à les aider matériellement mais aussi spirituellement en les entourant de la prière de tous. Par dizaines, centaines et sections, les donateurs se rencontrent pour donner leur sou de la main à la main et échanger les nouvelles des missions, créant d’autres dizaines à leur tour. Très vite le système va prendre une ampleur considérable dans toute la France et en Europe. Pauline n’est pas reconnue comme fondatrice mais peu lui importe pourvu que les missions et l’aide qui leur est apportée se poursuivent. Avec humilité, elle se contente de dire : « Tant mieux si l’œuvre a été prise en charge par des mains plus expertes que les miennes. » Caritas urget nos, « La charité nous presse » dit saint Paul aux Corinthiens, et Pauline veut rester à cette urgence.
Fédérer les âmes pour une œuvre commune
Pauline ne travaille pas pour elle ni pour sa petite gloire. Son intuition et son génie sont de fédérer les âmes, de les faire s’associer pour une œuvre commune. Se vérifie que si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C’est sur ce même modèle qu’en 1826, en réponse aux besoins spirituels de son temps, Pauline Jaricot fait naître l’œuvre du Rosaire Vivant. Elle adopte un moyen analogue à celui de la Propagation de la Foi : 15 personnes méditent quotidiennement les 15 mystères de la vie de Notre Seigneur Jésus Christ (aujourd’hui 20 personnes pour les 20 mystères depuis que le pape Jean Paul II a ajouté les mystères lumineux). Chaque associé récite seulement une dizaine de chapelet en méditant un seul des mystères de la vie de Notre-Seigneur, avec l’intercession de Marie. Ce mystère est tiré au sort par une zélatrice responsable du groupe. À sa mort, on compte environ en France 2 250 000 associés. Le Rosaire Vivant se répand dans le monde entier et perdure jusqu’à nos jours.
Contemplative et active
L’action de Pauline a une source : sa vie contemplative, son union à Jésus. « J’ai tout appris à vos pieds, Seigneur » dit-elle. Elle demeure dans la maison de Nazareth sur la colline de Fourvière dont elle a racheté les terrains pour préserver un écrin de verdure et de prière au sanctuaire de Notre-Dame. Elle fonde au pied de la colline un hospice pour les femmes pauvres et âgées à l’angle de la Montée des Chazeaux et de la Montée Saint Barthélemy. Cette même année, elle fait une retraite chez les Dames de la Visitation à Avignon où elle éprouve le besoin d’entrer en religion, aspirant à la vie du cloître. Mais ne dit-elle pas elle-même : « Je suis faite pour aimer et agir. » Comment concilier ces aspirations qui semblent s’opposer entre elles ? Le prédicateur l’aide à discerner. Elle demeurera dans le monde et dans l’état de laïque « où elle accomplirait mieux la volonté de Dieu ». Elle garde néanmoins au cœur le désir d’une vie plus contemplative. En 1832, elle achète la maison de La Breda, montée Saint-Barthélemy, qu’elle nomme Maison de Lorette, en référence au sanctuaire italien où est vénérée la première maison du Fils de Dieu sur terre, là même où le Verbe a pris chair. Elle place cette maison sous le patronage de la Très Sainte Vierge Marie faisant inscrire au fronton de la façade « Marie conçue sans péché, priez pour nous ». Une chapelle est construite à côté de sa chambre où débute la pratique de l’adoration eucharistique permanente. L’Eucharistie a toujours été pour elle le centre et la racine, la source et le sommet ; elle puise dans le sacrifice de Jésus la force nécessaire à sa vie d’action. Elle rassemble autour d’elle une communauté de jeunes filles pieuses qu’elle nomme Les filles de Marie.
Le souci du salut de la classe ouvrière
Pauline reste attentive aux conditions de travail et de vie des ouvriers de la soie, les canuts. Les accords signés avec les exploitants ne sont pas respectés : en 1831 et de nouveau en 1834 c’est la révolte. Pauline fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les affrontements. Mais quand ceux-ci ont lieu, elle prodigue soin et assistance aux blessés. Les ouvriers lui en sont reconnaissants et la tienne pour une sainte, d’autant qu’elle n’est pas de leur milieu.
En 1845, une opportunité se présente à Apt dans le Vaucluse sur la proposition de deux négociants. Son désir n’a cessé de grandir et elle veut mettre en œuvre un plan d’évangélisation de la classe ouvrière. « La plaie sociale dont souffre la France étant dans l’agglomération de la classe ouvrière, je voudrais faire de cette agglomération même, un moyen de salut… En un mot, je voudrais qu’on rendît l’époux à l’épouse, le père à l’enfant, et Dieu à l’homme ». Elle achète l’usine de Rustrel pour en faire un modèle d’esprit chrétien. Un bâtiment attenant loge les familles et à côté se trouvent une école et une chapelle. Mais l’année suivante les deux hommes d’affaires devenus gestionnaires de l’entreprise sont emprisonnés pour détournements de fonds. Ils sont condamnés. Pauline ne baisse pas les bras, elle
s’entoure de collaborateurs de confiance et tente de redresser l’entreprise. Mais les poursuites judiciaires nécessaires pour faire valoir ses droits et son honnêteté contre ceux, dit-elle, « qui ont abusé de sa foi », ainsi que le montant des traites restant à honorer, ont raison de sa persévérance. Le 12 mai 1852, l’usine des hauts fourneaux de Rustrel doit être vendue sur « folle enchère » pour 120 000 francs. Entre-temps, Pauline Jaricot a signé un engagement à rembourser tous les actionnaires. Elle estime que « la loyauté et l’honneur lui dictent le devoir de relever de cette ruine, tous ceux qui ont souscrit à cause de son nom ». Elle n’y était pas tenue mais elle veut assumer cette responsabilité pour que personne ne subisse de conséquences fâcheuses de cette malversation. Elle y engloutit toute sa fortune et passera le reste de ses jours dans la plus grande pauvreté, quêtant pour rembourser ses dettes. Ce sera son long chemin de croix. Se vérifie alors ce que Benoît XIV écrit : « Ce n’est pas dans les choses extraordinaires que consiste la sainteté, mais dans les choses communes non communément remplies. »
« Dieu seul suffit »
En 1861, la maladie de cœur qui accompagne Pauline depuis quelques années s’aggrave. En effet, déjà en 1835 Pauline était partie à Rome où le pape Grégoire XVI encouragea son action en faveur de l’évangélisation et de la vie de prière ; ce n’était qu’une étape pour se rendre en pèlerinage à Mugnano, dans le sud de l’Italie, pour se confier à l’intercession de sainte Philomène, car elle était alors très malade et à l’article de la mort. Elle rentra guérie à Lyon, et fit construire une chapelle en l’honneur de la sainte. Maintenant elle arrive à la fin de sa vie. Son union intime avec le Seigneur et son effacement humble lui permettront un acte de profond abandon. Elle se considère comme « une pauvre qui n’a que Dieu seul pour ami, Dieu seul pour soutien… mais Dieu seul suffit ». Le 9 janvier 1862 Pauline meurt dans sa maison de Lorette. Elle a puisé son énergie pour le service des pauvres et de la mission dans l’union à Dieu. Elle nous engage à l’action, puisée dans la contemplation, dans l’intimité avec le Christ, dans l’Eucharistie. Prions pour que, parvenue à l’honneur des autels, son exemple puisse servir l’Église tout entière. Léon XIII dira : « Par sa foi, sa confiance, sa force d’âme, sa douceur et l’acceptation sereine de toutes les croix, Pauline se montra une vraie disciple du Christ » (bref du 13 juin 1881). ¨