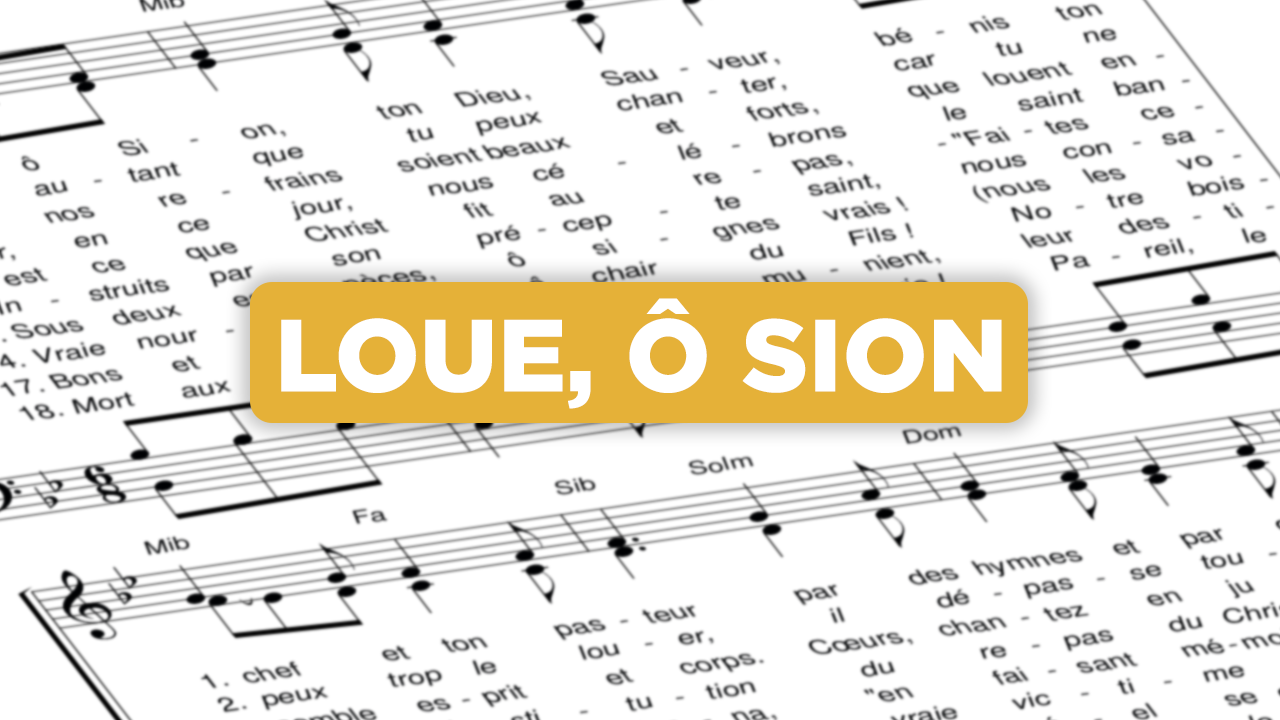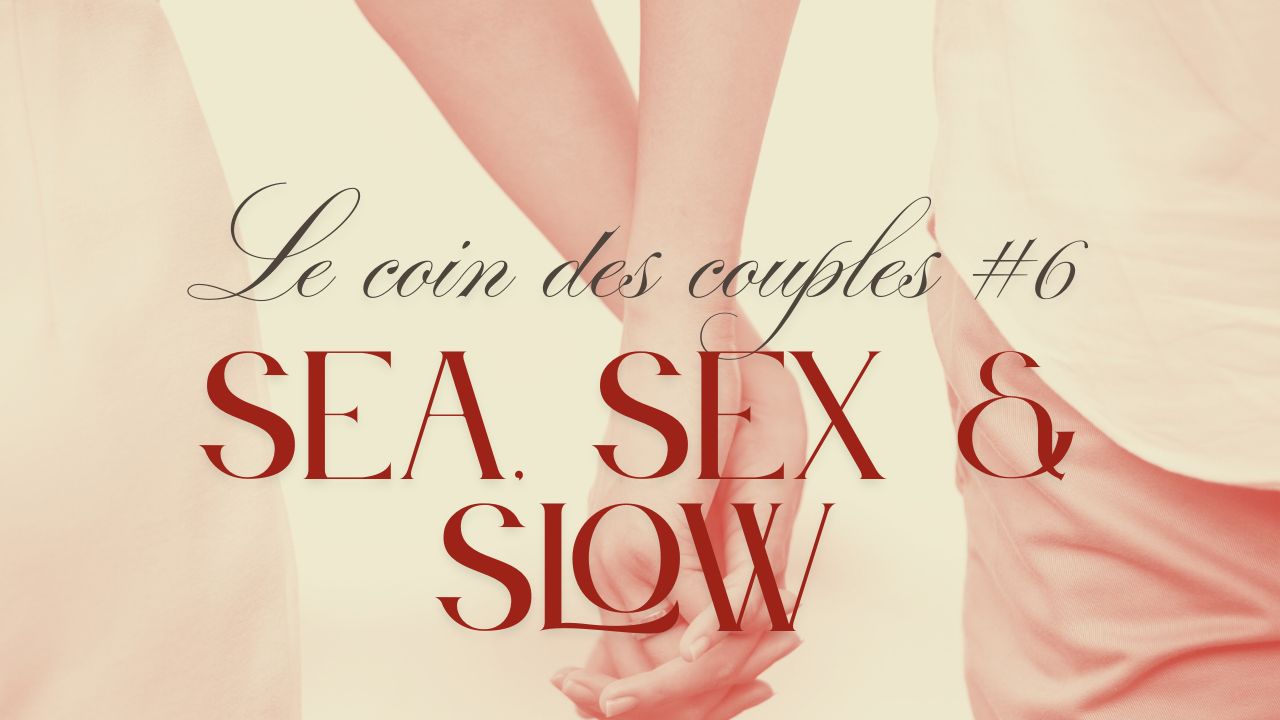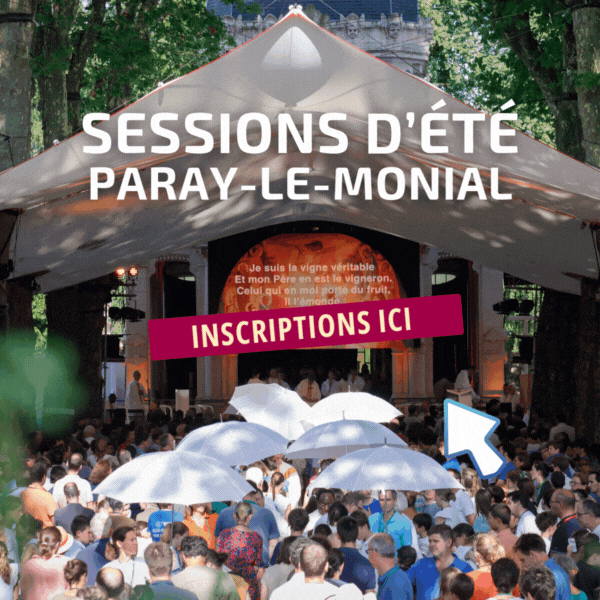Rédacteur en chef du magazine Prier, Xavier Accart est entre autres l’auteur de L’art de la prière (Éditions Emmanuel, 2022). Il nous rappelle l’importance dans la prière, de la Parole de Dieu, de l’acte de foi, et de son lien avec la prière liturgique.


L’art de la prière, Xavier Accart, Éd. Emmanuel, 2022
À la fois passionnant et très pédagogique, L’art de la prière rassemble toutes les ressources de la prière chrétienne d’hier et d’aujourd’hui. Un compagnon indispensable pour apprendre à prier et enrichir sa vie de prière.
Dans La spiritualité est américaine (Le Cerf), Jean-Marie Guellette, dominicain, montre comment ce qu’on appelle aujourd’hui « la spiritualité » au sens vague, s’est développée aux États-Unis depuis deux siècles environ. Elle est une sorte de bain spirituel assez individualiste. Dans ce pays, des sociologues ont fait des études pour déterminer quelles étaient les « croyances » des Américains. Ils ont interrogé notamment une femme prénommée Sheila : « Ma religion ? Elle est propre à moi-même », leur a-t-elle répondu. C’est emblématique du phénomène religieux aujourd’hui : chacun se fabrique sa propre religiosité. Cet état d’esprit, appelé shelaïsme, se diffuse dans la société. Nous en sommes imprégnés sans même en avoir conscience. Dans ce “bain”, la prière personnelle chrétienne est perdue de vue, et spécialement ces trois fondamentaux que sont la Parole de Dieu, l’acte de foi et son lien avec la prière liturgique.
L’importance de la Parole de Dieu
Il y a prière quand un cœur accueille la Parole de Dieu, l’intériorise, la laisse travailler en lui et la rend à Dieu dans la louange, l’action de grâce ou la demande, explique le dominicain Philippe Lefebvre, dans son livre Ce que prier veut dire (Éditions du Carmel). Cela rejoint la Parole : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat… » (Isaïe 55, 10-11). Il y a un mouvement de descente et de remontée. Dans la Parole de Dieu, Dieu se donne à nous. Il se révèle à nous pour que nous nous nourrissions du pain de sa Parole, comme nous nous nourrissons par ailleurs du « pain des anges », de l’eucharistie. La psalmodie, la lectio divina, la méditation selon saint Ignace et d’autres méthodes nous aident à assimiler cette Parole de Dieu que nous pouvons lui rendre ensuite, après qu’elle nous ait transformé, comme si elle sortait de notre cœur, comme si c’étaient nos propres mots.
Dom André Louf, qui a été abbé du Mont des Cats et a ensuite vécu en ermite dans le sud de la France, recense les verbes utilisés par les Pères de l’Église pour décrire les effets de la Parole dans un cœur humain : « La Parole touche notre cœur, le blesse, l’aiguillonne, le fend, l’ouvre ». Il va même jusqu’à écrire : « La grâce du baptême devient réalité quand une parole de Dieu, pour la première fois, interpelle notre cœur. » La Parole de Dieu n’est pas un texte ordinaire. Elle a des propriétés particulières. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle qu’il existe différents niveaux de sens de l’Écriture. Ces niveaux correspondent aux étapes de la lectio divina, qui est comme une échelle spirituelle.
La foi
Quand on parle de foi, on pense immédiatement à la « croyance ». Dans le contexte chrétien, la foi est une vertu surnaturelle qui nous est donnée au baptême, greffée sur notre intelligence. Cette capacité de connaissance de Dieu est restaurée en nous par le baptême. Pour activer cette vertu en nous, nous avons à poser un acte de volonté : c’est ce qu’on appelle l’acte de foi. « Je crois ce que je veux croire », dit en ce sens Thérèse de Lisieux. Cette capacité de connaissance nous permet de toucher Dieu. Un épisode de l’Évangile nous éclaire particulièrement sur l’acte de foi : l’Évangile de la guérison de la femme hémoroïsse (Marc 5, 25-34). Alors que Jésus est oppressé par la foule, cette femme malade touche son manteau avec foi, et une force sort de lui, et elle est guérie. Jésus se retourne et demande : « Qui m’a touché ? » C’est pour moi la plus belle image de la foi.
Ce contact mystérieux qu’on cultive particulièrement lors de l’oraison silencieuse des Carmes est le fond de toute prière. On lance un simple regard vers Dieu, lui exprimant notre confiance. Et même si on est le plus souvent dans l’obscurité, un goût de Dieu peut s’installer au fond de l’âme, si bien qu’on aime rester auprès de lui, même si on ne ressent rien de sensible. Saint Jean Climaque écrit : « La foi est l’aile de la prière ; sans la foi, ta prière revient vers toi. » L’acte de foi nous permet de sortir de l’orbite de notre moi. Il nous permet de nous arracher à nous-même pour aller toucher Dieu. On peut laisser s’endormir la foi reçue au baptême ou à l’inverse l’activer, en posant un acte libre. Au début, prier peut paraître vertigineux : parler avec quelqu’un que l’on ne connaît pas, quelle étrangeté ! Je crois qu’il y a alors un saut à faire dans la foi. On peut se demander : « Est-ce que je crois vraiment à ce que je crois ? Est-ce que je ne prie pas seulement par habitude ? Est-ce que cela vient vraiment de mon cœur ? »
La liturgie, source de toute prière
La liturgie est le lieu où l’on naît à la vie chrétienne. Si on peut prier comme chrétien, c’est parce que nous avons été baptisés. La liturgie est aussi le lieu où l’on entend la Parole de Dieu : elle est proclamée. « La foi naît de l’écoute », dit saint Paul. Nous sommes encore formés par la liturgie. Nous apprenons à articuler invocation, psalmodie, méditation de la parole, action de grâce, intercession… La liturgie est ainsi une école de la prière. Et nous puisons enfin dans ce grand courant d’amour ininterrompu depuis 2 000 ans la force, le dynamisme de notre prière.
Romano Guardini, que le pape François cite dans Desiderio desideravi, relève que si on ne revient pas régulièrement à la pratique liturgique, qui est la norme de la prière, notre prière devient subjective car c’est alors notre sensibilité qui devient la norme. Au lieu de se laisser travailler par l’Esprit, traverser par la grâce, on finit par renforcer notre ego. Or le but de la prière est de s’ouvrir au Tout Autre qui s’est donné à nous et qui nous invite à rentrer dans ce mouvement eucharistique. On peut dire que la prière personnelle accomplit la précédente eucharistie et prépare l’eucharistie à venir. La communion est à vivre comme le lieu d’une rencontre. Nous sommes invités à nous ouvrir à ce qui nous est donné afin que cela se traduise dans nos vies. Dieu a besoin qu’on lui ouvre la porte.
La prière n’est pas indépendante de la vie. Elle n’est pas une fin en soi. On peut d’ailleurs vérifier la justesse de notre prière dans notre attitude générale vis-à-vis des autres. Car « celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » (1 Jn 4, 19). ¨
Propos recueillis par LAURENCE DE LOUVENCOURT
Xavier : « J’aimais être plongé dans un bain de silence »
On ne m’a jamais appris à prier. Je suis d’une génération qui a pâti d’un déficit de transmission. Dès l’enfance, j’ai eu pourtant un attrait fort pour les choses de Dieu. Mais quand je suis devenu adolescent, je ne comprenais pas le lien existant entre cette soif de Dieu qui m’habitait et l’Église catholique.
Puis j’ai découvert les monastères, notamment l’abbaye de Kergonan, et avec ce lieu, toute la liturgie grégorienne. J’aimais être plongé dans un bain de silence, mais un silence habité. Et rien ne nous ouvre plus à la prière que le contact avec des hommes de prière.
Un jour, j’échangeais avec une grand-tante au sujet du chapelet, et lui demandais si elle en avait un. Elle était éberluée car pour elle, c’était son pain quotidien ! Ce jour-là, elle m’a donné le chapelet de mon arrière-grand-père. Ensuite, j’ai découvert les écoles d’oraison qui, animées par des laïcs dans les paroisses, se déroulaient sur six semaines. En y participant, je m’engageais à faire oraison tous les jours. Quand on fait cela pendant six semaines, on est lancé !
La prière des heures m’a beaucoup nourri aussi. C’est une formidable école de prière pour les laïcs : on peut choisir de prier soit les laudes, soit les vêpres ou les complies, soit les deux selon le temps dont on dispose. C’est la prière liturgique de l’Église. Elle structure notre prière.
Le livre de Guigues le Chartreux sur la lectio divina m’a permis de comprendre la place fondamentale de la Parole de Dieu dans la prière (voir encadré page 12).
Quand on m’a demandé de devenir rédacteur en chef du magazine Prier, il y a dix ans, après un moment d’hésitation, j’ai accepté dans l’espoir de pouvoir transmettre aux lecteurs la tradition spirituelle chrétienne de la prière, qui est un trésor trop méconnu. Cette tradition peut guider de nombreuses personnes en recherche vers Dieu.
La lectio divina, mode d’emploi
Guigue le Chartreux décrit la lectio divina comme une échelle spirituelle, comportant plusieurs barreaux.
• On lit d’abord le texte, en cherchant à comprendre le sens littéral.
• Une fois que l’on a lu le texte attentivement, sans gommer les aspérités qui résistent à notre compréhension, on commence à méditer ; on cherche le sens symbolique du texte. Or la Parole s’interprète par la Parole. Tel verset renvoie à tel autre passage de la Bible. Rapprocher ces deux passages, c’est un peu comme rapprocher deux silex : cela fait jaillir une première étincelle de compréhension, puis une deuxième, une troisième, etc. Lorsqu’on n’est pas familier de la Bible, on peut s’aider au départ des références en marge.
• Un sens plus profond du texte commence à émerger ; et en même temps, nous comprenons qu’avec nos seules capacités humaines, nous ne pourrons y accéder. Le troisième barreau de l’échelle spirituelle est donc la prière. Dieu qui était un « Il » devient un « Tu ». Un dialogue s’instaure avec Dieu et nous lui demandons de nous éclairer sur la Parole, de nous la faire pleinement goûter.
• Durant ce dialogue, nous pouvons, à un moment, être saisi par l’Esprit. Dieu est là présent, nous nous tenons simplement en sa présence. Le quatrième échelon est la contemplation.
Les attitudes corporelles
Les Pères de l’Église disent que la prière intérieure s’exprime dans les positions du corps mais aussi que l’attitude du corps aide à l’inverse à entrer dans une attitude intérieure. Dans Vases d’argile (Bellefontaine), un ermite souligne le fait que, dans leur traité sur la prière, Origène et Tertullien réservent un appendice aux postures de la prière personnelle : s’ils le font, c’est selon lui que c’est une tradition apostolique. Dans mon livre L’art de la prière, je consacre tout un chapitre aux attitudes corporelles dans la prière personnelle. X.A.