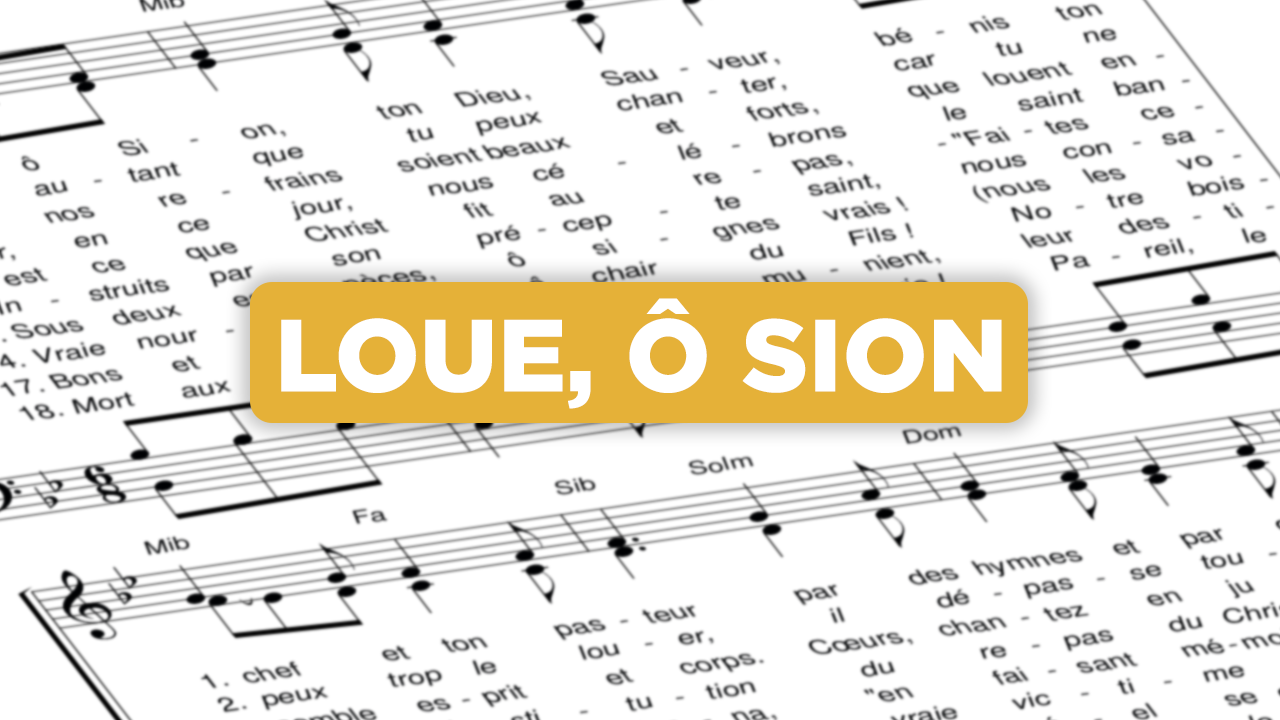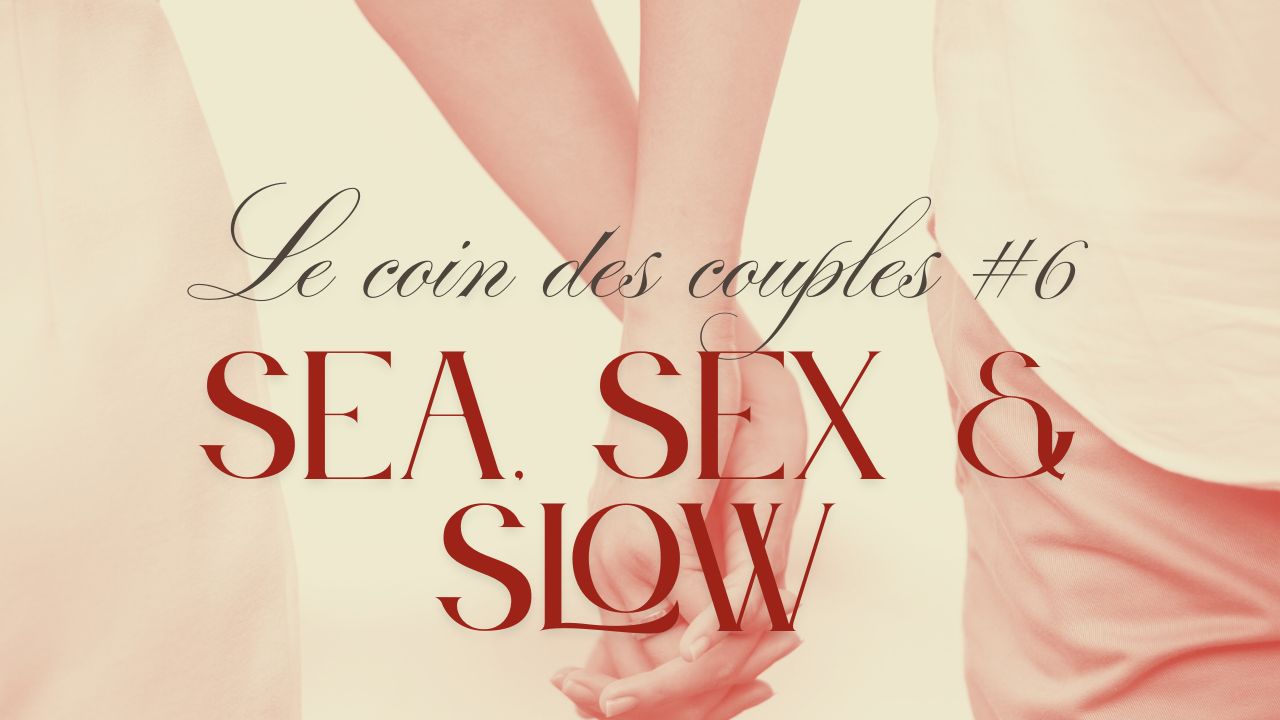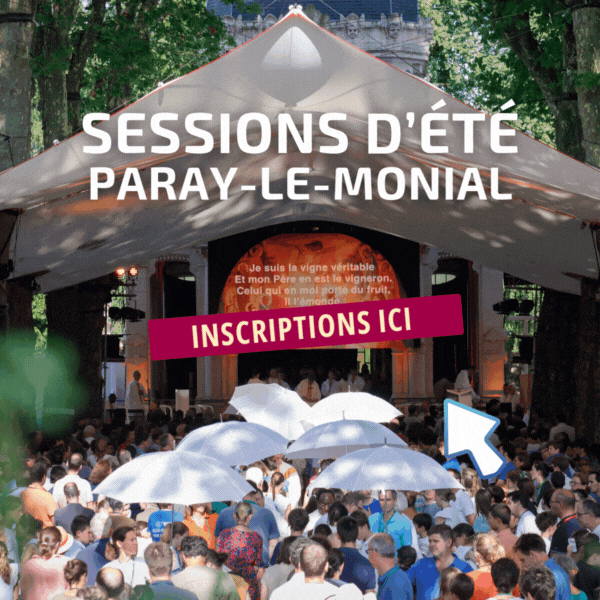Notre époque marquée par l’individualisme et la violence est aussi propice à l’empathie [1]. C’est ainsi que, pour lutter contre le harcèlement scolaire, l’Éducation nationale a décidé de mettre en place, à la rentrée 2024, des cours d’empathie dans les écoles. Discernement.

1. Qu’est-ce que l’empathie ?
Dans sa thèse de philosophie qui porte sur ce sujet, Edith Stein (qui est encore agnostique) donne l’exemple suivant : « Mon ami vient vers moi en rayonnant de joie et il me raconte qu’il a réussi son examen. Par l’empathie, je saisis sa joie et en me transposant en elle, je saisis le caractère réjouissant de l’événement et j’ai maintenant moi-même de la joie originaire à ce propos [2] ». Pour autant, « quand je vis cette joie de l’autre, je ne ressens pas une joie originaire, elle ne jaillit pas vivante de mon moi [3] ». Donc, par l’empathie, j’éprouve réellement quelque chose de ce que l’autre éprouve (joie, tristesse). Pour autant, je ne fusionne pas avec lui : jamais, même après toute une vie passée avec mon conjoint, je ne saurai de l’intérieur ce qu’il ressent quand il aime, est découragé, etc.
2. L’empathie est-elle naturelle ?
En 1992, à Parme, des chercheurs en neurosciences ont fait par hasard une découverte décisive : l’existence dans le cerveau de ce qu’ils appellent les neurones miroirs. Ce sont les mêmes neurones qui s’activent quand un singe effectue une action ou lorsqu’il la voit effectuée par un autre. L’expérience n’a pas tardé à être élargie à l’homme : par exemple, la douleur ressentie et la douleur observée activent les mêmes circuits nociceptifs. Les chercheurs parlent d’une synchronie physiologique entre l’observateur et l’observé du point de vue émotionnel. Les neurones miroirs sont donc l’un des fondements organiques de l’empathie. Ils prédisposent notre âme à éprouver ce que l’autre éprouve [4].
3. L’empathie est-elle variable ?
L’empathie apparaît ainsi comme une compétence universelle mise en œuvre, souvent à notre insu, dans les rencontres interpersonnelles. Si cette capacité est coextensive à l’humanité, elle varie cependant beaucoup selon les personnes. Comme la sensibilité. Mais elle s’éduque et se développe par différentes méthodes comme l’Approche Centrée sur la Personne (Carl Rogers) ou la Communication NonViolente (Marshall Rosenberg).
4. L’empathie est-elle bonne ?
L’empathie est psychologiquement bonne, puisqu’elle dispose à comprendre le prochain. Notre psychisme est incliné et notre cerveau précâblé pour nous ouvrir aux autres humains et même aux animaux.
Mais elle est éthiquement neutre. Il est terrifiant de constater que les tortionnaires les plus efficaces sont ceux qui sont doués d’empathie : grâce à elle, ils sont capables de percevoir ce qui fera souffrir l’autre. En effet, les résultats établis à partir de l’étude des effets des lésions cérébrales [5] attestent que les zones des compétences cognitives nécessaires à l’empathie (la capacité de se mettre à la place de quelqu’un) et celles des compétences affectives (la capacité à ressentir ce que l’autre ressent) sont différentes [6]. Or, autant les psychopathes sont doués d’une très forte empathie cognitive, autant ils sont au degré zéro de l’empathie émotionnelle.
5. L’empathie est-elle nécessaire ?
L’empathie est une grande aide pour prendre soin de l’autre et éviter de lui faire du tort. Sans elle, nous sommes moins portés à le secourir. L’on a monté l’observation suivante. Un compère se comporte de manière intentionnellement injuste dans un laboratoire. En un second temps, il se fait piquer par une aiguille. L’on observe alors que ses collègues éprouvent moins de compassion à son égard. De plus, la zone du cerveau stimulée par l’empathie, le cortex cingulaire, n’est pas stimulée [7].
6. L’empathie peut-elle être excessive ?
Une première limite de l’empathie est affective : devenant co-souffrance, elle peut induire un véritable stress émotionnel (on parle de « fatigue empathique », « détresse affective », etc.), puis, par réaction, une indifférence, voire un cynisme. C’est ainsi que, en 2015, après avoir éprouvé de l’empathie envers les réfugiés syriens, la population allemande s’est ensuite verrouillée émotionnellement.
Une deuxième limite est cognitive. Celui qui ressent de l’empathie peut être aveuglé, jusqu’à induire un syndrome de Stockholm. « Lors de procès, il n’est pas rare que l’on compatisse avec un accusé en entendant la plaidoirie de son avocat qui retrace son enfance malheureuse [8] ».
7. L’empathie est-elle suffisante ?
De ce qui précède, il découle donc que l’empathie est très bienfaisante, mais insuffisante. C’est une ressource qui demande à être éduquée. Les deux excès dictent les compléments.
D’abord, quant à la mesure. Ceux qui sont spontanément peu sensibles, doivent apprendre à se mettre à la place de l’autre et à développer leur intelligence émotionnelle (que ressent-il ?). En revanche, ceux qui sont très empathiques doivent aussi être éduqués à ne pas s’identifier à ce qu’ils ressentent et à ne pas jouer au Sauveteur (triangle de Karpmann [9]).
Ensuite, quant au contenu, c’est-à-dire au discernement. Porter secours à quelqu’un, prendre soin d’un autre requiert que l’on mobilise, en plus de l’empathie, les vertus morales : la justice (la personne a-t-elle commis un tort ? Est-ce à moi de l’aider ?, etc.), la prudence (la personne se comporte-t-elle de manière responsable ?, etc.), la tempérance (ai-je les ressources ? est-ce que j’adopte la bonne distance affective ?, etc.).
8. L’empathie est-elle la compassion ?
L’empathie est une capacité naturelle inscrite dans notre âme et notre corps. Pratiquée avec justesse, prudence, etc., elle devient une vertu : la compassion. « Répandue dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a été donné » (Rm 5,5), elle se transforme en miséricorde – le don demandant à fructifier dans une pratique assidue qui nous configure au « Père riche en miséricorde » (Ep 2,4). Dans les Évangiles, Jésus exerce l’empathie, ou plutôt la miséricorde, dans pas moins d’une soixantaine de passages. L’un des plus notoires est la guérison et le pardon du paralytique (cf. Mc 2,1-12) [10].
Pascal Ide
[1] Cf., par exemple, Jeremy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Vers une civilisation de l’empathie, trad. Françoise et Paul Chemla, coll. « Babel » n° 1135, Arles, Actes Sud, 2012.
[2] Edith Stein, Le problème de l’empathie, trad. Michel Dupuis, revue Jean-François Lavigne, Paris, Ad Solem et Le Cerf, Toulouse, Éd. du Carmel, 2012, p. 35.
[3] Ibid., p. 31.
[4] Cf. site pascalide.fr : « Les neurones-miroirs, prédisposition à l’amour-don ».
[5] Cf. Simone G. Shamay-Tsoory, Rachel Tomer, Béatrice Berger & Judith Aharon-Peretz, « Characterization of empathy deficits following prefrontal brain damage: The role of the right ventromedial prefrontal cortex », Massachusetts Institute of Technology Journal of Cognitive Neuroscience, 15 (2003) n° 3, p. 324-337.
[6] Cf. Paul J. Eslinger, « Neurological and neuropsychological bases of empathy », European Neurology, 29 (1998) n° 4, p. 193-199.
[7] Cf. Tania Singer, « The Neuronal Basis and Ontogeny of Empathy and Mind Reading: Review of Literature and Implications for Future Research », Review in Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2006 (30) n° 6, p. 855-863.
[8] Delphine Grynberg, Interview dans Cerveau & Psycho, 98 (avril 2018), p. 54-57, ici p. 57.
[9] Cf. Pascal Ide, Le triangle maléfique. Sortir de nos relations toxiques, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2018, chap. 6.
[10] Cf. Maximilien-Marie Barrié, L’empathie à l’école du Christ. Phénoménologie, neurosciences, accompagnement spirituel, coll. « Recherches Carmélitaines », Toulouse, Éd. du Carmel, 2020.