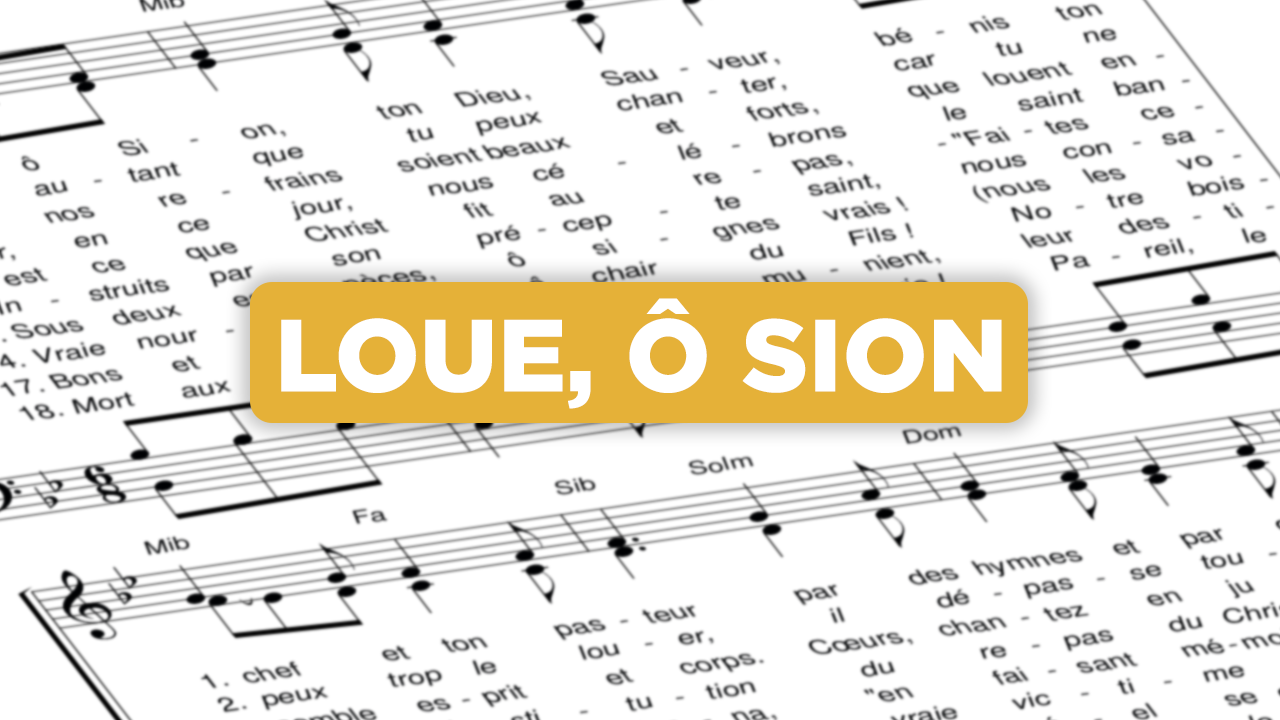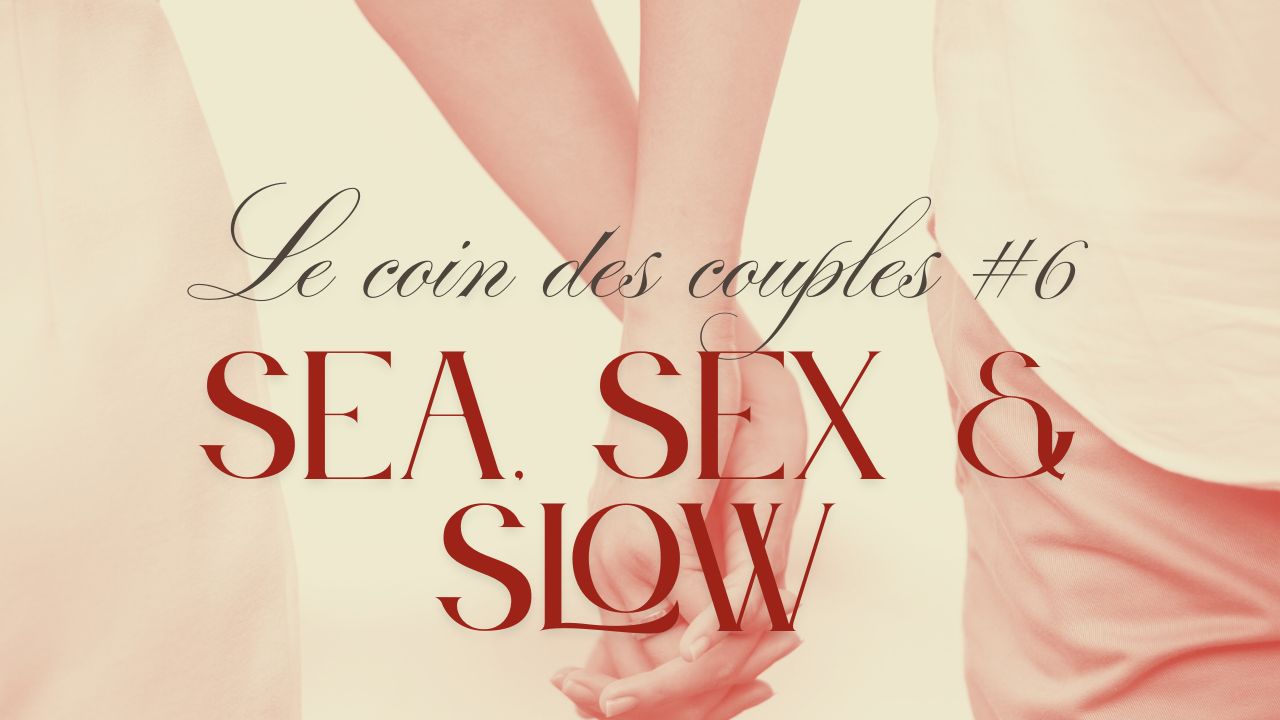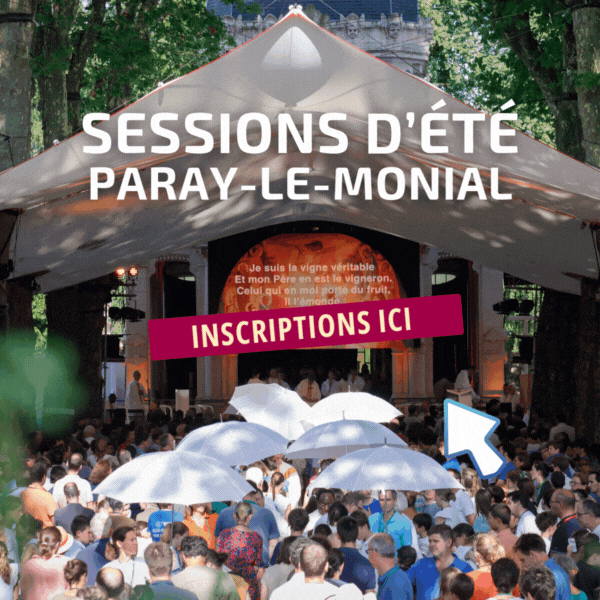Pâques est la grande fête juive (Pessa’h) qui commémore la nuit au cours de laquelle Dieu est passé devant les maisons en Égypte marquées du sang de l’agneau. Pessa’h célèbre la rédemption du peuple juif d’Égypte et son passage à travers la mer Rouge.

Quand Jésus célèbre la Pâque juive la veille de sa mort et de sa résurrection, cette fête juive reçoit en lui son accomplissement : Jésus est le véritable agneau de la Pâque. Son sang libère l’homme croyant du péché et de la mort. En tant que nouveau Moïse, Jésus conduit son peuple – à travers l’eau (le baptême) – « de la mort à la vie ». Les fidèles chrétiens peuvent alors participer au repas dans lequel est mangé « l’agneau de la Pâque immolé pour nous » (Eucharistie).
Le dimanche, en tant que célébration hebdomadaire de la Pâque, est la plus ancienne forme de célébration pascale. Depuis le début de la chrétienté, tous les dimanches est célébrée la résurrection de Jésus comme « le premier jour de la semaine », notamment avec l’Eucharistie (fraction du pain). En ce qui concerne la célébration annuelle de Pâques, elle a eu lieu au moins depuis le IIIe siècle (cf. par exemple Traditio apostolica). Cela impliquait une courte période de jeûne (quelques jours), suivie d’une célébration nocturne de Pâques.
Le temps de préparation de Pâques (notre “Carême des Quarante Jours” actuel) prend forme au fil des siècles.
Trois éléments de fond peuvent être distingués.

1. Jeûne
Le premier élément est la pratique du jeûne comme préparation des fêtes pascales. Ce jeûne trouve son origine probablement en Egypte, à la fin du IIIe siècle et au début du IVe. Dans l’Eglise Ancienne, il y avait un jeûne durant toute l’année, les mercredis et vendredis (à Rome également le samedi), à l’exception du temps pascal. Ainsi, au cours des siècles, les jours « saisonniers » ou quatertemper (quatre temps), qui étaient des jours de jeûne (quatre fois par an : en hiver, au printemps, en été et en automne), tombaient les mercredis, vendredis et samedis. Les vendredis sont encore des jours de jeûne toute l’année (à l’exception du temps pascal). Et là où les jours des quatre temps ont été rétablis (c’est aux Conférences épiscopales de les fixer pour leurs territoires respectifs), ils sont établis généralement un mercredi et / ou un vendredi.
Nous rencontrons déjà le jeûne dans l’Ancien Testament. En signe de repentance et de pénitence, les rois et le peuple « revêtaient le sac et la cendre » et jeûnaient (pensez à Ninive, par exemple). C’est une expression ou une manière de prier avec une plus grande force. De grandes personnalités bibliques ont jeûné : Moïse sur le mont Sinaï, Élie sur le chemin du mont Horeb, et bien sûr le Seigneur Jésus lui-même, dans le désert. Les chrétiens des premiers siècles ont donc suivi ces exemples.
Au cours du IVe siècle, le Carême est alors apparu à Rome comme une préparation explicite à Pâques. Après un jeûne initial qui commençait le dimanche de Laetare (à mi-chemin de notre Carême actuel), le jeûne a par la suite débuté trois semaines plus tôt (notre “premier dimanche de Carême” actuel). Cela a porté le tout à 40 jours (le temps que Jésus jeûnait dans le désert). Enfin, les 40 jours de jeûne ont été comptés de façon encore plus ‘précise’ : comme aucun jeûne n’avait jamais eu lieu le dimanche depuis le début de la chrétienté, le début du jeûne de 40 jours a par la suite été désormais fixé au mercredi précédant le ‘premier dimanche’ de Carême. C’est le caput ieiunii – début du jeûne du Carême, appelé aujourd’hui le “Mercredi des Cendres”. Dans les siècles suivants, le Carême s’étend, surtout en Orient, à cinquante, soixante et même soixante-dix jours (quinquagesima, sexagesima, septuagesima). L’Occident a adopté ces noms, mais n’a jamais fait commencer le Carême liturgique, proprement dit, avant le “Mercredi des Cendres”. Avec le renouveau liturgique de Vatican II, les indications liturgiques des dimanches de « pré-jeûne » ont été abandonnées.
Le nom “Mercredi des Cendres” lui-même rappelle cette pratique de mettre de la cendre sur les têtes des pénitents, puis des croyants. Plus à ce sujet sous le n ° 3, «la pénitence».
Tant dans l’Écriture que dans la tradition liturgique, le jeûne n’est pas isolé. Il est toujours lié à deux autres aspects de la vie chrétienne, à savoir la prière et la justice-miséricorde, souvent concrétisées par l’aumône. Nous le voyons déjà dans l’Ancien Testament, par exemple dans Isaie 58, 6 où le Seigneur dit : « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? »
La triade « jeûne – prière – et aumône » trouve également son reflet dans l’évangile du Mercredi des Cendres (Mt 6, 1-18): « lorsque vous pratiquez la justice et donnez l’aumône, ne le faites pas devant les gens, mais en secret ; quand vous priez, retirez-vous et priez votre Père en secret; quand vous jeûnez, ne le montrez à personne, mais jeûnez devant votre Père en secret ».
La préface du Carême (préface I) parle aussi de ce contenu plus large du jeûne, bien qu’elle n’utilise pas le mot ‘jeûne’ explicitement : « Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié ; de sorte qu’en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils ». Ce dernier aspect, la plus grande fidélité aux sacrements, nous amène immédiatement au deuxième élément majeur qui émerge pendant le Carême: les sacrements d’initiation du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie.

2. Préparation au baptême
Le deuxième élément typique pour la préparation de Pâques se rattache à la préparation au baptême. Lorsqu’à partir du IVe siècle, le christianisme devint de plus en plus la religion principale de tout l’empire romain, le nombre de chrétiens augmenta également considérablement. Des bâtiments plus grands furent nécessaires pour pouvoir célébrer la liturgie avec autant de monde. Et toute l’organisation de la vie chrétienne, ainsi que des célébrations liturgiques, se développa. Cela vaut également pour la pratique de l’initiation chrétienne, c’est-à-dire les rites par lesquels on devient « chrétien », à savoir : le baptême, la confirmation et la première participation à l’Eucharistie. Dès lors, à partir du IVème siècle une longue période de catéchuménat s’établit, suivie d’une préparation plus intense dans les dernières semaines qui précèdent la Pâques, l’initiation elle-même ayant alors lieu au cours de la nuit pascale. En première instance, l’initiation concernait toujours les adultes. Le baptême des enfants n’entra en vogue que plus tard.
Cette préparation intensive au baptême, au cours des dernières semaines avant Pâques, se faisait pendant 40 jours, donc, durant le ‘Carême’, la période de préparation pour les fêtes pascales. Au début de cette période, les catéchumènes étaient officiellement « choisis » comme candidats au baptême: ils devenaient élus (electi). Pendant cette période, il y avait plusieurs moments de prière (les soi-disant « enquêtes » ou « scrutins » – scrutinia), avec des exorcismes, et les élus recevaient la ‘prière du Seigneur’ (Notre Père), ainsi que le ‘symbole’ (symbolum -> traditio symboli), afin de les apprendre ‘par coeur’. Le matin du Samedi Saint, ils devaient pouvoir réciter le symbolum avec l’évêque (redditio symboli). Il y avait aussi, à plusieurs endroits, le rite « d’ouverture des oreilles » – epphata – afin de mieux comprendre la parole de Dieu. Mais tout ce qui les attendait la nuit de Pâques, ne leur était pas encore dit – cela restait, pour ainsi dire, une surprise. La liturgie est toujours d’abord une expérience… Pendant le Carême, on leur disait juste ce que signifie ‘être chrétien’. Ce n’est qu’au cours de la semaine après Pâques, qu’on leur expliquait ce qui s’était passé dans cette fameuse nuit de Pâques, et surtout ce que tout cela signifiait (mystagogie).
Les catéchumènes, pendant les Eucharisties du Carême, n’étaient autorisés à assister qu’à la première partie de la célébration (la liturgie de la Parole, aussi dite la « liturgie des catéchumènes »). Juste avant la liturgie eucharistique, les catéchumènes étaient renvoyés. A Rome et ailleurs, les passages de l’évangile qui étaient lus au cours des deux premiers dimanches de Carême, furent celui sur l’épreuve de Jésus dans le désert (jeûne avec Jésus) et celui de la transfiguration sur la montagne (figurant deux autres personnes qui jeûnaient spécifiquement: Moïse et Élie). Les trois autres dimanches, dans diverses églises, étaient lus les passages de l’Évangile que nous entendons encore aujourd’hui dans l’année A : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits (Jean 4), la guérison de l’aveugle-né (Jean 9) et le résurrection de Lazare (Jean 11). Dans ces trois passages, l’accent est mis respectivement sur l’eau, la lumière et la résurrection. Dans l’Eglise de l’antiquité chrétienne, le baptême avec de l’eau, qui fait naître à la vie nouvelle, était aussi appelé « illumination » (photismos – illuminatio). Les catéchumènes étaient alors désignés comme photizomenoi ou illuminandi: « ceux qui doivent être éclairés ». Les cinq lectures évangéliques citées précédemment sur (1) l’épreuve dans le désert et le jeûne, sur (2) la transfiguration et sur (3) l’eau, (4) l’illumination et (5) la résurrection, explicitaient cette période du jeûne, et préparaient plus spécialement les catéchumènes élus à l’initiation chrétienne qu’ils allaient recevoir durant la nuit pascale.
3. La pénitence
Le troisième élément qui a façonné le Carême actuel est la pratique chrétienne de la pénitence. Cette pénitence est à son tour étroitement liée au baptême. Après tout, par le baptême, tous les péchés sont pardonnés à la personne baptisée (nous croyons aussi en « un seul baptême pour le pardon des péchés » – unum baptismum in remissionem peccatorum). Cependant, au fil du temps, on vit tout de même pas mal de chrétiens baptisés retomber dans le péché (sérieux). Et cela posait problème pour l’Église. Ne devait-elle pas avoir pitié de ces pécheurs, et leur offrir de nouveau le pardon de Dieu ?
Au cours du IVe siècle, une nouvelle pratique émergea selon laquelle les pécheurs, une fois dans leur vie et pendant un certain temps, pouvaient se réconcilier avec Dieu et l’Église en faisant pénitence. Au début du Carême (le jour que nous appelons maintenant “Mercredi des Cendres”), ils devinrent officiellement des “pénitents” (“ordination” comme pénitents). Ils confessaient ouvertement leurs (grands) péchés, recevaient un sac et avaient souvent aussi des cendres éparpillées sur leur tête (cf. l’Ancien Testament « dans le sac et les cendres »). A Rome, au cours d’une procession, une antienne était chantée : “Changeons nos vêtements, mettons-nous cendres et pénitence, jeûnons et pleurons” (Immutemur habitu, in cinere et cilicio, ieiunemus et ploremus) – cf. Joël 2, 13, un refrain que l’Église chante encore aujourd’hui pendant la pose des cendres. Ensuite, les pénitents étaient renvoyés et exclus de la communauté pour faire pénitence. Enfin, le Jeudi Saint, ils recevaient l’absolution de l’évêque et étaient réconciliés avec Dieu et la communauté ecclésiale (reconciliatio). Cela leur permit de participer à l’Eucharistie pour la première fois à Pâques, avec les nouveaux baptisés.
De plus en plus de croyants pieux désiraient également participer à cette pratique de pénitence – sans devenir officiellement des pénitents. Cette dernière pratique de piété finit par prévaloir. Depuis la Rhénanie, au début du Moyen Âge, on vit apparaître la pratique de mettre de la cendre sur les têtes de tous les croyants, le jour du mercredi des Cendres (feria IV cinerum). Lorsque l’ancienne pratique chrétienne de la pénitence publique disparut, une nouvelle forme de pénitence fut de plus en plus introduite (une pratique qui est venue avec les moines irlandais qui étaient missionnaires en Europe): une confession personnelle (confessio) avec un prêtre (quelque chose qui ne se faisait pas une seule fois, mais qui pouvait être répétée), avec une forme personnelle de pénitence (paenitentia), qui correspondait à la gravité du péché, immédiatement suivie d’un pardon personnel (absolutio). Cette confession personnelle ou « d’oreille » fut finalement rendue obligatoire annuellement en 1215 (IVe Concile du Latran), afin que les fidèles – qui allaient communier de moins en moins – puissent ainsi remplir une autre obligation : la Communion pascale.
Le contenu de la liturgie des quarante jours
Tous les textes liturgiques (à la fois dans la messe et dans la liturgie des Heures – et même la bénédiction de table actuelle du rituel romain) respirent encore aujourd’hui ces trois éléments constitutifs du Carême: le jeûne, la préparation au baptême et la pénitence. Au cours des siècles, l’élément de la préparation au baptême s’est quelque peu évanoui, et celui du jeûne et de la pénitence est ainsi devenu plus important. Mais le renouveau liturgique de Vatican II a de nouveau pleinement mis en lumière l’élément du baptême dans le Carême, en donnant, entre autres, une place claire aux lectures de la préparation baptismale des troisième, quatrième et cinquième dimanches de l’année A; (pour les années B et C, ces lectures peuvent également être choisies, surtout s’il y a des catéchumènes).
Il est très gratifiant de se laisser nourrir par la liturgie du Carême. Les textes liturgiques de ce temps fort nous montrent que : 1. Le jeûne (auquel y sont associées la prière et la justice-miséricorde, comme l’aumône), 2. la pénitence et 3. la préparation au baptême sont avant tout affaire de cœur, processus intérieur qui nous change profondément. « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour » (Joël 2, 12 – première lecture le mercredi des Cendres). Le Carême a été vu dès le début, comme un « temps favorable », comme un « jour du salut » (cf. 2 Co 6, 2, deuxième lecture le mercredi des Cendres – pendant des siècles ce passage paulinien fut lu le premier dimanche de Carême).
Nous rencontrons d’abord ce chemin du cœur dans les paroles des chants liturgiques. Ces chants dans les livres liturgiques comprennent : l’antienne à l’entrée et à la communion (et l’Introït, l’offertoire et la communio du Graduale Romanum), le Psaume responsorial et le verset avant l’Évangile, et dans la liturgie des Heures – en plus des psaumes fixes – les antiennes et les hymnes. Le thème qui revient dans ces chants est le suivant : dans notre faiblesse et notre état de pécheur, nous sommes complètement dépendants de Dieu qui, dans sa justice, nous montre miséricorde et nous redonne ainsi notre dignité. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais veut que le pécheur se repentisse et vive. A cette fin, Il donne au pécheur un cœur nouveau et pur, une volonté plus forte, un esprit résolu. Et le Seigneur nous invite à être miséricordieux, comme le Père céleste, qui veut la miséricorde plutôt que le sacrifice. De plus, le thème de la préparation au baptême revient aussi régulièrement : « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau » (Is 55, 1), « Le Seigneur est mon berger, …Il me mène vers les eaux tranquilles » (Ps 22), « je vous donnerai un esprit nouveau » (Ézéchiel 36, 26). Au total, les chants liturgiques de cette période se caractérisent par un certain sérieux, une forte intériorisation, mais aussi une consolation et même une certaine joie (pensez, par exemple, au quatrième dimanche qui, selon le premier mot du chant d’ouverture Laetare, nous dit : « réjouissez-vous »), mais sans le joyeux « Alleluia » qui reste entièrement réservé à Pâques. L’introduction au missel exige donc aussi que la musique ne sonne que pour accompagner le chant, et qu’elle reste donc modeste ; de plus, il n’y a pas de décoration florale à l’autel (à l’exception du quatrième dimanche, dimanche Laetare).
Ensuite, bien sûr, il y a les autres textes de prière liturgique (qui sont aussi chantés, mais qui ne sont tout simplement pas un ”chant”) : il s’agit, dans la messe, de la prière d’ouverture (collecta), de la prière sur les dons et de la prière après la communion, ainsi que la préface – en plus, le nouveau missel (2002) a une nouvelle prière sur le peuple (oratio super populum) pour chaque jour de Carême, avant la bénédiction. Dans la liturgie des Heures, ce sont principalement les intercessions et la prière d’ouverture de la messe, maintenant avec la fonction de prière de clôture. Toutes ces prières parlent de la lutte de l’homme contre le mal et le péché, une lutte qu’il ou elle rencontre dans sa propre vie. L’homme aspire à la purification et au renouvellement, mais ne peut pas suivre ce chemin lui-même – la faiblesse humaine est trop grande. De cette façon, nous expérimentons en tant qu’humains que nous ne pouvons pas exister sans Dieu, et Il nous enseigne étape par étape à vivre selon Sa volonté. Encore et encore, cette pensée revient : le jeûne et la pénitence sont des signes extérieurs, des choses que nous nous sommes imposées (et qui souvent sont trop difficiles à accomplir), mais les fruits qu’ils portent sont des fruits intérieurs – et donc, de jour en jour, les prières liturgiques demandent à Dieu que cette pénitence extérieure nous change de l’intérieur. Et bien régulièrement, le thème de la préparation au baptême revient : dans de nombreuses prières, il est demandé à Dieu de nous délivrer, par cette pénitence, de la mort, maintenant que les fêtes pascales s’approchent – ce grand moment où, par notre baptême, ou sa commémoration, nous serons complètement renouvelés.
Temps de la passion
Le lundi de la cinquième semaine de Carême, commence une période plus centrée sur la commémoration de la souffrance et de la mort de Jésus : le soi-disant Temps de la Passion. La Grande Semaine Sainte est la dernière semaine avant Pâques. Mais dans la tradition liturgique, l’avant-dernière semaine de Carême est davantage dominée par la dimension de la souffrance que par le caractère de « préparation au baptême ».
Les chants liturgiques et les textes de prière changent de ton dans les deux dernières semaines avant Pâques, à la fois dans la messe et dans la liturgie des Heures. Les hymnes, en particulier, parlent de la souffrance de Jésus et du sacrifice de sa vie – parfois explicitement dans les textes du Nouveau Testament, parfois implicitement, notamment dans les passages de psaumes de l’Ancien Testament. Dans la liturgie des Heures, les hymnes bien connus sur la souffrance sont maintenant chantés : la Vexilla regis et le Pange lingua. Les textes de prière font également de plus en plus référence à la souffrance et au sacrifice de Jésus, en particulier dans les préfaces. C’est donc bien dans ces deux semaines de la Passion que les chants sur la passion ont lieu d’être.