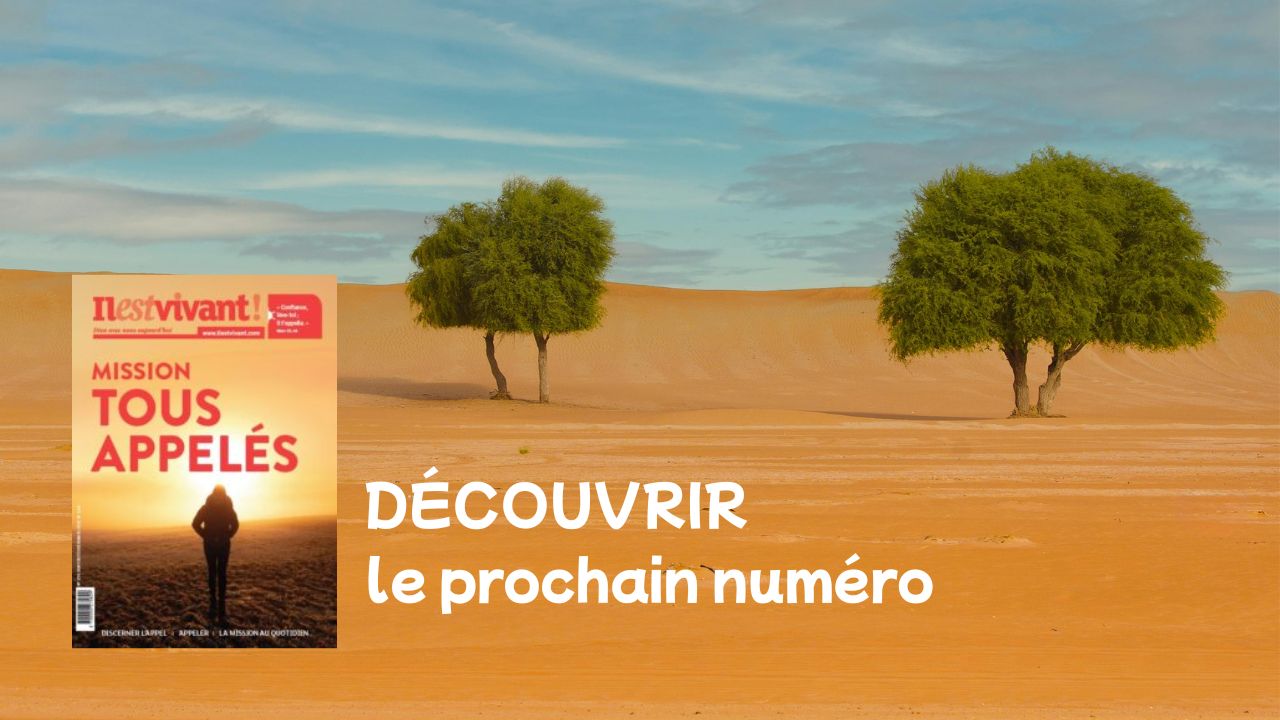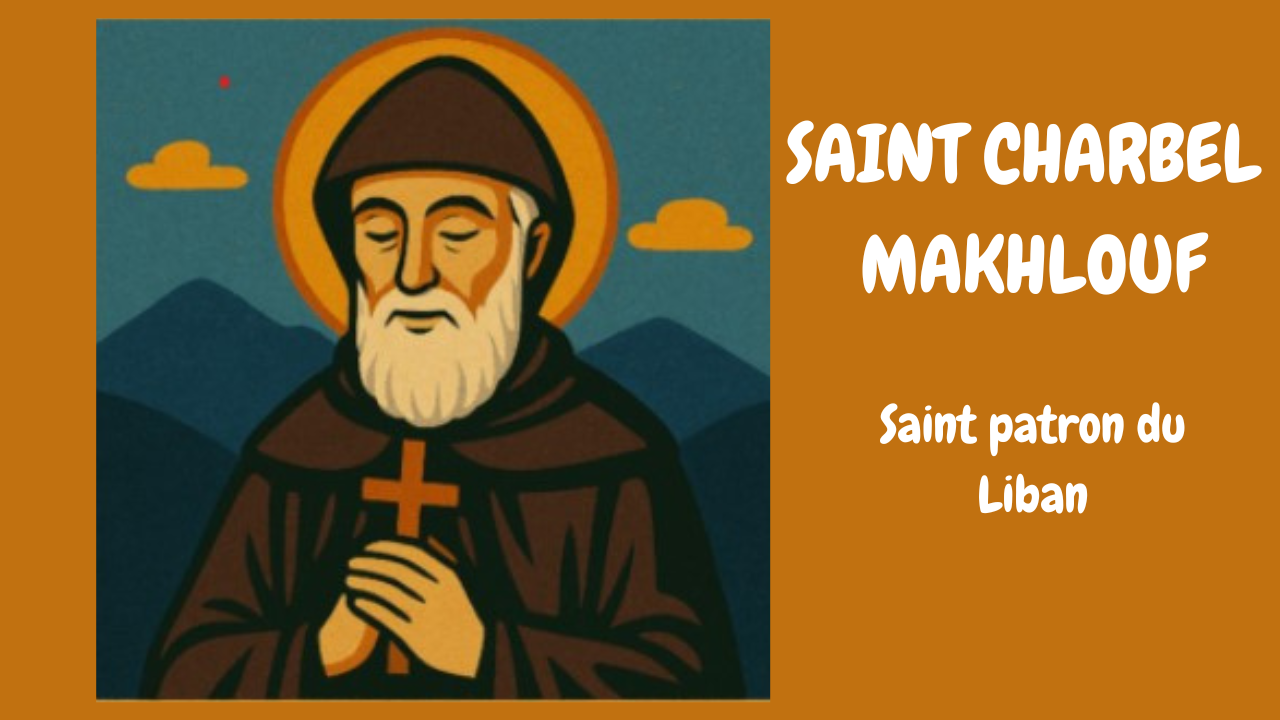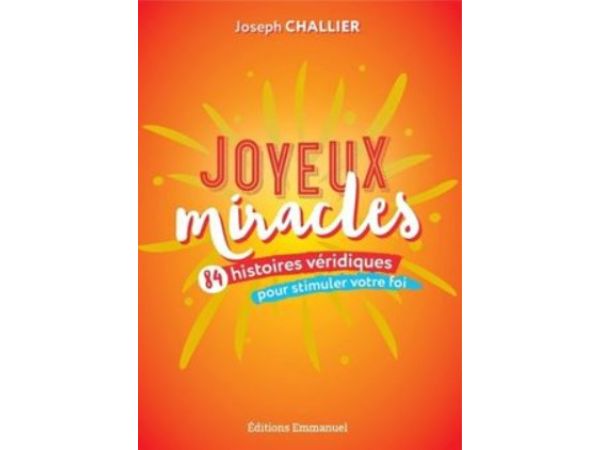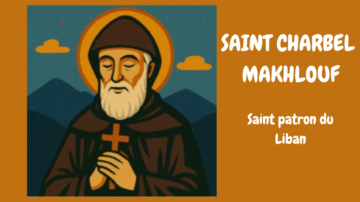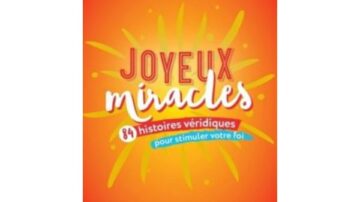Comment sont formés les séminaristes en 2024 ? Il y a 8 ans, était publié par Rome un texte normatif sur ce sujet, qui distingue notamment avec insistance la logique des études de celle du discernement.
Par Erwan Simon
Cet article est paru dans la revue Il est vivant! n°363
Depuis 2016, le Dicastère pour le clergé a entamé une profonde refonte de la formation des séminaristes, à la lumière des enjeux actuels pour l’Église et pour le monde, à travers la publication d’un texte normatif, la Ratio Fundamentalis. Ce document a été intégré ensuite au niveau national par les conférences épiscopales. La Ratio a pour but d’offrir aux séminaires et maisons de formation la réflexion et le cadre pour une formation renouvelée et harmonisée des candidats au sacerdoce. Les auteurs ont mis l’accent sur des points très importants, tirés de l’expérience internationale et des relectures des dernières années, afin que soient préparés des prêtres capables de vivre leur appel de manière heureuse et généreuse.
Une formation intégrale
Rome insiste sur le caractère intégral et intégrant de la formation. Il ne s’agit pas d’empiler ou de juxtaposer de la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale, mais bien d’articuler quatre dimensions d’une unique formation, toutes essentielles, au rythme de la liberté et de la croissance personnelle du candidat, dans une perspective de communion et de mission. Cela demande disponibilité intérieure et acceptation du temps, de sorte que la réponse d’un jeune homme à l’appel de Dieu saisisse progressivement tout son être, son histoire, ses sentiments, ses désirs, son affectivité, son intelligence, ses pensées… Le but n’est pas seulement d’avoir une tête bien faite, mais un cœur qui se laisse façonner par l’ordinaire des jours et des médiations humaines, dans lequel Dieu travaille.
Un cheminement par étapes
Jusqu’à présent, il était question de cycles d’études (premier cycle de philosophie et second cycle de théologie). L’insistance était alors portée sur la dimension intellectuelle. Rome encourage désormais à distinguer la logique des études de celle du discernement. Chaque séminariste est appelé à franchir de manière personnelle, les étapes successives qui conduisent à l’ordination sacerdotale. Les formateurs ont pour mission d’accompagner et de reconnaître le franchissement de ces étapes.
• L’étape propédeutique permet au candidat de se déterminer de manière libre et confiante pour entrer en formation au séminaire.
• L’étape de formation du disciple missionnaire vise l’intégration de la vie baptismale et missionnaire dans la vie du séminariste.
• L’étape de configuration au Christ Pasteur prépare au ministère à venir du prêtre, en apprenant à être avec Jésus un bon pasteur auprès de ceux vers qui il sera envoyé.
• L’étape de synthèse vocationnelle marquée par les ordinations diaconale et sacerdotale déploie l’intégration progressive des nouveaux ministères dans le concret d’une vie ordinaire, donnée et vécue dans la disponibilité à l’Esprit Saint.
Une formation résolument missionnaire
Dans le sillage d’Evangelii Gaudium, le document phare du pontificat du pape François sur la mission au cœur de l’Église, la Ratio insiste pour que se forment de futurs missionnaires “en sortie”, capables d’être accessibles et donnés, au service du Christ et de l’annonce explicite du salut. Cela imprègne et unifie toutes les dimensions de la formation. Il s’agit d’avoir des temps et des moments concrets de missions, mais aussi d’être missionnaire au quotidien, d’entrer dans l’intelligence de la mission, d’intégrer le discernement pastoral pour faire connaître et aimer Celui qui est « le chemin, la vérité et la vie ».
Un maître-mot : la docibilitas
Ce terme de saint Bernard met en lumière la condition et le fondement de toute authentique formation au sacerdoce. Selon Mgr Patron Wong, qui a beaucoup œuvré à la dernière Ratio romaine, la « docibilitas signifie non seulement la confiance vis-à-vis du formateur, assez passive finalement, mais aussi l’aptitude à vouloir être éduqué, vouloir ‘apprendre à apprendre’, attitude beaucoup plus active et qui fait entrer dans un processus d’autoformation qui durera toute la vie : apprendre du maître intérieur, de ses frères, de l’Église ».
Pour les formateurs de la communauté de l’Emmanuel, ces accents sont des boussoles guidant leur recherche constante d’ajuster la formation donnée à chaque séminariste, afin de permettre à celui-ci d’acquérir des savoirs nécessaires, mais surtout, une disposition intérieure fondamentale pour la suite. Plusieurs défis se présentent aux formateurs :
• Accueillir des jeunes zélés, généreux, pleins de talents
Il s’agit de les accompagner en leur permettant à la fois de mettre à profit les talents qu’ils ont reçus et d’apprendre à devenir disciples du Christ, au travers d’un cheminement intérieur traversé par le mystère de sa mort et de sa résurrection. Sans pélagianisme volontariste ni fidéisme démissionnaire, chacun des jeunes est appelé à se déterminer en liberté, dans la conscience de sa fragilité et de la nouveauté transformante de la grâce de Dieu. « C’est ce que dit l’Écriture : “Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce” » (Jc 4,6).
• Œuvrer dans une Église en transformation
L’Église connaît une mue étonnante : elle est d’une part marquée par le déclin de la pratique religieuse et la disparition de certains modèles, et d’autre part, elle se trouve stimulée et comme renouvelée intérieurement, notamment par l’arrivée importante de personnes qui ont soif. Repenser la vie pastorale, cultiver la vie fraternelle, nourrir l’ardeur missionnaire sont autant d’enjeux, tandis que les moyens eux, demeurent modestes. Le défi consiste donc à se concentrer sur l’essentiel, à nourrir une disponibilité missionnaire au quotidien. Il s’agit de ne pas se tromper de combats ou de priorités, en restant humbles : « Amen, je vous le dis : vous n’aurez pas fini de passer dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra » (Mt 10,23).
• Cultiver la souplesse par le discernement
Dans le contexte actuel, une qualité est particulièrement requise, la souplesse d’esprit. Cette souplesse est le fruit du discernement opéré dans l’Esprit Saint. Elle permet “d’essayer”, sans crainte de rencontrer les échecs, sans illusion présomptueuse. Elle ouvre à une collaboration constructive qui reconnaît les dons et charismes de l’Esprit chez ses frères et sœurs. Elle se nourrit par une relecture priante régulière. Comme le souligne Mgr Éric de Moulins-Beaufort dans L’Église face à ses défis (CLD, 2020), le discernement est la marque particulière du sacerdoce pour notre temps. Vivifié par les paroles salvatrices du Christ, présentes dans les sacrements qui lui sont confiés (« Je te pardonne tous tes péchés », « Ceci est mon corps, ceci est mon sang »), le sacerdoce conduit la communauté chrétienne en dehors de l’enclos vers les lieux où le Christ l’envoie. « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur » (Jn 10,16).
Depuis la publication du rapport Sauvé
À la suite de la publication du rapport Sauvé, en octobre 2021, des initiatives ont été prises pour prévenir les abus et former les séminaristes de la communauté de l’Emmanuel en ce sens, en complément de ce qui est vécu dans les diocèses : deux membres de la CIASE sont intervenus pour leur présenter le Rapport et ses recommandations ; un week-end de formation des équipes de formateurs des maisons internationales (Namur, Paris et Abidjan), avec les interventions de Jean-Marc Sauvé et Véronique Garnier, a été organisé ; un temps de rencontre et d’échange a eu lieu avec Patrick Goujon, sj, auteur du livre Prière de ne pas abuser (Le Seuil) ; un week-end de formation des formateurs sur les étapes de maturation psycho-affective s’est déroulé récemment. Enfin, les formateurs de l’Emmanuel se mettent à l’écoute des groupes de travail post-CIASE afin d’intégrer progressivement les recommandations votées par les évêques en 2023, comme la mise en place d’une formation sur la cartographie des risques pour les séminaristes.