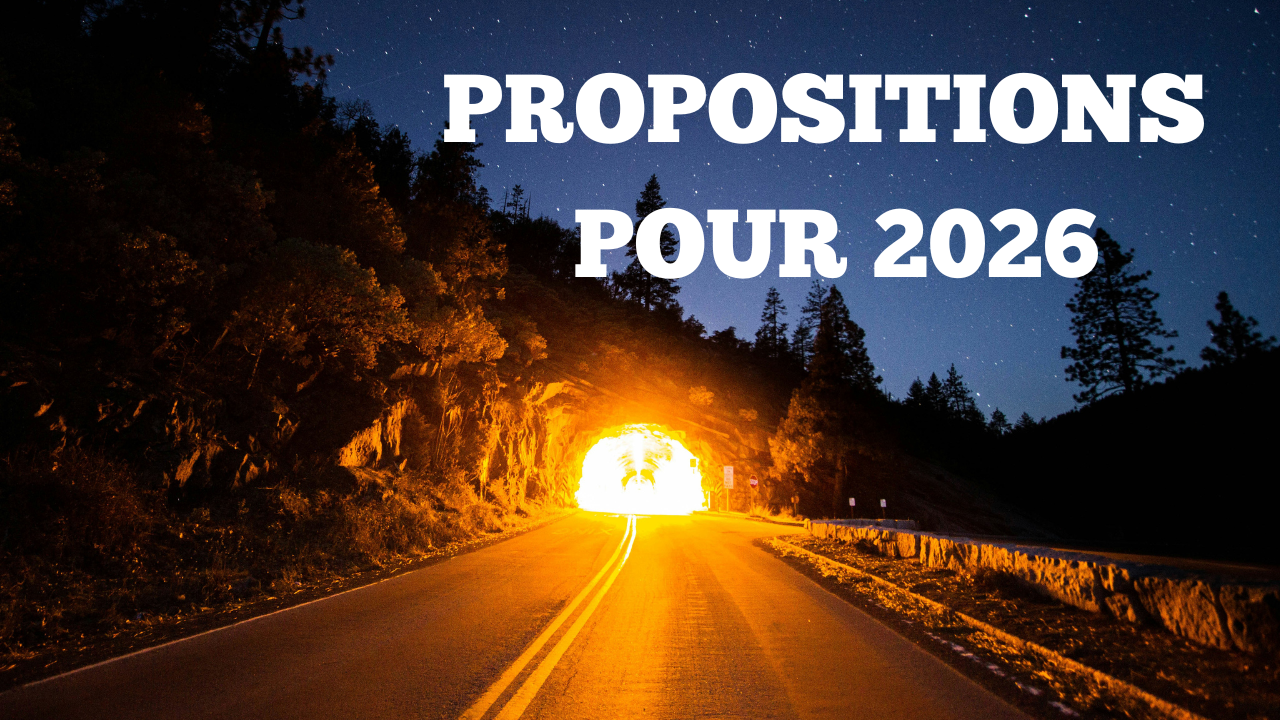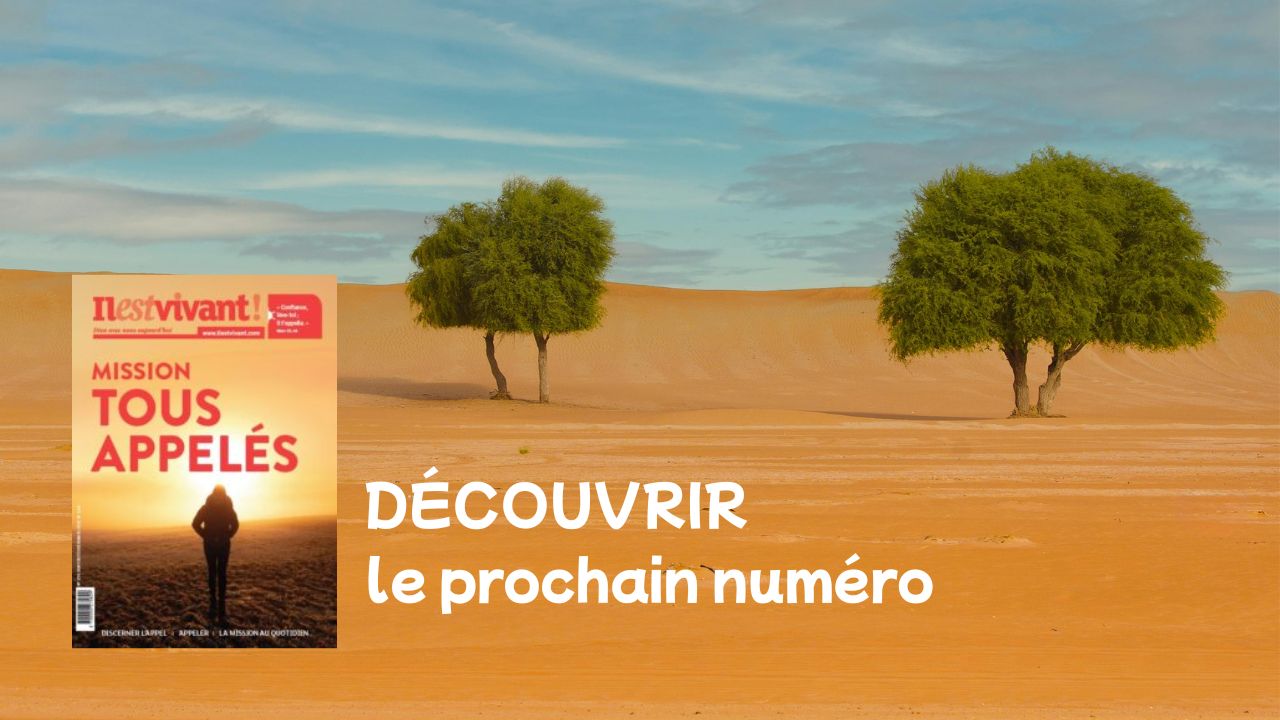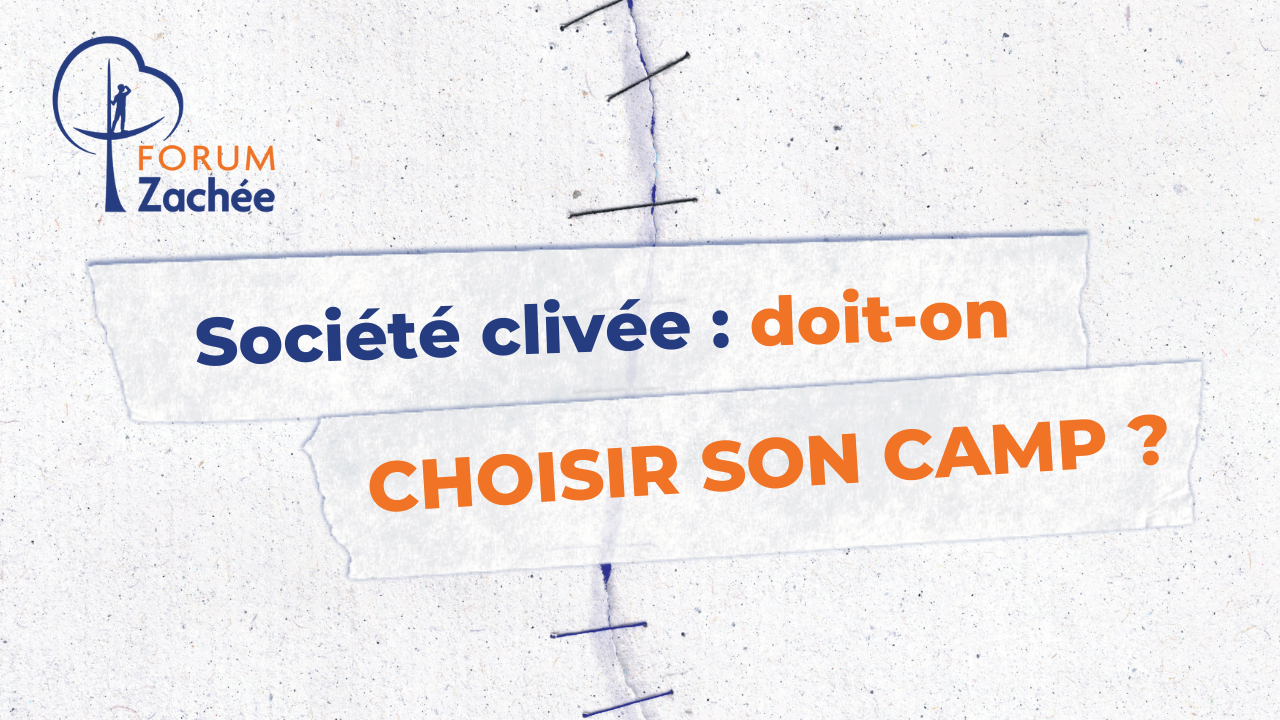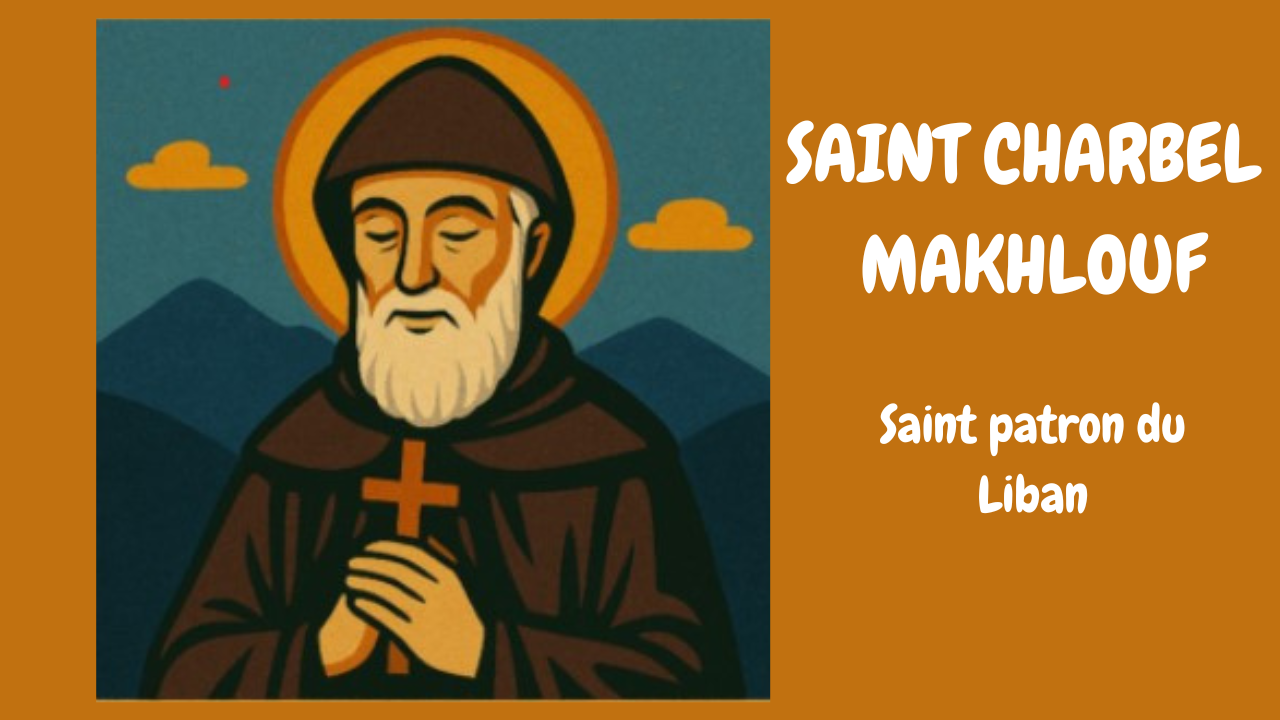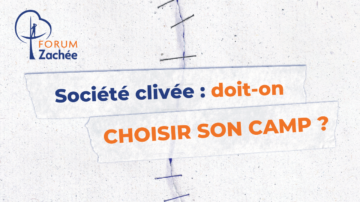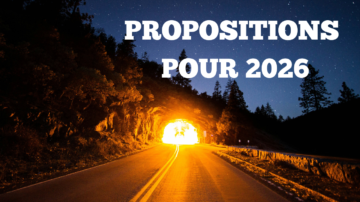Quelle place pour les prêtres dans l'Eglise aujourd'hui ?
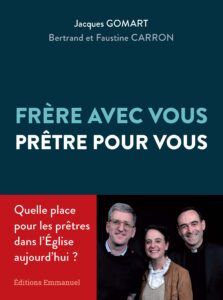 Mêlant réflexion théologique et pastorale avec leur expérience personnelle, le père Jacques Gomart – prêtre de l’Emmanuel depuis 27 ans – et Faustine et Bertrand Carron – mariés depuis 25 ans et membres de la communauté de l’Emmanuel – exposent avec conviction et enthousiasme leur vision du sacerdoce et témoignent de la fraternité baptismale qui les anime.
Mêlant réflexion théologique et pastorale avec leur expérience personnelle, le père Jacques Gomart – prêtre de l’Emmanuel depuis 27 ans – et Faustine et Bertrand Carron – mariés depuis 25 ans et membres de la communauté de l’Emmanuel – exposent avec conviction et enthousiasme leur vision du sacerdoce et témoignent de la fraternité baptismale qui les anime.
Un livre nécessaire à une époque où la place du prêtre est questionnée tant à l’intérieur qu’en dehors de l’Eglise.
Nous publions ici plusieurs bonnes feuilles de ce livre paru aux Editions de l’Emmanuel.
Retrouvez l'interview vidéo de Jacques Gomart et de Faustine Carron
Dans cet extrait, Jacques Gomart s’interroge sur la manière d’appeler les prêtres. Une question qui peut sembler anecdotique mais qui dit pourtant beaucoup de la place du prêtre, la façon dont il se pense comme la façon dont les laïcs pensent la relation avec lui.
MONSIEUR L’ABBÉ, MON PÈRE OU JACQUES ?
Jacques Gomart
Au début d’une nouvelle année scolaire et communautaire, je me rends à la première rencontre de ma nouvelle « maisonnée », heureux de retrouver des frères connus et aussi de nouveaux visages. La porte s’ouvre, sur le visage souriant de Serge, que je découvre :
–Bonsoir mon père, sois le bienvenu !
–Bonsoir, merci de m’accueillir chez toi ! Je m’appelle Jacques.
–Je préfère dire « mon père » : j’ai un grand respect pour le sacerdoce !
–Heureux de te l’entendre dire, car moi aussi ! Mais, dans la maisonnée, je préfère être appelé par mon prénom, « Jacques », comme frère de communauté. Frère prêtre, mais frère : cela m’aide à me situer de façon juste. Et ça peut aussi aider les autres frères et sœurs.
–Ah… Ça me sera difficile ! Mais, bon, puisque tu me le demandes, je veux bien essayer !
« Comment faut-il vous appeler ? » Question souvent posée aux prêtres, a fortiori dans une « société liquide », où les repères communs s’estompent et avec eux un langage partagé, attribuant à chacun une place déterminée et un rôle social reconnu. Selon les lieux et la coutume locale, selon l’éducation reçue et les expériences vécues, le curseur se déplace sur la règle des appellations possibles. En France, au classique « monsieur l’abbé » adressé aux prêtres diocésains dans la plupart des paroisses, s’est souvent substitué le « père » ou « mon père » traditionnellement adressé aux religieux prêtres. L’influence du scoutisme, au sein duquel les premiers aumôniers ont souvent été des religieux, conjointe à celle de la conscription et à l’appellation « père » ou « padre » utilisée pour les aumôniers militaires, a sans doute joué un rôle en ce sens. Quoi qu’il en soit de ces variations sémantiques, il est intéressant de remarquer que la signification est exactement la même : « abbé » provient en effet de l’araméen abba (proche de l’abouna qu’utilisent aujourd’hui encore nos frères chrétiens de langue arabe au Proche-Orient) et de la racine sémitique ab’ qui désigne… le « père », dérivé français du pater des langues latine et grecque.
La question peut paraître anecdotique, et il ne s’agit pas en effet d’en majorer l’importance sur un plan protocolaire. Force est de reconnaître cependant qu’elle touche à notre réflexion sur la façon d’être prêtre aujourd’hui, car l’appellation qualifie la relation. Elle indique une position de l’un par rapport à l’autre, elle exprime une compréhension de la vocation des interlocuteurs et du plan de leur interaction : « Dis-moi comment tu m’appelles et je te dirai qui je suis pour toi », en quelque sorte. Que l’appellation qualifie la relation, les amoureux le savent bien par exemple, eux qui s’appellent en des termes affectueux, souvent assez éloignés de l’objectivité de leur état civil…
Le thème de l’appellation et du nom donné est par ailleurs éminemment biblique. D’Adam nommant les animaux dans le jardin d’Éden (cf. Gn 2, 19) au « nom nouveau que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit » (Ap 2, 17) dans le livre de l’Apocalypse, il traverse toute l’Écriture sainte. Pensons aux changements de nom qui traduisent une mission reçue, voire une conversion vécue : Abram devenant Abraham, Saraï devenant Sara, Jacob devenant Israël, jusqu’à Simon appelé désormais Pierre par Jésus, sans oublier Saul devenant Paul. Pensons aussi à la rencontre de Marie-Madeleine avec celui qu’elle prend pour un jardinier au matin de Pâques : n’est-ce pas lorsque Jésus l’appelle par son prénom qu’elle «se retourne » intérieurement et reconnaît le Ressuscité ? (cf. Jn 20, 16).
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. (Is 43, 1)
Ainsi, dans la Bible, donner un nom, c’est donner ou dévoiler une identité. C’est aussi avoir autorité sur la réalité ou sur la personne ainsi désignée, car c’est manifester la connaissance qu’on en a. Et c’est pourquoi le Nom de Dieu est imprononçable dans la tradition juive : qui pourrait prétendre donner son identité à Celui qui est de toute éternité ? Qui oserait affirmer une autorité sur le Créateur du ciel et de la terre ? Le connaître dans toute l’étendue de son mystère ? « HaShem » en hébreu, littéralement « Le Nom » est ainsi devenu une expression habituelle pour désigner indirectement Dieu lui-même. Celui qui se révèle à Moïse au buisson-ardent (cf. Ex 3) répond en effet à la question sur son nom par une formule mystérieuse, que l’on peut traduire par « Je suis celui qui est », ouvrant la voie à une interprétation métaphysique, dont la postérité ne s’est pas privée. Ou bien encore « Je suis qui je serai », dans une perspective de révélation historique, au sens où les événements à venir manifesteront son identité de Sauveur et de Père du Peuple d’Israël, à la fois protecteur et nourricier, lors de son exode d’Égypte en Terre promise. Au temps de Jésus, seul le grand-prêtre prononçait une fois par an le nom divin, seul dans le « Saint des Saints », au cœur du Temple de Jérusalem, lors du Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Un tel contexte met en relief la parole de l’ange dans le récit du songe de Joseph, sous la plume de Saint Matthieu : « Tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Dimension inouïe du mystère de l’Incarnation : c’est un homme qui donne son nom au Fils du Très-Haut, au Fils de celui dont le nom ne se prononce pas ! Joseph reçoit ainsi une autorité paternelle temporelle sur le Fils éternel du Père éternel…
Ce contexte biblique et liturgique permet d’entrer plus avant dans l’intelligence de la recommandation de Jésus : « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ » (Mt 23, 9-10). Jésus s’adresse ainsi « aux foules et à ses disciples », alors qu’il les invite à observer l’enseignement des scribes et des pharisiens, donné depuis «la chaire de Moïse », mais sans agir « d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas » (cf. Mt 23, 1-12). Tout en reconnaissant la légitimité de leur ministère d’enseignement de la Torah reçue de Dieu par Moïse au mont Sinaï (cf. Ex 19-20), Jésus dénonce leur attitude, qu’on pourrait qualifier, avec une pointe d’anachronisme, de « cléricalisme » :
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment à recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. (Mt 23, 5-8)
La mise en garde est claire. La charge d’enseignement de la parole de Dieu peut amener subrepticement ceux qui l’exercent à «se prendre pour Dieu », en s’appropriant peu ou prou les marques de respect et d’adoration qui reviennent à Dieu seul. En transposant à notre contexte actuel, pour les prêtres qui reçoivent avec le sacrement de l’ordre la sacra potestas, le «pouvoir sacré», de consacrer le pain et le vin en Corps et Sang du Seigneur, et, sous l’autorité de l’évêque, le «pouvoir » de pardonner les péchés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il peut y avoir le risque et la tentation de passer de ce pouvoir reçu pour le service de l’Église à une appropriation autocentrée du pouvoir pour soi-même, qui ouvre alors la porte à toutes les formes d’abus. « J’ai reçu un pouvoir pour les autres » n’équivaut pas à : « J’ai le pouvoir » …
Dans ce deuxième extrait, Faustine Carron nous propose une réflexion sur l’altérité entre les hommes et les femmes. Bonne et voulue par Dieu, elle est à la fois un défi et une source d’émerveillement. Faustine nous invite à approfondir la figure de la soeur comme une belle réalité pour parler du rapport du prêtre avec les femmes.
L’ALTÉRITÉ VOULUE PAR DIEU
Faustine Carron
Jacques a ajouté au titre de cette partie un point d’interrogation, pour signifier combien la notion de « mise à part » ne va pas de soi et peut être source de confusion. Il en a ensuite expliqué le véritable sens de manière profonde et claire.
Je voudrais quant à moi vous parler à mon humble place, dans cette mise à part, de la relation homme/ femme que vit le prêtre tout au long de son ministère.
Les alliances que Dieu à initiées rendent compte de qui il est, mais sont aussi là pour qu’une grande fécondité puisse en découler. L’altérité des autres et du Tout Autre est un processus qui nous décentre et donc demande effort et courage, mais c’est à ce prix que nous nous trouvons nous-mêmes et que nous trouvons nos vraies joies. Au commencement, Dieu vit que la création de l’Homme, homme et femme, était bonne, et même très bonne. Voilà la contemplation d’un Dieu créateur devant son œuvre ! Cette altérité est voulue, choisie par lui, elle nous est nécessaire.
Le premier péché, qui se répercute sur nous par héritage, rompt la confiance immédiate voulue par Dieu entre l’humanité et lui, rompt cette confiance évidente entre l’homme et la femme, avec pour conséquences la suspicion et la jalousie, et pour terminer rompt l’harmonie entre les êtres humains et la nature, avec pour conséquence l’émergence d’une insatiable volonté de puissance.
L’altérité peut faire violence. Parfois notre premier élan, le plus simple et le plus spontané, est d’aller vers celui qui nous ressemble, qui est comme nous. Mais c’est un mirage, qui, on le sait, peut conduire jusqu’au narcissisme.
Ce n’est pas confortable de se laisser creuser par l’altérité, par cet autre qui n’est pas comme moi, qui sera éternellement pour moi un mystère.
L’altérité a toujours deux faces : un côté lumineux, qui éveille à la curiosité, à l’émerveillement, à la nouveauté et qui parfois nous aide à nous révéler nous-même ; mais également une face plus sombre, car elle déplace nos certitudes, est souvent source d’incompréhension et nous oblige à ne plus maîtriser.
Mais la relation homme-femme, cette altérité voulue par le Créateur, est bonne, fondamentalement bonne. Dans la nouvelle alliance, ceux qui renoncent à ce dessein bon de Dieu dans le sacerdoce, en vue de se donner à tous comme le Christ, ne renoncent pas à l’altérité nécessaire avec la femme. Et j’ajouterais que, si cette altérité n’est pas reconnue, aimée et vécue, je donne peu cher des futures relations d’un prêtre avec les femmes dans la mission.
Le risque vient parfois du prêtre lui-même : mauvais placement de sa part, manque d’« alignement » ou de cohérence (qui se traduit par un décalage entre action, ressentis, paroles et actes), peur qui finira par le mettre en position haute ou en position basse, autoritarisme ou cléricalisme.
Le risque vient aussi pour nous laïcs de ne pas savoir comment nous positionner de manière juste dans notre rapport aux prêtres.
Lorsque Dieu parle à l’homme de sa mission, il lui dit : « Tu quitteras ton père et ta mère. » Cette phrase se situe avant la faille du péché originel. Il est bon que l’Homme quitte son père et sa mère, et c’est même une nécessité pour qu’il se trouve lui-même. Évidemment cette nécessité vaut pour toutes les vocations, et c’est une très bonne chose. Et elle est à comprendre en vis-à-vis du commandement d’honorer son père et sa mère. Cela ne se fait pas sans ajustements progressifs, toujours en vue d’un amour plus libre.
On le comprend aisément pour la vocation du mariage, mais c’est une nécessité aussi pour les prêtres, pour la vie consacrée. Quitter son père ou sa mère pour mieux se donner à tous, pour se rendre disponible.
Il y a de nombreuses années maintenant, j’ai travaillé pour mes étudiants les textes de la grande conférence des Nations unies de Pékin de 1995 sur la femme. Et je suis tombée par hasard sur la lettre de Jean-Paul II aux prêtres le Jeudi saint de la même année, parlant de l’importance de la femme dans la vie du prêtre. Il y aborde la figure particulière de la mère et y intègre particulièrement la figure de Marie comme Mère de Jésus.
Il y parle aussi de la figure de la sœur. Et j’aimerais approfondir un peu plus ce rapport qui me semble essentiel aujourd’hui.
Si les prêtres n’ont pas tous des sœurs de chair, tous ont eu des expériences de mixité qui les ont fait expérimenter l’altérité dont nous avons parlé plus haut.
Je trouve cette réalité très belle pour parler du rapport du prêtre avec les femmes, mais aussi des femmes avec le prêtre. La sœur marque à la fois la proximité de la relation, mais elle révèle aussi un rapport intangible. Le fait de se considérer comme frères et sœurs garde les prêtres comme les femmes d’entrer dans une relation d’exclusivité – comme ça peut être le cas dans l’amitié, avec mon ou ma « meilleure amie » – voire une intimité trop grande.
De cette relation fraternelle découle une pudeur et une chasteté naturelles aussi bien dans le regard, les gestes, les mots et l’attitude. Je l’ai vérifié de nombreuses fois en travaillant très régulièrement avec des prêtres, cela ne laisse aucune ambiguïté et ne m’empêche jamais de reconnaître la paternité du prêtre. Cela demande de n’en[1]voyer aucun signal d’une autre posture. En même temps les liens fraternels sont profonds, et permettent de ne pas entrer dans une certaine séduction qui immédiatement ferait basculer la relation dans un autre ordre. Le lien fraternel permet aussi de pouvoir parler en vérité, sans peur, quand cela nous semble nécessaire tout en gardant un juste positionnement.
Ainsi, la condition de mère et celle de sœur sont les deux dimensions fondamentales du rapport entre la femme et le prêtre. Si ce rapport est établi de manière sereine et responsable, la femme n’éprouvera aucune difficulté particulière dans ses relations avec le prêtre. Elle n’en trouvera pas, par exemple, pour confesser ses fautes dans le sacrement de pénitence. Elle en rencontrera encore moins quand elle entreprendra des activités apostoliques d’ordres divers avec les prêtres. Tout prêtre a donc la grande responsabilité de développer en lui-même une authentique attitude de frère à l’égard de la femme, une attitude qui n’admette pas d’ambiguïté. Dans cette perspective, l’Apôtre Paul recommande à son disciple Timothée de traiter « les femmes âgées comme des mères et les jeunes comme des sœurs, en toute pureté » (1Tm 5,2)1.
Enfin, dans cette dernière bonne feuille, Bertrand Carron témoigne de la nécessaire prudence qui permet de réguler les relations entre les prêtres et les laïcs de manière juste. Le respect du prêtre n’est ni idolâtrie ni exclusion. Si le prêtre est “à part”, c’est ensemble, avec les laïcs, qu’ils forment un corps unique, celui du Christ.
UNE PRUDENCE REGULATRICE
Bertrand Carron
Dans la relation prêtres-laïcs la prudence peut se vivre paisiblement : considérer un prêtre comme « à part », du moins dans une certaine mesure, n’implique pas de l’exclure de nos fêtes, de nos vacances, de nos tables dominicales, de nos moments amicaux et fraternels. Au contraire ! Mais le respect de son engagement vocationnel implique des ajustements dans nos manières d’être ensemble. Il serait malvenu de faire ici une liste des choses à faire et à ne pas faire en présence d’un prêtre. Certaines sont claires, d’autres plus insidieuses. Chacun peut cependant visiter ses relations avec les prêtres qu’il connaît (ou avec les laïcs, s’il est prêtre) : fréquence des rencontres hors travail commun, exclusivité de telle ou telle relation, solidité du couple ou du célibataire qui peut trouver un confident privilégié, lieux où l’on se voit, gestes posés, types d’activités que nous faisons et bien d’autres domaines encore. Un discernement est à poser. Vivons-le sereinement et simplement, mais sachons prendre parfois le temps de questionner et d’ajuster les choses.
Bien qu’il soit crucial de respecter les prêtres, le respect du sacerdoce ne doit pas se muer en idolâtrie. C’est lorsqu’ils deviennent, au nom du Christ, des dons pour les autres, que leur vocation se réalise pleinement. Et pour se donner à tous ils doivent paradoxalement ne pas se dissoudre, se confondre, mais rester solides. Ils ne sont pas « à part » pour s’isoler ou fuir le monde, mais pour, au contraire, dans la prudence et la persévérance, mieux se donner à chacun « à part entière ». Il me semble que nous, laïcs, avons le devoir d’être les gardiens subtils, humbles, discrets, miséricordieux de cet appel qu’ils ont reçu à être prêtres de cette communion fraternelle. Ils sont un peu « à part », mais ensemble nous nous complétons pour former le corps unique, celui du Christ lui-même.
Retrouvez l'interview vidéo de Jacques Gomart et de Faustine Carron
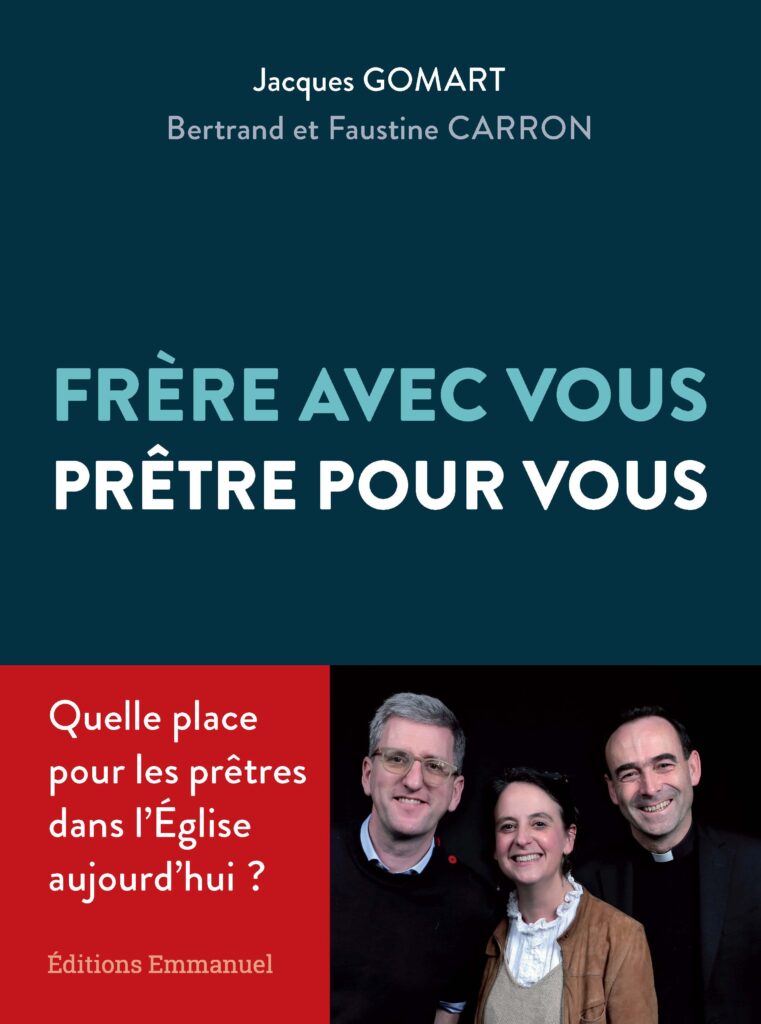
Frère avec vous, prêtre pour vous
Quelle place pour les prêtres dans l’Eglise aujourd’hui ?
Jacques Gomart, Bertrand et Faustine Carron
Editions Emmanuel