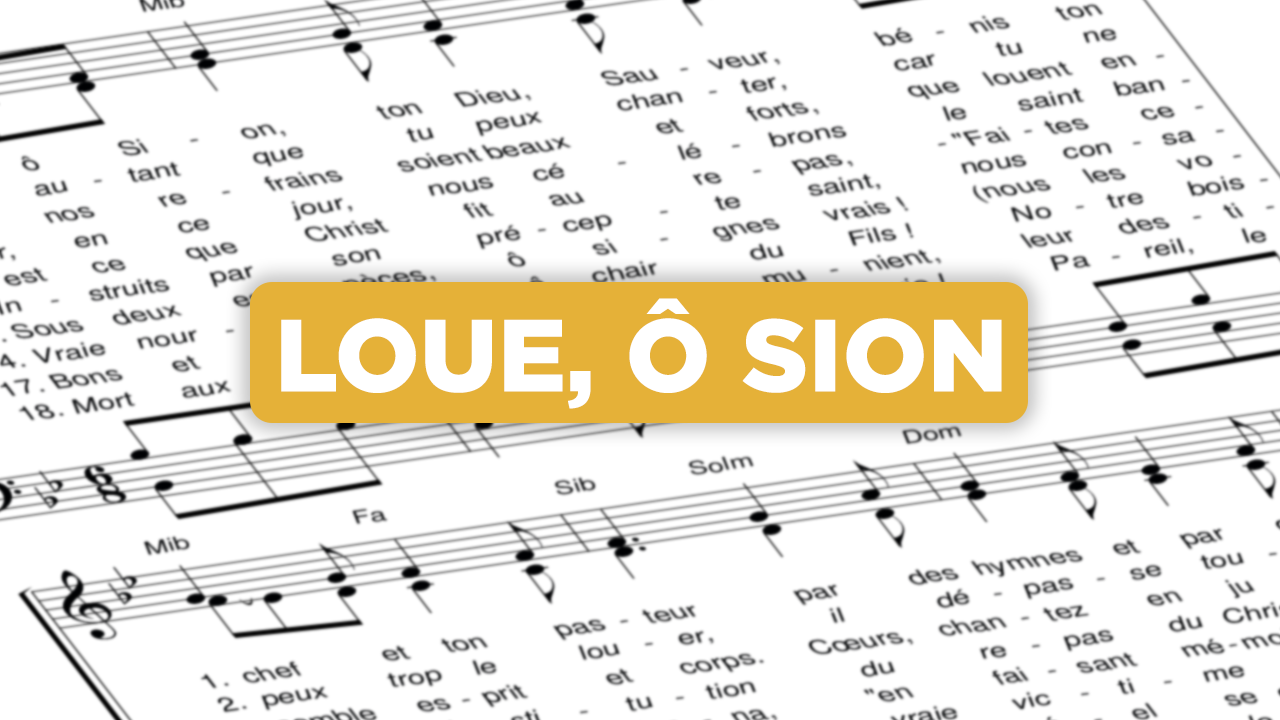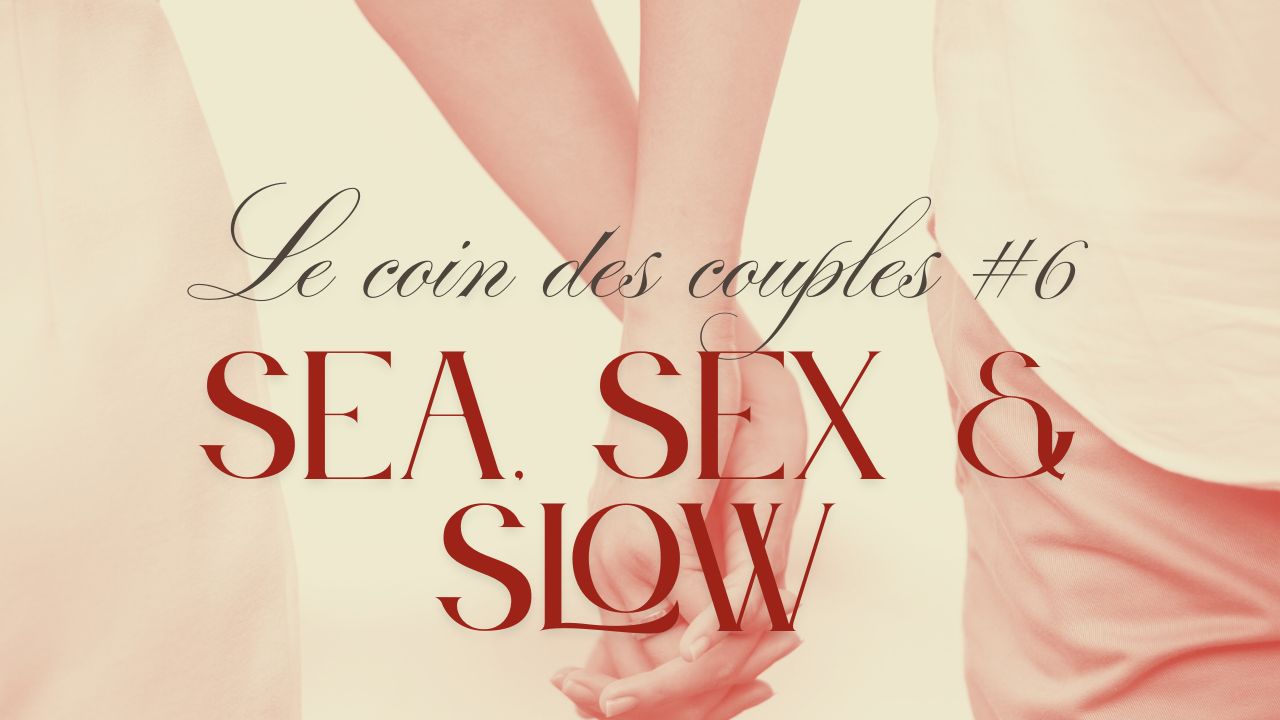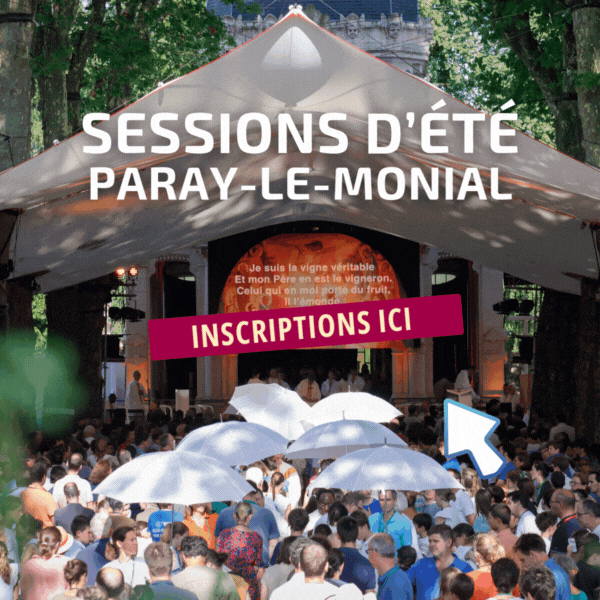Rencontre avec Valérie Régnier Responsable de la Communauté Sant’Egidio en France.
Propos recueillis par LAURENCE DE LOUVENCOURT
Il est vivant ! En octobre 1986, Jean Paul II a suscité une rencontre historique à Assise avec des leaders religieux du monde entier. Quel était le sens de cet événement qui n’a pas toujours été bien compris ?
Valérie Régnier Il faut se souvenir que nous étions en pleine Guerre froide ; de plus, Jean Paul II était polonais : il avait vécu sous le régime communiste, et perdu beaucoup d’amis dans les camps d’extermination pendant la Seconde guerre mondiale. Se demandant pourquoi il avait échappé à la mort, il a compris la responsabilité qui lui incombait du fait d’avoir survécu. Et dans ce monde complexe où les conflits se multiplient, il a eu cette intuition prophétique : Dieu est le Dieu de la paix ; c’est ce qui rassemble toutes les religions ; rencontrons-nous à Assise au nom de la paix. Il ne s’agissait pas de prier ensemble mais d’être ensemble, dans une même ville, pour prier le Dieu de la paix, chacun dans son propre lieu de culte (douze lieux au total le 27 octobre 1986 à Assise) et selon sa propre tradition. Ensuite, réunis sur une même esplanade autour du pape Jean Paul II, les leaders religieux ont lancé un appel commun à la paix. C’était une image très forte, qui a fait le tour du monde.
Et pourquoi à Assise ?
Saint François est une figure respectée bien au-delà du christianisme. Il est reconnu comme l’homme de la rencontre avec tous, même quand cela semble impossible. Un exemple : en pleine croisade, il va d’Assise en Égypte, à Damiette, pour rencontrer le sultan et discuter avec lui et voir s’il n’y aurait pas un terrain d’entente. Il n’y a pas de mur qui tienne avec François ! À son époque, Assise était, comme ses voisines, une cité guerrière : il y avait des conflits sans fin entre elles. Dans cette atmosphère de conflictualité dans laquelle François a lui-même combattu, il se convertit et Assise devient, à travers son influence, la ville de la paix. On comprend donc pourquoi Jean Paul II a choisi de créer cette rencontre en ce lieu.
La Communauté de Sant’Egidio s’est investie depuis 1986 pour que perdure cet « esprit d’Assise ». Pourquoi ?
Dans son discours conclusif en 1986, Jean Paul II a dit que cette rencontre ne devait pas rester sans lendemain. Quand nous avons entendu ces propos du Pape, nous avons décidé de relever le défi et de réitérer une telle rencontre chaque année. Et depuis 1986, nous organisons effectivement chaque année une rencontre interreligieuse et internationale pour la paix, en général dans une ville d’Europe, qui est comme un pèlerinage de trois jours : conférence inaugurale, tables rondes et le dernier jour, la rencontre se conclut par la prière pour la paix. Comme à Assise, les intervenants prient chacun au même moment dans leur lieu de culte ; ils se retrouvent ensuite sur une place publique où ils proclament un appel commun pour la paix. Puis les enfants de l’école de la paix (Communauté de Sant’Egidio) reçoivent cet appel de leurs mains et le remettent aux ambassadeurs et personnalités du monde civil présents. Et tout au long de l’année, les membres de la Communauté entretiennent des relations d’amitié avec ces personnes venues du monde entier. Le 27 octobre 2011, pour le 25e anniversaire d’Assise et à la demande du cardinal Vingt-Trois, nous avons organisé cette rencontre au Trocadéro à Paris avec les représentants de tous les cultes en France.
De quelle façon Benoît XVI et le pape François ont-ils donné suite à l’initiative de Jean Paul II ?
Il y a une vraie continuité entre ces trois papes. En 2007, Benoît XVI est venu à la rencontre internationale pour la paix organisée par Sant’Egidio à Naples, et il a célébré la messe. Pour l’année du 25e anniversaire de la rencontre, le 1er janvier 2011, il est allé à Assise « pour rappeler le geste historique de mon prédécesseur et renouveler solennellement l’engagement de chaque religion à vivre leur foi religieuse comme service pour la cause de la paix ». Le pape François quant à lui a participé en 2016 au 30e anniversaire de l’événement à Assise, avec de nombreux leaders religieux. Il était également présent lors de l’édition 2020, à Rome, le 20 octobre dernier. Il est allé peut-être encore plus loin que ses prédécesseurs puisque, le 4 février 2019, il a publié à Abou Dhabi une Déclaration sur la fraternité humaine avec le cheikh el- Tayeb. Cet imam est la plus haute autorité du monde sunnite en tant que grand imam de l’Université Al-Azhar (Égypte). Cette rencontre et ce texte s’inscrivent pleinement dans l’esprit d’Assise. La déclaration rappelle combien il est important d’exercer la fraternité et que c’est un travail. C’est un don d’accueillir un frère mais pour rentrer dans une relation profonde, cela demande du temps, de la patience. C’est toute l’exigence de la relation entre deux personnes. Enfin, le Pape vient de publier Fratelli tutti, qui s’inscrit pleinement dans l’enseignement social de l’Église et la filiation de Léon XIII, de Paul VI, puis de Jean Paul II. Dans cette encyclique, François montre comment face à la fragmentation du monde et des sociétés, la seule alternative, c’est la fraternité avec tous, même quand cela semble impossible, comme le recommandait saint François.
Dans un monde d’une violence extrême, cette fraternité universelle à laquelle nous appelle le pape François semble justement impossible. Peut-on, tout en restant lucides sur les dangers qui nous guettent, garder le cœur ouvert à l’autre, sans naïveté ?
À Sant’Egidio, cela fait 52 ans qu’on nous dit que nous sommes naïfs de vouloir vivre la paix avec tous ! Cela dit, je comprends cette interpellation. Mais ce n’est pas de la naïveté ! Parmi les pays dans lesquels nous sommes présents ou sommes appelés pour des négociations de paix, certains sont ravagés par une violence extrême. Dans des contextes islamiques ou pas, comme en Amérique centrale, en proie à la violence des maras. Ces groupes mafieux détiennent des quartiers entiers et veulent empêcher les jeunes de faire des études afin qu’ils restent dans l’économie parallèle de la drogue… Au Salvador, un jeune membre de Sant’Egidio, William, 22 ans, a même été assassiné. Responsable bénévole d’une école de la paix, il a sorti beaucoup de jeunes des maras. Il était très proche d’eux. Il a reçu plusieurs menaces de mort et un jour, il s’est fait tuer par ces trafiquants en sortant de chez lui. On peut donc payer de sa vie ce combat pour la paix ! Car il s’agit bien d’un combat. Le savoir peut nous permettre d’accueillir le message du pape François dans toute sa force prophétique.
En quoi est-ce un message prophétique ?
Il serait illusoire de croire que notre pays puisse être préservé de cette onde de violence mondiale qui voit partout de nombreux jeunes tentés par ce que la philosophe Cynthia Fleury nomme « la jouissance de l’obscur ». L’un de nos frères, Mauro, qui travaille au nord du Mozambique, où la rébellion commet actuellement beaucoup de violences, nous dit rencontrer des jeunes qui sont fascinés par le mal. On est face au démon de la violence, qui prospère sur le terrain d’une jeunesse désorientée. Laissés à eux-mêmes, ces jeunes n’ont plus de boussole, et sont ignorants sur le plan religieux. De plus, plongés dans un monde très rapide et compétitif, ils sont en proie à des peurs, qui sont exploitées par des intérêts politiques ou idéologiques via les réseaux sociaux. Entrant directement en contact avec les jeunes, ces idéologues parviennent à former des communautés de rancœur, en recrutant parmi les personnes faibles, les pauvres, les étrangers, etc. Ils les poussent à traduire en actes de haine et de violence nihiliste leur pessimisme et leur résignation. Cela donne les attentats que nous connaissons. On parle aujourd’hui de génération perdue. Le pape François connaît parfaitement cette situation et il est très conscient de cette violence au niveau mondial. C’est pourquoi il affirme que la fraternité avec tous est la seule alternative. C’est cela, son prophétisme. Car que donne le durcissement des rapports humains ? Absolument rien ! Nous le constatons à chaque fois dans nos efforts de négociations de paix sur le terrain. La guerre et les rapports conflictuels sont devenus la norme dans le monde et nous nous y sommes habitués. C’est pourquoi, dans Fratrelli Tutti, le pape François revient sur le concept de guerre juste qu’il condamne définitivement. Notre société génère également beaucoup de violence dans les relations interpersonnelles. Cela fait naître un certain “victimisme” et un ressentiment entre les personnes. La fraternité avec tous, c’est accepter de « vivre ensemble » et même « d’être ensemble », et cela conduit à la paix véritable. Pour y parvenir, commençons par des initiatives locales, chacun à notre niveau !
La fraternité universelle, même avec un djihadiste prêt à répandre la mort ?…
C’est pour cela, hélas, que j’ai parlé de génération perdue. Celui qui est capable de donner la mort de cette façon-là a déjà été “aspiré” par la spirale infernale de la violence. Il s’agit donc d’intervenir en amont, afin d’éviter que les jeunes deviennent capables d’une telle violence. À Sant’Egidio, quand on fait l’école de la paix avec des enfants, on est là, avec eux, et on essaie de leur transmettre un autre regard sur l’autre. À travers de telles initiatives, les jeunes ne sont plus seuls avec leur téléphone. On peut contribuer à inverser le cours des choses, en étant prêt, comme William, à donner notre vie pour la paix. « Le sang des martyrs est semence de chrétiens » (Tertullien). Le pape nous encourage à persévérer dans ce travail patient pour la paix, afin de susciter dans nos pays des communautés d’espérance. Ce n’est pas de la naïveté. Aller dans un quartier sensible pour faire l’école de la paix, emmener les jeunes visiter les personnes âgées, combler leur vide intérieur par l’espérance, c’est un travail difficile, qui suppose d’accepter parfois la confrontation. Alors que petit à petit, pour des raisons budgétaires, tous les corps intermédiaires ont disparu les uns après les autres dans ces quartiers (éducateurs de rue, bibliothèques pour tous, maison de quartier, etc.), il s’agit d’être à leurs côtés et de leur dire : « On vous aime, on vous respecte, on pense que vous vivez dans des conditions qui ne sont pas faciles, on est là pour s’entraider et pour vivre ensemble. » Il s’agit, jeune après jeune, de les arracher à la solitude et au pouvoir d’attraction des communautés de rancœur, de leur apprendre à résister aux logiques du chacun pour soi et du populisme.
Auriez-vous un exemple ?
À Montreuil, une jeune d’un quartier sensible, qui avait un discours très pessimiste, a fait tout un chemin grâce à la visite aux personnes âgées en Ehpad. Pendant le premier confinement, on a écrit aux personnes que l’on avait désormais interdiction de visiter. Or un jour, elle a découvert par hasard que son amie Marie- Louise à laquelle elle continuait d’écrire chaque semaine, était décédée depuis un mois déjà. Cela a été très violent pour elle. Elle a pris conscience que les personnes âgées, pas plus que les jeunes, n’étaient considérées dans notre société. Cet épisode très douloureux l’a aidée à avancer : quittant sa posture de “victime”, elle a commencé à prendre sa vie en main. Elle a eu par exemple le courage pour la première fois de témoigner à ses amies de ses visites aux personnes âgées, espérant en entraîner certaines à l’école pour la paix. Elle avait compris tout l’enjeu de cette amitié entre jeunes et personnes âgées. Cela rejoint ce que dit sans cesse le pape François depuis Evangelii Gaudium : « Les jeunes et les personnes âgées sont l’espérance des peuples. » L’avenir d’une société passe par le respect et la solidarité des jeunes et des personnes âgées. Chacun, nous pouvons apporter notre pierre pour faire grandir la paix, dans l’esprit d’Assise.