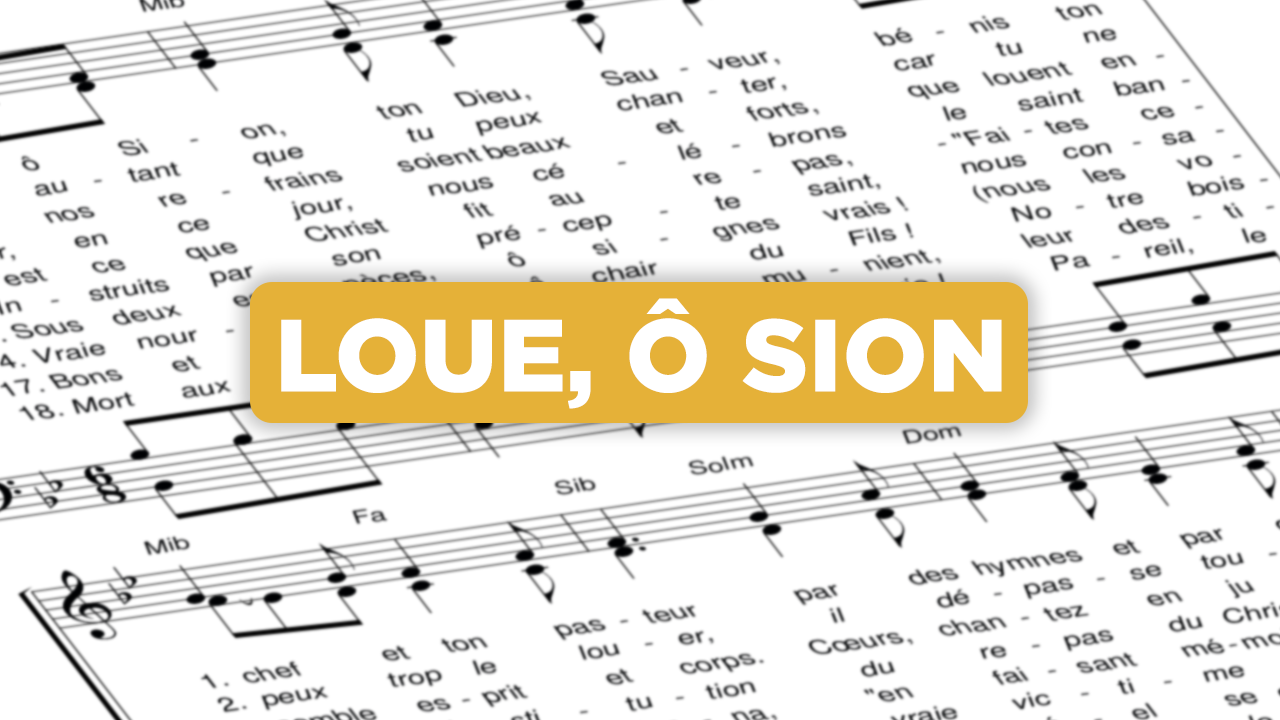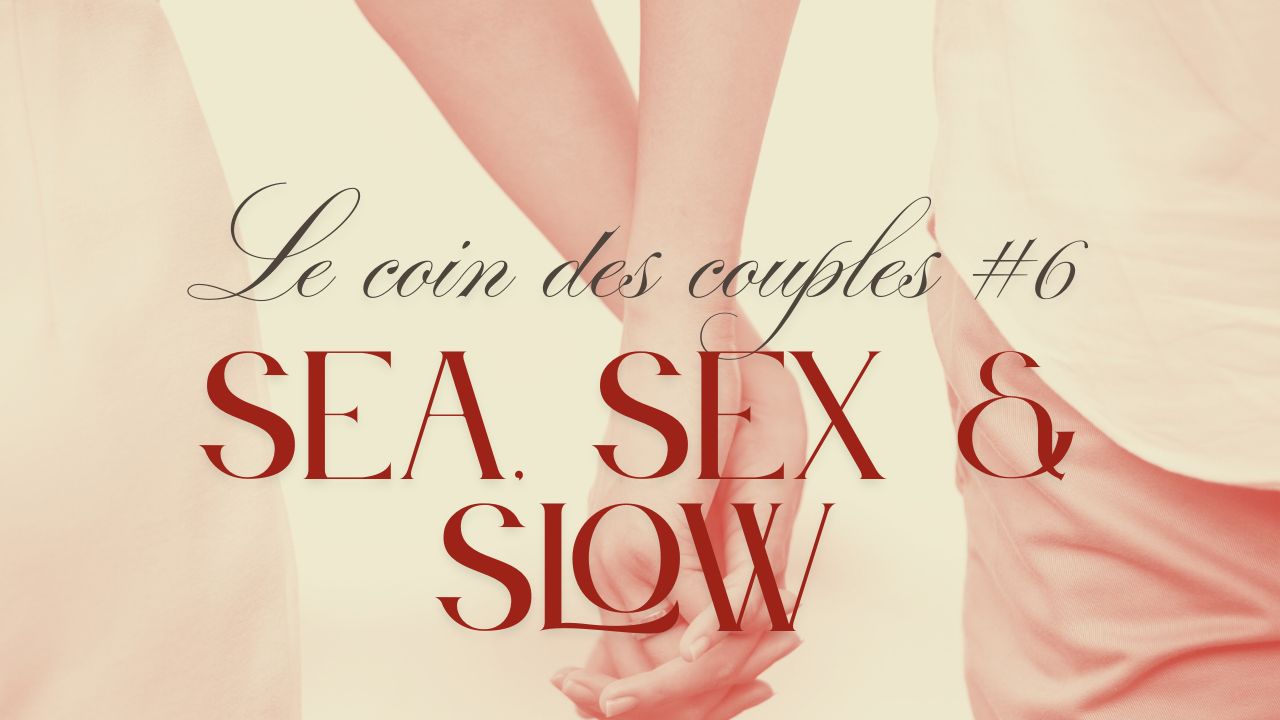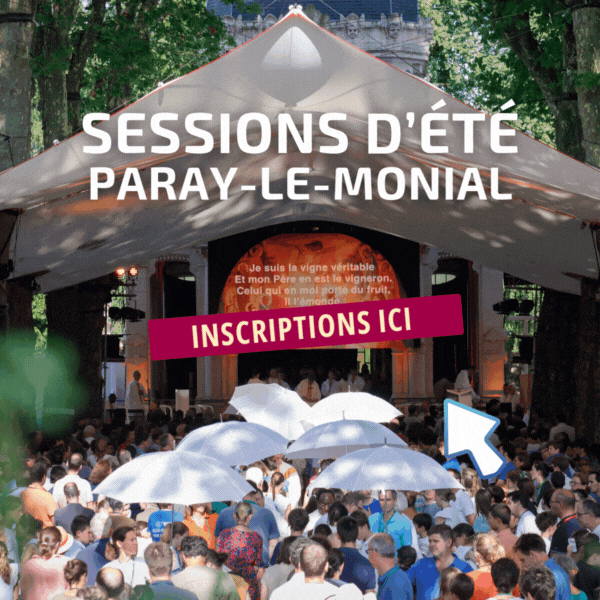Marine Collignon, sous-directrice adjointe de l’environnement et du climat témoigne : « Je choisis de me concentrer sur ce que je peux faire avancer. »
Crise climatique, crise de la biodiversité, pollution : est-il trop tard ? est-ce encore utile d’agir ?
Marine Collignon est sous-directrice adjointe de l’environnement et du climat au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Tout en reconnaissant que les décisions prises ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux, elle affirme, exemples à l’appui, que de réels progrès ont pu être atteints et la situation serait bien pire sans tous les accords internationaux négociés ces dernières années. Et nous exhorte à ne pas nous dérober à notre responsabilité individuelle. Espérer donc agir, agir pour espérer.
Elle sera l’une des intervenantes au Forum Zachée du 9 au 12 mai prochains. Témoignage.

Marine Collignon est sous-directrice adjointe de l’environnement et du climat au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Sa sous-direction suit l’ensemble des négociations internationales relatives à l’environnement et au climat (biodiversité, océans, forêts, pollution plastique, réduction des risques de catastrophes…) en lien avec les différents ministères sectoriels, notamment celui de la transition écologique et de la cohésion des territoires, celui des Finances ou celui de l’agriculture.
Marine Collignon, comment se pose la question de la responsabilité dans votre vie professionnelle ?
Marine Collignon : Pour moi, elle se pose à différents niveaux.
D’abord à un niveau individuel : est-ce que j’agis en cohérence dans ma vie personnelle avec ce que je porte dans les instances internationales et ce que je défends dans ma vie professionnelle ?
Ensuite, la question se pose au niveau interministériel. Le Ministère des Affaires Etrangères cherche à défendre une position forte qui soit à l’écoute des intérêts de tous et s’assure d’un bon respect des obligations internationales.
Pour cela, notre responsabilité est de travailler en proche coordination avec les autres ministères qui sont en charge de la mise en œuvre de nos décisions au niveau national et disposent de l’expertise technique. (Par exemple, un nouveau cadre mondial pour la biodiversité a été adopté récemment. Nous avons travaillé avec le ministère de l’écologie et celui des finances l’élaboration de la stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) qui traduit l’engagement de la France pour mettre en œuvre ce cadre).
Notre responsabilité se décline aussi au niveau international : nous avons conscience que tous les pays n’ont pas le même niveau de développement et qu’il ne serait pas juste de demander la même chose à tout le monde. Nous avons un rôle à jouer pour trouver des financements pour soutenir les pays en développement et travailler pour les aider à mettre en œuvre les décisions internationales.
C’est particulièrement visible sur les questions de climat pour lesquelles nous, les pays développés, avons émis beaucoup de gaz à effet de serre qui se sont cumulés dans l’atmosphère. On parle d’une responsabilité historique de certains états.
Pour autant, ces responsabilités évoluent aussi. Certains pays qui à la fin des années 1990 étaient considérés comme des pays en développement sont aujourd’hui des économies solides avec un rôle historique prépondérant dans les émissions. Aujourd’hui, chaque nouvelle émission nous rapproche d’un point de non-retour : tous les Etats ont donc leur responsabilité à tenir, dans une logique de bien commun et selon ses capacités. Nous devons aussi apporter un soutien à ces Etats dans leur transition énergétique, en ayant conscience que le modèle qui nous a permis de nous développer ne peut plus durer et qu’il doit évoluer. En ayant aussi à l’esprit que ce sont principalement les pays en développement les plus vulnérables qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise écologique. Nous avons donc une responsabilité à jouer pour faire travailler tous les états ensemble – les grands émergents, les pays en développement, les petits Etats insulaires en développement, les pays développés – dans une approche collaborative qui permette une meilleure répartition des responsabilités et évite de rentrer dans une opposition pays riches / pays pauvres.
Est-ce qu’il vous est arrivé de ne pas être en accord et en cohérence personnelle avec la position que vous deviez négocier et défendre ?
Je représente les intérêts de la France qui a une position établie par les autorités politiques. Ma responsabilité est de porter cette position même si je ne suis pas totalement en accord. En même temps, on attend aussi de moi que je sois force de proposition. Y compris s’il y a des désaccords, dans le cadre de la préparation interne en France, je peux pousser certaines idées et faire des propositions. C’est pour cela que c’est très important que les chrétiens s’engagent dans ces combats-là, parce que, je l’ai vu, nous pouvons avoir une grande force de proposition. D’ailleurs, l’encyclique Laudato Si de François a été fondamentale à cet égard : d’abord parce qu’elle a été très lue, y compris au sein de notre ministère, mais aussi à l’international. Ensuite, parce que l’Eglise a joué un rôle important dans la négociation finale de l’Accord de Paris sur le climat (traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015 et entré en vigueur en novembre 2016.)
Pour revenir à la question de la cohérence, il ne m’est pas arrivé d’avoir des désaccords profonds. Mais ma responsabilité reste vis-à-vis de l’Etat français de défendre sa position, ses intérêts.
Représenter les intérêts de la France n’est-ce pas un biais lorsqu’on participe à des négociations internationales qui ont pour but de servir l’intérêt de tous ?
Oui, certainement. Cela dit, je vois que la position de la France est très ambitieuse et vraiment tournée vers la recherche collaborative de solutions bonnes pour tous les acteurs.
Ce que je peux souligner aussi c’est le rôle particulier que la France, alors présidente, a joué dans les négociations qui ont précédé l’adoption de l’Accord de Paris, la présidence impliquant une position de neutralité. La France a joué un rôle moteur pour promouvoir son ambition d’un côté et prendre en compte l’intérêt et les positions de l’ensemble des Etats. Elle a pris à ce moment-là un rôle de leadership dans les négociations internationales qu’elle essaie de conserver car aujourd’hui sa voix est très écoutée et entendue. La France n’est pas seulement dans une logique de servir ses intérêts particuliers. Elle bénéficie d’un vaste réseau diplomatique partout dans le monde qui lui permet d’avoir des échos du « terrain » et de pouvoir défendre des positions ajustées car prenant en compte les réalités de chacun des pays.
Personnellement, ayant souvent eu des rôles de facilitatrice dans les négociations, c’est-à-dire que je préside les négociations, j’ai vu l’importance d’écouter tous les partenaires pour comprendre leurs positions. Si on veut parvenir à un accord, c’est absolument essentiel d’avancer ensemble. A contrario, quand la France – ou un pays – ne réussit pas à emmener les autres Etats avec eux, c’est généralement l’échec ou le risque d’avoir une portée limitée.
On entend beaucoup aujourd’hui cette petite musique selon laquelle les décisions prises pour lutter contre la crise climatique et environnementale sont très loin d’être à la hauteur des enjeux. N’est-ce pas décourageant parfois ?
Parfois, je peux être tentée de me dire que l’on n’avance pas assez vite. C’est vrai. Mais, depuis 10 ans que je travaille dans ce domaine, j’ai vu des accords internationaux aboutir, dont on disait qu’on n’y arriverait pas : la convention de Minamata sur le mercure, qui a un impact particulièrement négatif sur la santé et l’environnement ; l’accord de Paris sur le climat ; j’ai participé à la négociation de l’amendement Kigali au protocole de Montréal, qui va permettre d’éviter une augmentation de 0,5 degrés des températures. Rien que dans les deux dernières années, nous avons adopté un nouveau cadre pour la biodiversité avec un objectif de protéger 30% des terres et 30% des mers et un traité pour protéger la haute mer… Autant de raisons pour moi d’espérer.
En 2022, au début de la guerre en Ukraine, à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, nous avons pu, contre toute attente et dans un climat ultra-tendu, lancer des négociations pour adopter un traité visant à mettre fin à la pollution plastique. Négociations qui se poursuivent aujourd’hui. Nouvelle raison d’espérer.
Ce qui est sûr, c’est que si nous n’avions pas signé tous ces traités, la situation climatique et environnementale serait 1000 fois pire. Quand j’étais enfant, le grand problème environnemental dont on parlait était le trou de la couche d’ozone. Aujourd’hui, grâce au protocole de Montréal, qui a interdit les produits chimiques qui entrainaient ce phénomène et qui par ailleurs étaient de forts gaz à effet de serre, ce problème a pu être résolu. Plus récemment, je pourrais citer aussi la COP 28 – très critiquée car elle était accueillie à Dubaï dans un pays pétrolier – dont on pouvait se demander à quoi elle allait pouvoir aboutir : il a été reconnu pour la première fois en 28 ans dans une COP qu’il fallait sortir progressivement des énergies fossiles. Cela reste à mettre en œuvre mais c’était une vraie avancée.
Je vois aussi de plus en plus d’Etats et de populations qui prennent conscience des enjeux parce qu’ils voient les impacts du changement climatique chez eux, la perte de la biodiversité et la pollution énorme. Je vois des pays en développement qui avancent, et surtout la société civile et la jeunesse dans de nombreux pays qui s’engagent. C’est pour moi une grande source d’espérance car ils exercent une grande responsabilité en poussant leurs gouvernements à aller plus loin.
Je choisis de me concentrer sur ce que je peux faire avancer pour ne pas entrer dans une spirale de désespérance qui pourrait non seulement me décourager à agir mais aussi être une excuse pour ne pas agir du tout.
Quel est le message principal que vous souhaitez adresser aux participants du Forum Zachée du 9 au 12 mai prochains ?
J’ai envie de leur dire qu’on a besoin de citoyens engagés. On peut légitimement se demander, si les actes et les gestes que nous posons individuellement vont réellement faire une différence. Je réponds oui, trois fois oui. Les gouvernements agissent, entre autres, lorsqu’ils sont poussés à agir par les populations qui les ont élus. Jouons ce rôle de porter haut des valeurs de protection de notre maison commune et de protection des plus vulnérables, qui sont les plus touchés par cette crise.
Agir et s’engager c’est d’abord s’interroger : sur quoi dois-je faire porter mon effort ? Quel équilibre dois-je trouver entre consommer responsable (alimentation, vêtements, énergie, transports…) et ne pas me refermer sur moi ? Il ne s’agit pas du jour au lendemain de ne consommer que du circuit-court et local, de devenir végan et de ne plus monter dans un avion. Mais avancer pas à pas, de manière réaliste en posant quand même ce choix auquel Laudato Si nous invite : le choix de la sobriété. Car il est clair que la technologie, aussi utile soit-elle, n’est pas la solution à tous nos maux. Il faut changer nos modes de consommation. Ne nous dérobons pas !