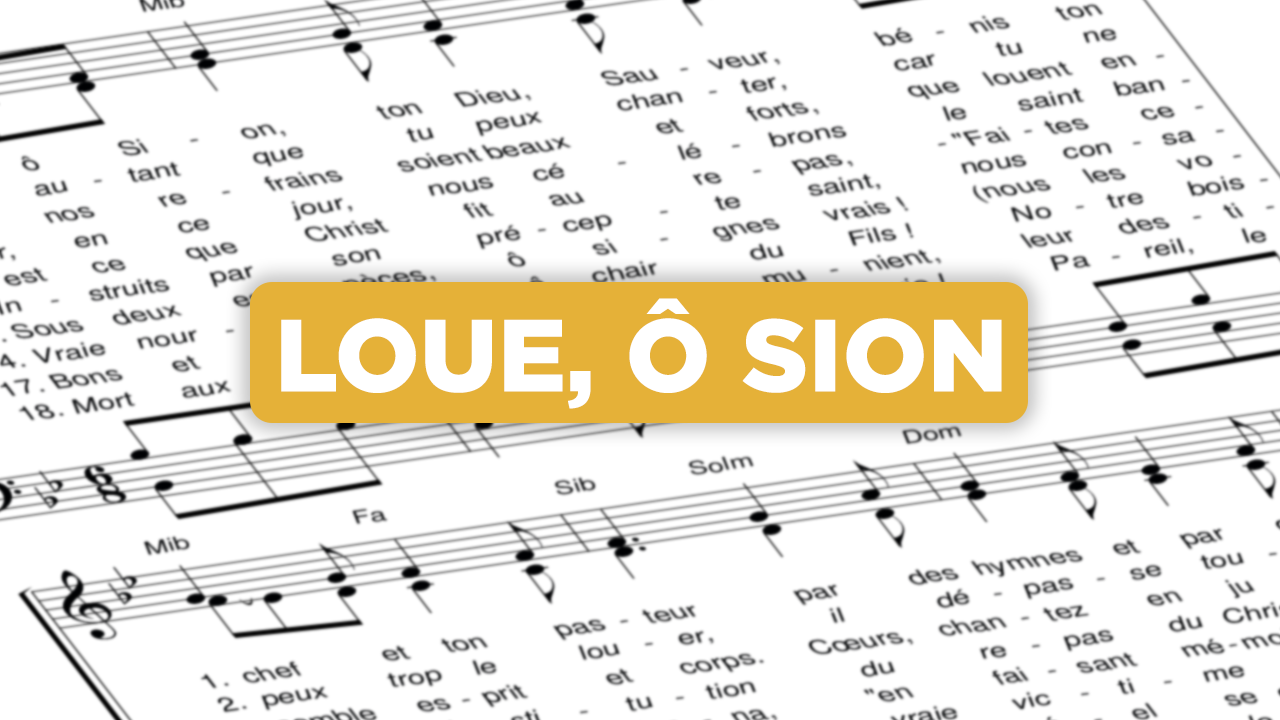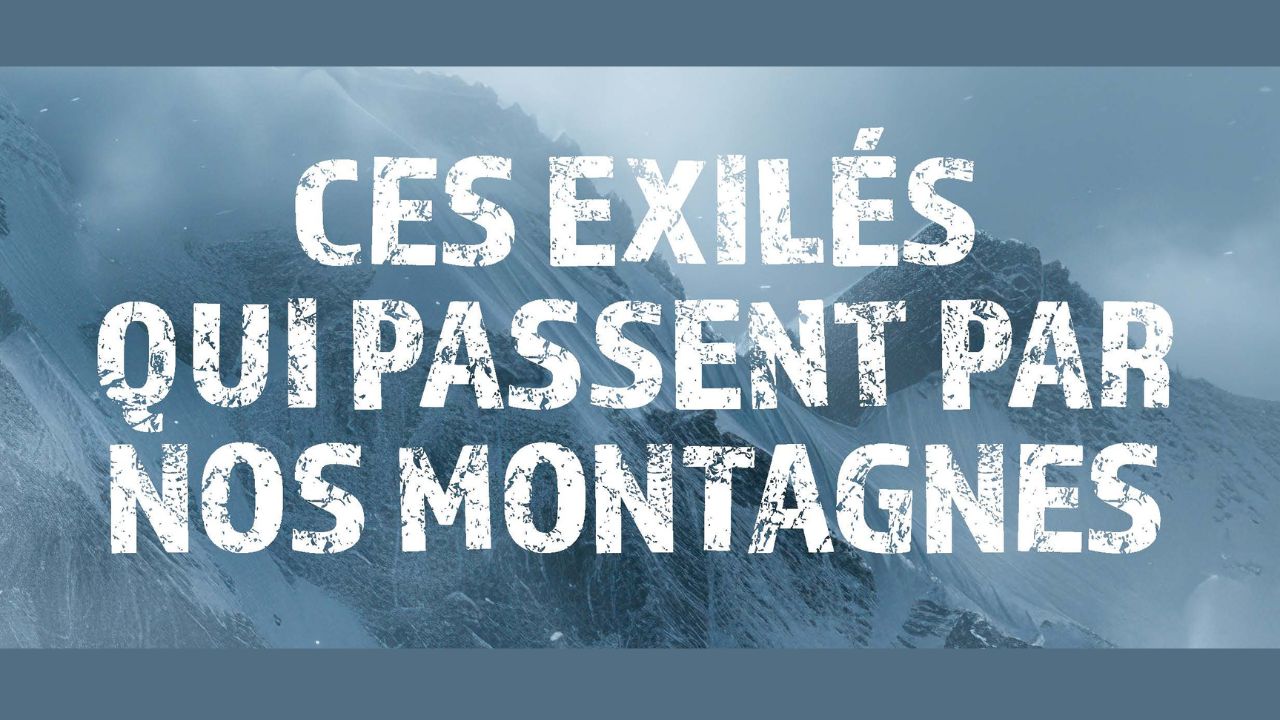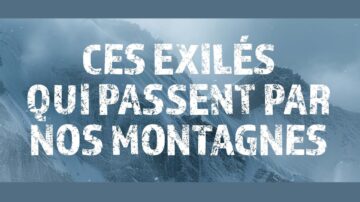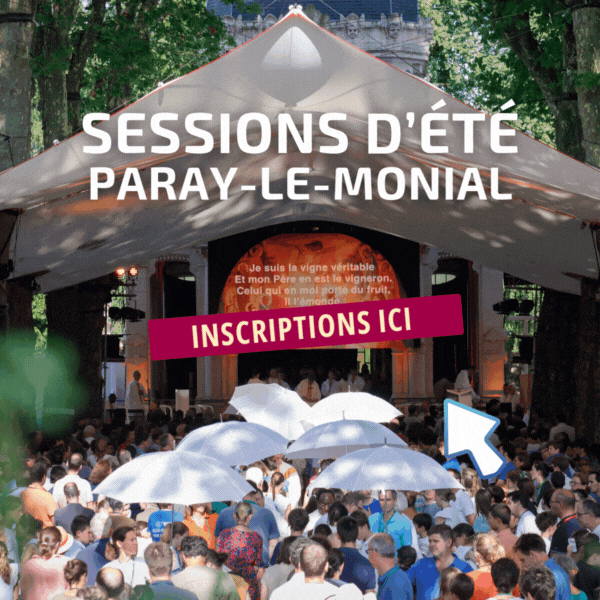Enseignants et éducateurs, nous sommes acteurs de la transmission et à ce titre, nous avons trois compétences à développer : d’une part, la connaissance de notre discipline, d’autre part, le savoir-faire pédagogique et didactique, et enfin la connaissance des destinataires de cette transmission. Savons-nous bien à qui nous sommes envoyés ? Il est bon que nous nous arrêtions un moment sur ces fameux destinataires ! C’est-à-dire sur ces nouvelles générations qui ont évolué de manière très rapide, au point que même des enseignants encore jeunes peuvent se trouver surpris par leurs réactions.

Eduquer, c’est conduire au-delà (e-ducere). Mais encore faut-il les prendre là où ils sont, et donc savoir où ils en sont, et les prendre tels qu’ils sont, sans mépris mais avec lucidité et surtout avec bienveillance et exigence.
Actuellement, ceux qui sont dans les écoles, collèges et lycées représentent ce que l’on appelle la génération Z. Ils ont été précédés par la génération Y (1979-1994), précédée elle-même par la génération X (1964-78), précédée par la génération des baby-boomers (1945-1963), précédée par la génération silencieuse (1901-1944). On peut discuter de cette classification, en tous cas elle peut nous aider à réfléchir. Elle est présentée par le Magazine du Développement Commercial de Drummondville dans un article de Carol Allain sur Le Choc des cultures : les modèles de stratification de la clientèle sont toujours utiles aux stratèges commerciaux qui cherchent à séduire, à capter une clientèle. Nous, les enseignants et éducateurs, nous sommes peu faits à ce type d’approche, parce que nous raisonnons davantage en termes de service pédagogique et non en termes de séduction-captation en vue du profit. Mais du coup, c’est là aussi notre faiblesse car nous sommes souvent déstabilisés par la nouveauté des populations qui débarquent dans nos établissements. Pourtant, apprendre à mieux connaître leurs caractéristiques répond à l’une de nos trois compétences fondamentales.
Si nous nous efforçons de mieux comprendre ce qui caractérise les générations actuelles, nous percevrons mieux quelles attentes peuvent être prises en compte, et contre quels travers nous pouvons lutter. Voyons ce qui pose des difficultés au regard de nos exigences de transmission dans le cadre des études scolaires, puis nous verrons ce qui est plus positif.
Avant de savoir lire, les générations contemporaines, depuis plus d’un demi-siècle (ce qui représente plusieurs générations) passent plusieurs heures par jour devant les écrans, devant l’espace virtuel qui est fermé sur lui-même, autoréférentiel puisqu’il est son propre créateur. Le monde virtuel leur est plus familier que le monde réel. Les membres de la génération Z, aussi appelés les “digital natives”, sont connectés en permanence. Leur smartphone fait partie intégrante de leur vie, personnelle et aussi scolaire. Contrairement aux générations X et Y, plutôt orientées sur l’e-mail, les digital natives de la génération Z privilégient les échanges via les chat et les messageries instantanées. De ce fait, ils sont impatients et zappeurs. D’ores et déjà, 78 % des 18-20 ans renoncent à postuler à un emploi dans une entre prise après avoir visité le site web quand la candidature en ligne leur semble trop complexe. Ces nouveaux jeunes en recherche d’emploi ne passent plus des heures à concevoir CV et lettres de motivation. Les employeurs en tiennent compte et sont en train de faire évoluer leur processus de recrutement. Pour nous qui ne sommes pas employeurs mais enseignants, nous devons tenir compte de cette pente effroyablement glissante et leur apprendre à prendre le temps de la lecture, de la réflexion.
A cela s’ajoute que, dès l’école primaire, les jeunes sont touchés par le phénomène de masse qu’est la pornographie. Il a pour effet un jugement faussé sur la vie affective et sexuelle, tant chez les enfants et les jeunes, que chez les adultes, mais aussi une perception faussée de nombre d’œuvres d’art relatives au corps, et singulièrement au nu, ou des textes relatifs au sentiment amoureux. Quel enseignant, prenant conscience de cela, n’en tiendrait pas compte dans son approche pédagogique ?
Ce qui les habite est une conscience aigüe des périls écologiques, créant chez un bon nombre d’entre eux une véritable éco-anxiété, justifiée ou non. Ce fond d’anxiété touche leur perception de l’avenir tant personnel que collectif et conforte leur crainte des engagements de fidélité. Cela conforte aussi leur recherche de la santé, du véganisme, des médecines douces et des professions qui y font écho. Dès lors, ils sont méfiants des règles et contraintes liées au monde des adultes qu’ils jugent responsable du dérèglement « de la planète ». Ceci accentue leur refus de l’autorité et des institutions, qui est d’ailleurs une tendance lourde de note culture depuis Jean-Jacques Rousseau. A cet égard, il est vrai que l’on peut avoir un ensemble d’individus ingouvernables ! Il est clair que ceci complique quelque peu notre tâche !
A côté de ces héritiers d’une culture occidentale de la transgression et de la rupture des traditions, il y a aussi, pour compliquer les choses, un nombre de plus en plus grand de jeunes issus de l’immigration qui peuvent se vouloir au contraire héritiers d’autres institutions et d’un ordre sacré, celui de la religion et des traditions de leurs pères, avec ses rites et ses interdits à l’opposé de ce qui se vit dans un occident de plus en plus privé du respect d’une quelconque autorité religieuse. Quelles que soient nos opinions personnelles, le fait est que dans les classes sont vécues des valeurs contradictoires, ce qui est éminemment explosif. Et ceci, d’autant plus que les adolescents sont à l’âge de la recherche des émotions, spécialement des émotions collectives et que les médias de l’immédiat exploitent ce filon à des fins de profit mercantile et de propagande idéologique et politique.

Telles sont donc les difficultés de notre métier, puisque c’est bien à ces jeunes que nous sommes envoyés.
Cependant, il existe un certain paradoxe chez la génération Z : même si elle est ultra-connectée, elle cherche également à se recentrer sur les fondamentaux : l’humain, l’esprit d’équipe et la co-création. Ils peuvent se révéler sensibles à d’autres compétences que celles de la réussite scolaire traditionnelle, ce sont les compétences « douces », les soft skills : des qualités humaines, émotionnelles, relationnelles et comportementales. Comme plusieurs entreprises qui ont changé les codes, ne pourrait-on pas leur proposer de vivre des expériences insolites pendant le temps de leur scolarité, via la mise en place de jeux de simulation réalistes, inspirés des escape games ?
Rendons-nous compte que lorsqu’ils arriveront sur le marché de l’emploi, les jeunes de la génération Z préfèreront flexibilité, réseau, innovation et équilibre de vie pro et perso plutôt que salaire, diplôme et évolution verticale dans une même entreprise !
Rendons-nous compte qu’ils ont d’ores et déjà un imaginaire nourri d’une vision internationale : leurs frères et sœurs aînés, leurs amis vont au-delà des frontières. Leur rêve est souvent de voyager et travailler à l’étranger. C’est une clé d’attraction pour eux ! Pour les rejoindre, l’école ne doit-elle pas adopter elle aussi une vision globale et une culture d’établissement ouverte sur le monde ?
Enfin, cette génération est plus que jamais en quête de sens : la carrière d’un bon nombre d’entre eux sera avant tout synonyme d’une générosité dans le don de soi où ils trouveront leur épanouissement personnel. Plus nous saurons leur proposer de l’audace dans le don de soi, plus ils témoigneront d’enthousiasme ! Les valeurs de travail, de responsabilité, de sacrifice reviendront alors, non pas sous la pression d’une morale culpabilisante mais tout simplement par la passion de la vie tournée vers les autres.
En tant que professionnels de l’enseignement et de l’éducation, nous choisissons notre discipline et, autant que nous le pouvons, le niveau de classe qui correspond à notre compétence. En revanche, en tant que chrétiens, si le choix des personnes vers lesquelles nous sommes envoyés nous appartenait, nous ne serions pas envoyés. Pour être envoyés, c’est-à-dire apôtres puisque c’est la signification du mot grec apostolos, ne faut-il pas que ces jeunes, nous les recevions du Christ, tels qu’ils sont et non tels que nous rêverions qu’ils soient ?
Bernard de Castéra