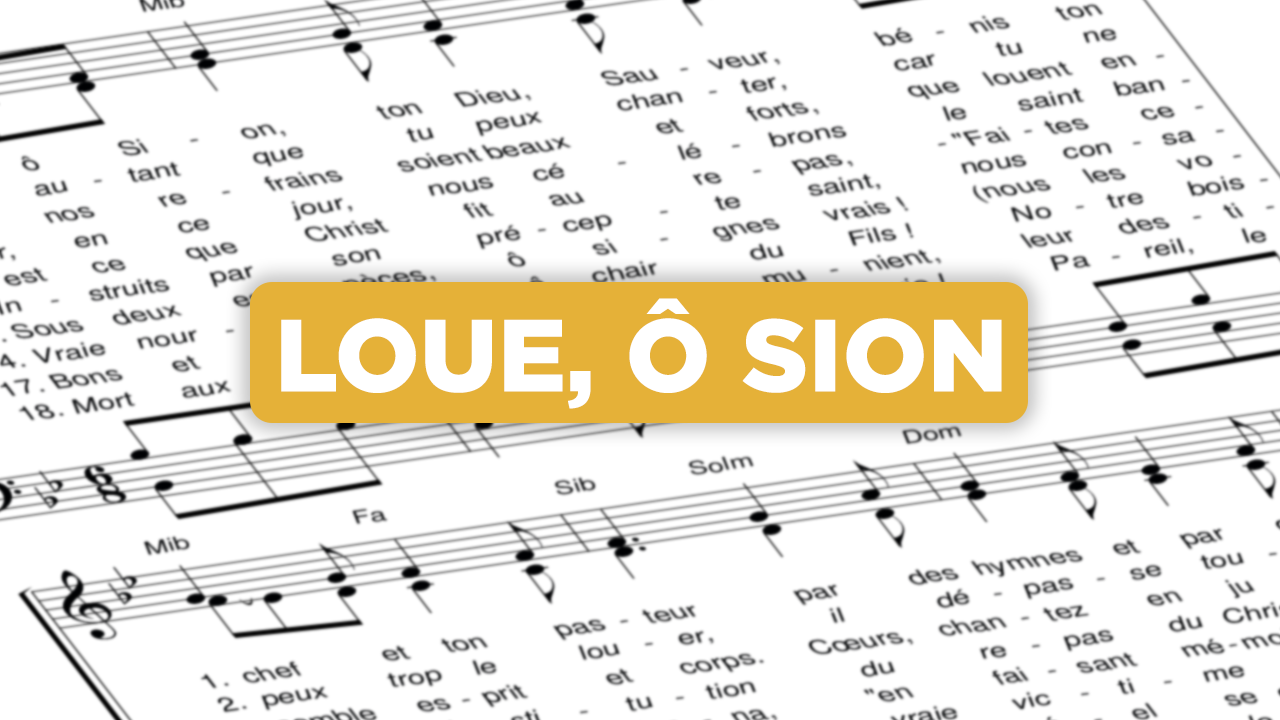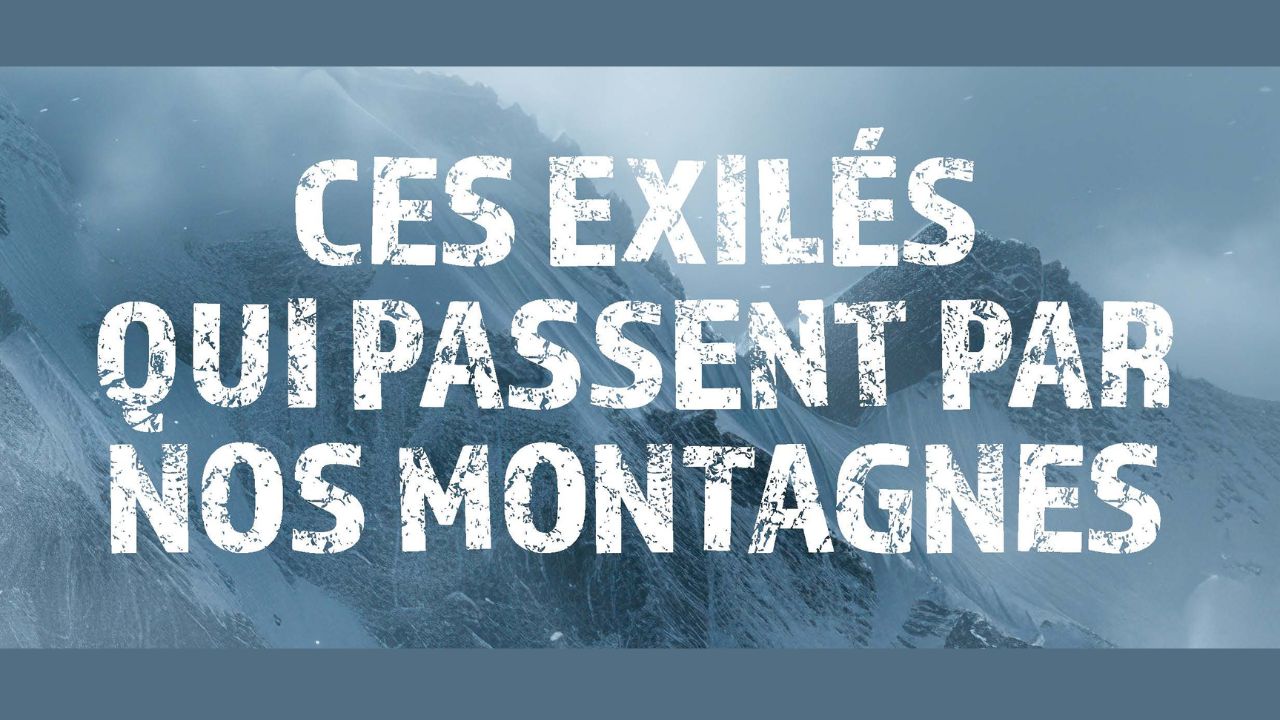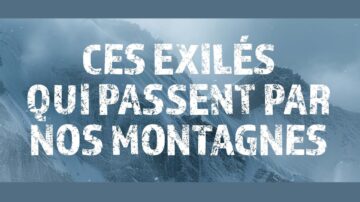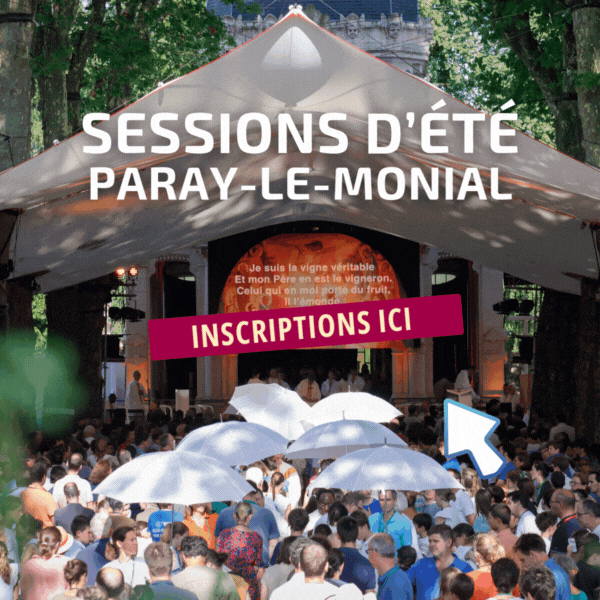Dix ans après l’élection du pape François, cinq notes caractéristiques de son pontificat peuvent être mises en évidence.
Père Yves Guerpillon
Un pontificat marqué par la joie de la miséricorde
Même si le pontife argentin est un homme austère dont la personnalité est complexe voire paradoxale, il a reçu son appel au sacerdoce en expérimentant la joie de la miséricorde un peu avant ses 17 ans[1]. C’est d’ailleurs de celle-ci qu’il tire sa devise épiscopale : miserando atque eligendo qu’on pourrait traduire par « Élu, parce que bénéficiaire de la miséricorde ». Autre indice, l’essentiel du 3ème chapitre de son exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur « l’appel à la sainteté dans le monde actuel » est un commentaire des Béatitudes.
- FRANÇOIS LE JOYEUX DISCIPLE DE JÉSUS
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus…avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours » EG 1. Dès les premiers mots de son texte programmatique, l’exhortation apostolique La Joie de l’Évangile parue le 24 novembre 2013, François annonce la couleur de la joie ! Pour s’en convaincre il suffit de lire les titres des documents magistériels du pape argentin : Evangelii gaudium (2013), Laudato si (2015), Amoris laetitia (2016), Gaudete et exsultate (2018)…
Cette présence de la joie n’est pas forcément innée chez François mais plutôt le fruit d’une grâce spirituelle, notamment depuis qu’il est Évêque de Rome[2]. Dans son homélie du 28 mai 2018, il disait de la joie qu’elle « est le souffle, la manière de s’exprimer du chrétien ». Pour François, la joie chrétienne est « la paix du cœur, que seul Dieu peut nous donner » car ce qui provoque « la joie dans le cœur est l’Esprit Saint ». Cette note joyeuse semble être le fil rouge de tout son pontificat.
- FRANÇOIS LE DISCIPLE-MISSIONNAIRE ZÈLÉ
Dans la « Joie de l’Évangile », François caractérise la vie de disciple par l’engagement missionnaire. Reprenant ce qu’avait déjà dit Paul VI dans l’exhortation Evangelii nuntiandi, François affirme à nouveau que l’Église n’existe que pour évangéliser. L’Église a vocation à être en sortie et non pas « autoréférencée ». Le but est d’« avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont » EG 25. Pour François, l’enjeu est triple.
Il y a d’abord la formation de disciples-missionnaires. « Tout chrétien est missionnaire s’il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ » EG 120. Par la rencontre personnelle avec l’amour de Dieu et l’expérience de « la joie du salut » donnée par le Christ « nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-référence » EG8.
Cette formation personnelle va de pair avec la conversion missionnaire des paroisses afin qu’elles soient plus proches des gens et plus fraternelles. L’enjeu est une « constante sortie vers les périphéries de son propre territoire … pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » EG49 et « abandonner le confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait comme çà’ pour être audacieux et créatif » (cf EG 28-33).
Enfin, l’Église doit s’ouvrir à un esprit synodal. Comme dit Saint Jean Chrysostome, « Église et Synode sont synonymes ». Et François poursuit en affirmant « que l’Église n’est autre que le ‘marcher ensemble’ du troupeau de Dieu sur les sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur »[3]. La démarche synodale est un processus pour l’Église du 3ème millénaire qui unit intimement « communion, participation et mission ». L’enjeu est une écoute mutuelle du peuple de Dieu ordonnée à une écoute commune de l’Esprit Saint.
- FRANÇOIS L’AMI DE ST FRANÇOIS D’ASSISE
Si le pape François a pris le nom du Poverello comme « guide et inspirateur », il reconnait en lui « l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité » LS 10. Pour le pape argentin, François d’Assise nous aide à contempler la nature « comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté ». Ainsi « le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange » LS12. L’Évêque de Rome évoque lui-même « l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète » LS 16. L’enjeu est de ne jamais oublier les pauvres qui sont les destinataires privilégiés de l’Évangile et « ont une place de choix dans le cœur de Dieu au point que lui-même « s’est fait pauvre » 2Co 8,9 » EG 197. Le pape François souhaite « une Église pauvre pour les pauvres » où ils sont au centre du cheminement de l’Église car « ils ont beaucoup à nous enseigner » EG 198. Reprenant les mots de Paul VI, François considère que « la piété populaire traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître » EG 123.
- FRANÇOIS LE PÈRE SPIRITUEL
François est aussi un accompagnateur jésuite pétri des Exercices spirituels de st Ignace de Loyola. Désireux d’une pastorale proche des personnes, le saint Père encourage « l’art de l’accompagnement » pour « donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité avec un regard respectueux et plein de compassion qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne » EG 169. Cette approche permet d’incarner l’option préférentielle pour la miséricorde si importante notamment dans l’accompagnement des situations familiales ou conjugales complexes. Dans ces dernières, le processus vise à écouter, accompagner, discerner et intégrer. Le pape François cherche à accompagner le « saint peuple fidèle de Dieu » sur le chemin de la sainteté effective. L’exhortation Gaudete et exsultate reprend ce souci pastoral de la sainteté pour tous : « ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf 1Co 12,7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui » GE 11. Le saint Père rappelle que ce chemin de sainteté, s’il est pleinement personnel, n’est jamais isolé car « personne n’est sauvé seul » GE 6.
- FRANÇOIS LE DIPLOMATE DE LA FRATERNITÉ
Depuis le début de son pontificat, l’action diplomatique de François est d’une « grande richesse » notamment sur « l’orthodoxie, l’Europe, la Chine, Cuba, l’islam » [4]. Pour le pape François, l’horizon du politique est l’amitié sociale et la fraternité universelle « sans jamais nous lasser de choisir la fraternité » EG 91. En effet, il rappelle que « dans le Christ, Dieu ne rachète pas seulement l’individu mais aussi les relations sociales entre les hommes » EG 178.
Dans sa dernière encyclique, Fratelli tutti (2020), François se fait l’apôtre de la culture du dialogue et de la rencontre en s’appuyant sur une longue méditation de la parabole du bon Samaritain (cf FT 56-86). Pour le pape argentin, cette culture s’enracine dans un territoire et un peuple concret car il n’y a « pas pire aliénation que de ne pas avoir de racines » FT 53. Ainsi, François veut articuler harmonieusement identité et fraternité en cultivant « une saine relation entre amour de la patrie et intégration cordiale dans le monde » FT 149.
Un authentique chemin vers la paix[5]
Au terme de cette ébauche pour caractériser le pontificat de François, il me semble pertinent de reprendre les 4 principes qu’il énonçait dans Evangelii gaudium (cf EG 2 21-237).
Fruits de sa fréquentation du théologien Romano Guardini, ces 4 « tensions bipolaires propres à toute réalité sociale » résument la manière de faire du pontife argentin.
• le temps est supérieur à l’espace : François ne cesse de générer des processus plus que viser des résultats immédiats (cf réforme de la curie, démarche synodale, transformation missionnaire des structures…).
• l’unité prévaut sur le conflit : pour François, le conflit ne doit pas être craint mais assumé : il faut « accepter de le supporter, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus» EG 227
• la réalité est plus importante que l’idée : François se méfie des idéologies et des théories déconnectées du réel et préfère les solutions éprouvées au contact des personnes.
• le tout est supérieur à la partie : ce principe dépend du critère de totalité inhérent à l’Évangile qui a vocation à guérir toutes les dimensions de l’homme et réunir tous les hommes à la table du Royaume (cf EG 237).
[1] Cf A. IVEREIGH ,« François le Réformateur. De Buenos Aires à Rome », Emmanuel, 2017, p.54
[2] Ibid., p.464
[3] Discours pour le 50ème anniversaire du synode des Évêques, 17 octobre 2015.
[4] Jean-Baptiste NOÉ, François le diplomate. La diplomatie de la miséricorde, Salvator, 2019, p.15
[5] EG 221