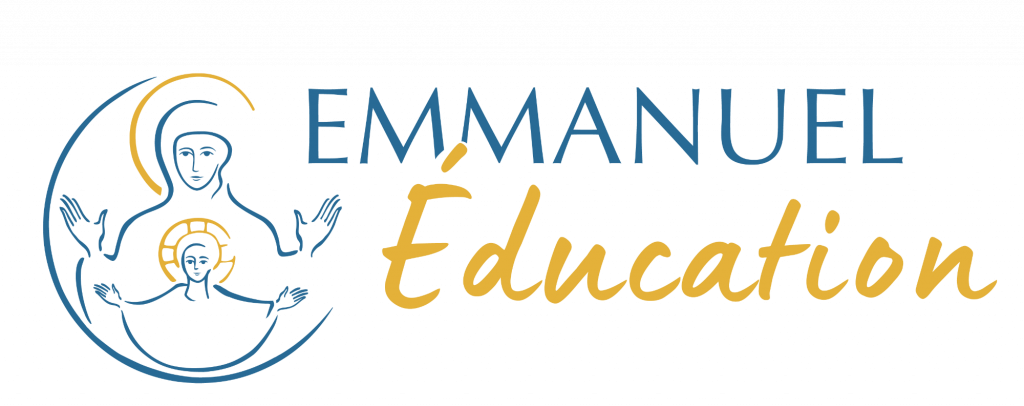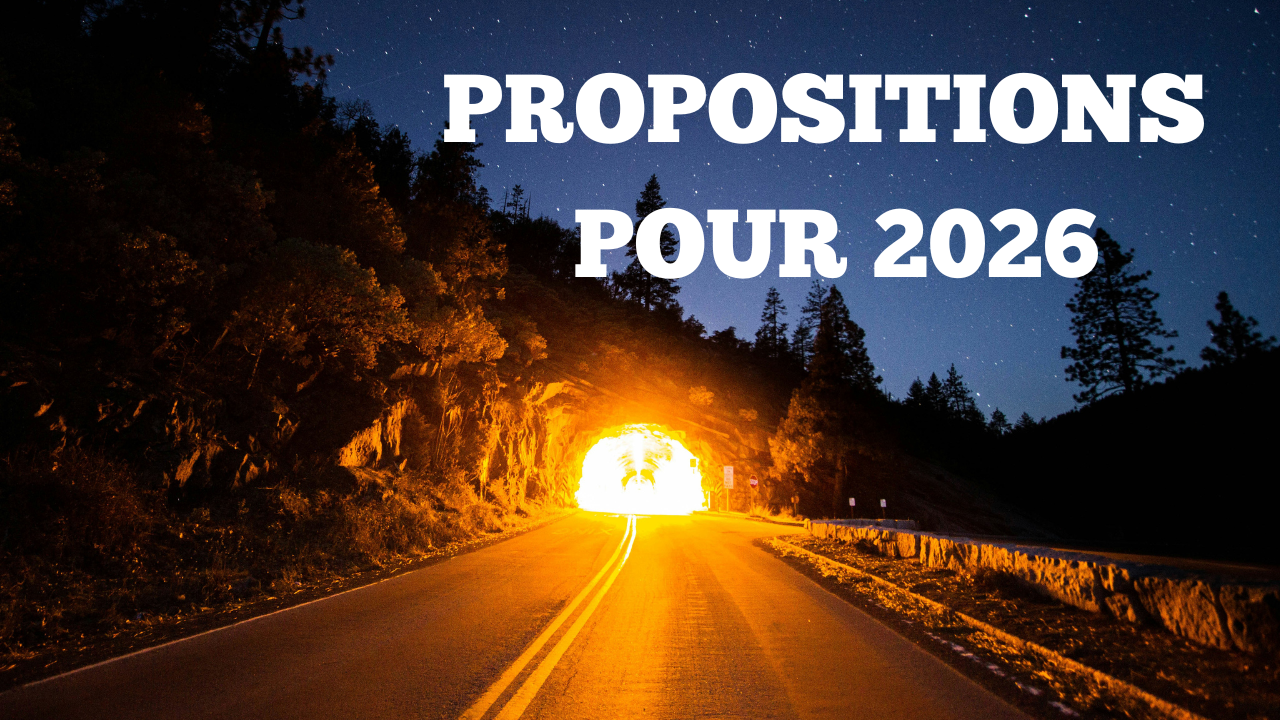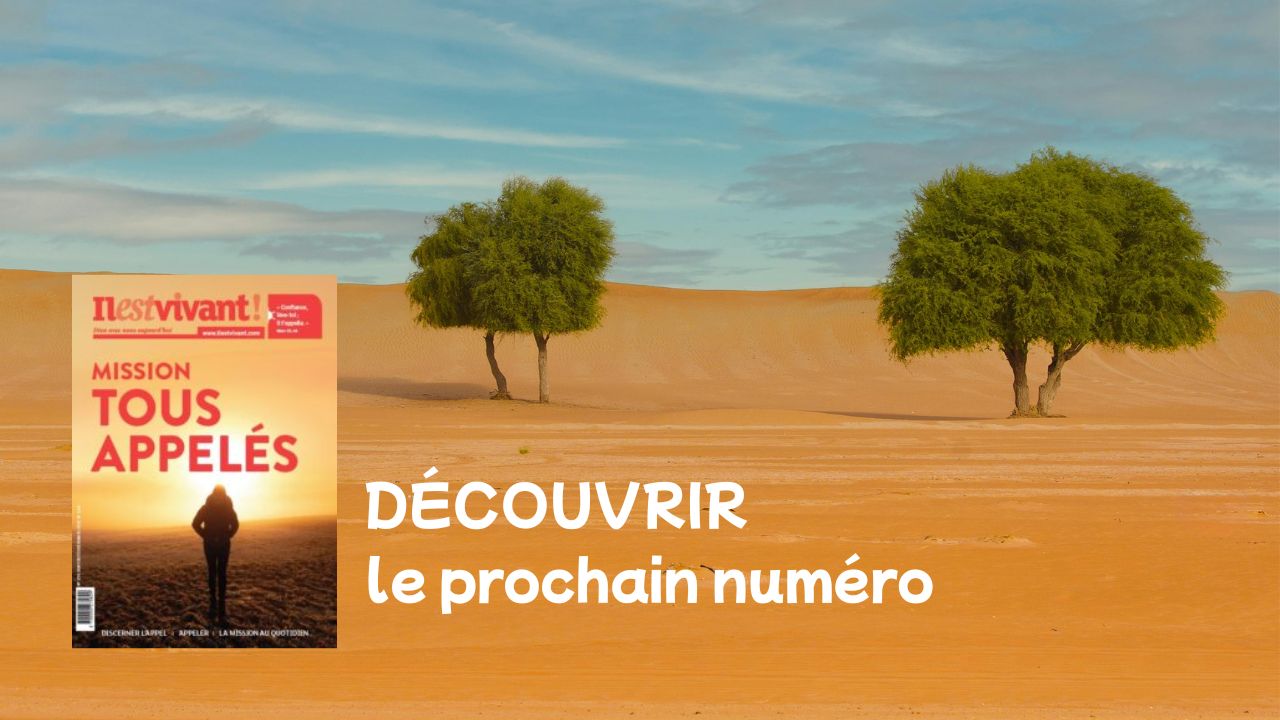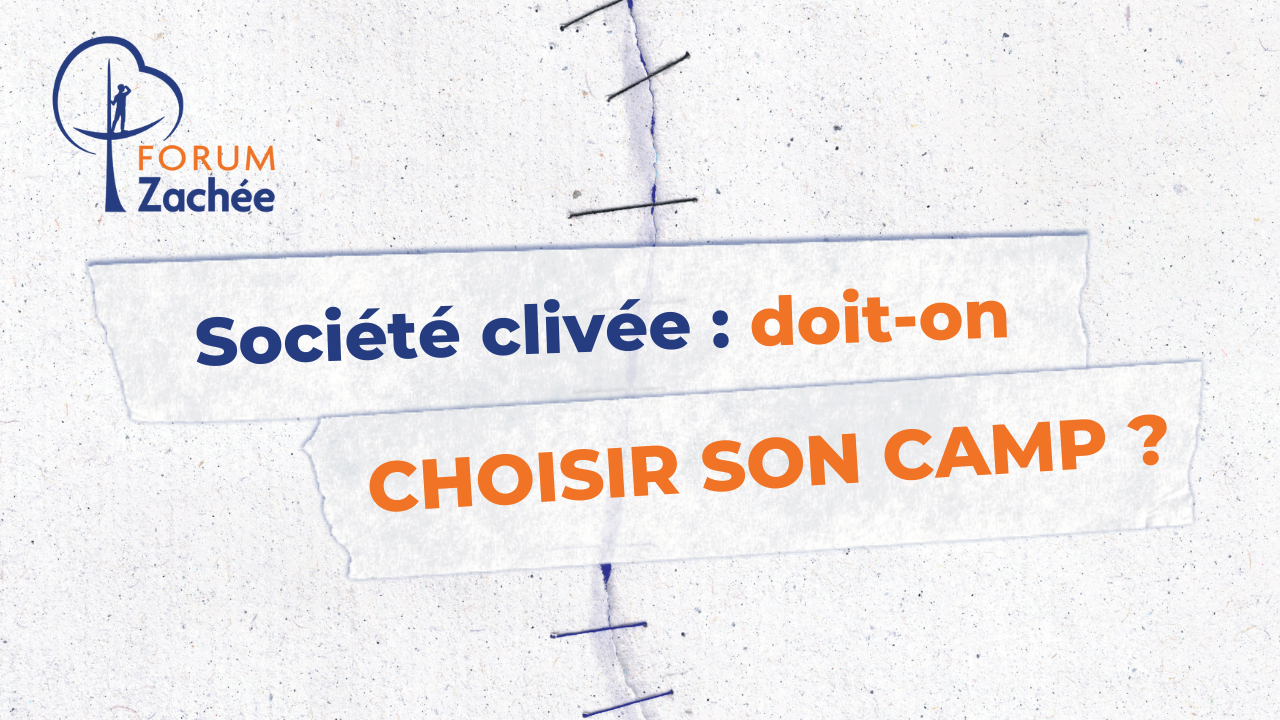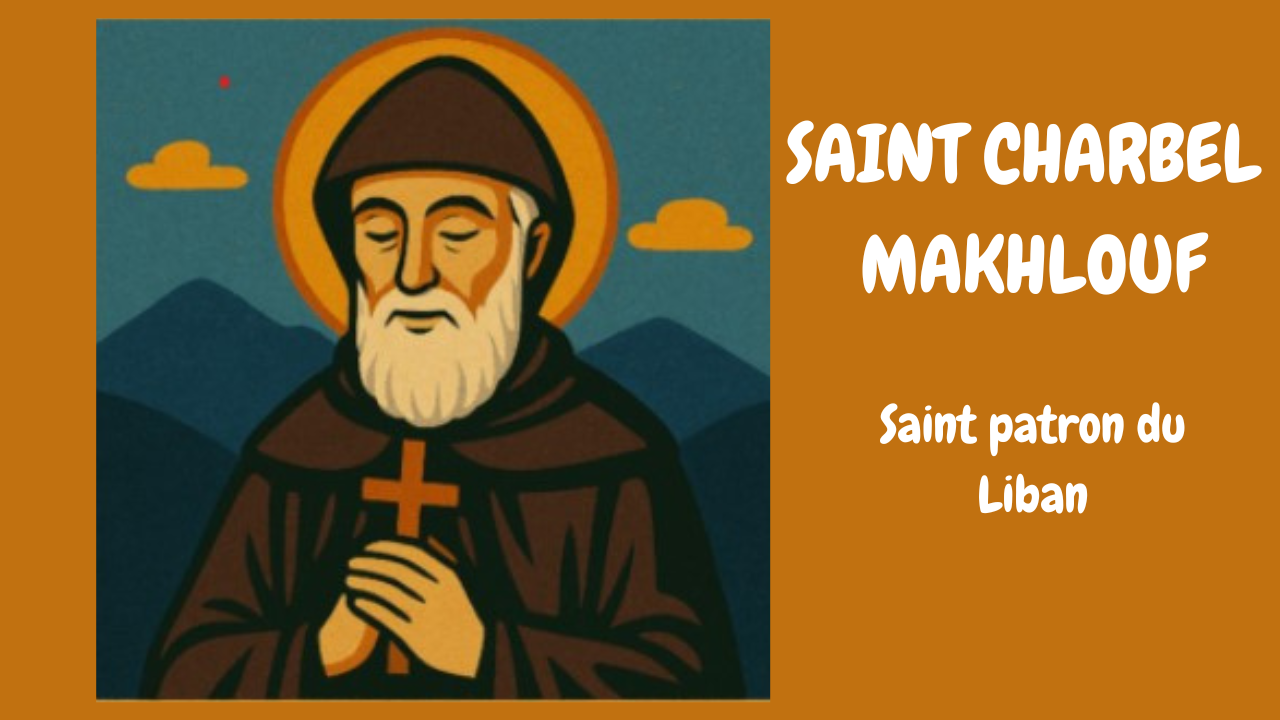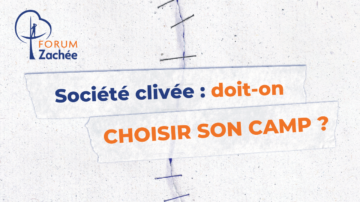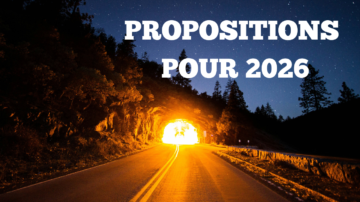Xavier Dufour enseigne les mathématiques, la philosophie et la culture religieuse chez les Maristes à Lyon.
Il anime des sessions d’été de professeurs et vient de publier Enseignant et chrétien, une vocation, un livre qui s’adresse à tous les professeurs soucieux d’unifier leur foi et leur pratique professionnelle.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Dans le prolongement de mes engagements, chez les Maristes de Lyon et dans la Communion des Educateurs chrétiens (communioneduc@free.fr), j’ai voulu rassembler mon expérience pour encourager de nouvelles vocations d’enseignants chrétiens. Mon livre offre les principaux repères anthropologiques et spirituels pour éclairer cette mission, à travers les enjeux de l’éducation, la relation d’autorité, le souci pédagogique, le sens spirituel des études, la culture religieuse, la vertu d’espérance…ainsi que les situations particulières du chrétien dans le public et dans le privé confessionnel.
Comment le professeur peut-il unifier vie chrétienne et devoir professionnel ?
Avant tout, en réalisant l’immense dignité de son métier, qui consiste selon Edith Stein en une « participation à l’œuvre de création ». Il s’agit d’acheminer chaque élève au seuil de sa vie intérieure, ce lieu source à partir duquel il pourra grandir en liberté, trouver le sens de sa vie et peut-être rencontrer Dieu. Pour cela, il s’agit de nouer en un seul engagement les trois modalités de cette mission : enseigner, éduquer, évangéliser. Cette interpénétration n’est possible que si elle est vécue par le professeur lui-même, dans l’unité de sa vie intellectuelle, morale et spirituelle. Enseigner, c’est avant tout travailler sur soi-même, vivre des conversions à tous les niveaux de sa personne !
Ainsi, c’est en enseignant que le professeur éduque. Toute discipline, par ses apprentissages, ses exigences, sa méthode, contribue à forger la volonté. Cette formation morale est d’autant plus féconde qu’elle est portée par l’exemple même du maître, dans une juste relation d’autorité, exigeante et bienveillante. L’enseignant chrétien, lui, voit en chaque élève une créature unique et aimée de Dieu et cela renouvelle sans cesse son regard éducatif.
C’est aussi par son enseignement que le professeur peut ouvrir l’élève au questionnement spirituel. Enseigner, c’est faire signe, c’est révéler que le monde a un sens, un ordre et que – pour le chrétien – cet ordre est bon. Chaque discipline porte d’une manière ou d’une autre une interrogation sur l’homme et sa destinée. Un enseignement de lettres qui se contenterait d’inventorier des figures de style ne serait que desséchant. Sa finalité n’est-elle pas de nous ouvrir aux grands auteurs qui éclairent notre humanité ? De même, l’enseignement des sciences procède d’un émerveillement devant une nature pétrie d’intelligibilité et face à l’esprit humain capable d’en déchiffrer les secrets. Ainsi, chaque matière doit creuser le désir de vérité et préparer un questionnement plus haut sur le sens de la création, de l’homme, de l’histoire…même dans un contexte laïc.
Ceci ne suppose-t-il pas que le professeur soit formé ?
Mieux que cela, qu’il se forme sans cesse, car comment serait-il un éveilleur s’il ne goûte pas pour lui à la vie de l’esprit ? Il est crucial que les enseignants chrétiens se cultivent, dans leur domaine propre, mais aussi dans les rapports entre foi et culture. Cela commence par une nécessaire formation biblique, puisque la Bible porte la mémoire de nos racines culturelles et spirituelles. Dans les sessions que j’anime chaque été, nous proposons une initiation à la Bible qui est très appréciée car elle stimule à la fois notre vie chrétienne et notre regard éducatif.
Ma conviction, c’est que si les enseignants chrétiens étaient plus cultivés, plus à l’aise dans les débats avec une culture contemporaine immunisée contre le christianisme, ils pénétreraient cette culture et exerceraient une influence libératrice sur bien des élèves et des collègues. Par ricochet, ils seraient une ressource pour la formation dans les paroisses et les mouvements, qui en ont tant besoin ! Comment affronter l’incroyance des milieux cultivés, si l’on ne sait à peu près rien de la littérature biblique, des grands axes du Credo, de l’histoire de l’Eglise ou de l’anthropologie chrétienne ?
Pourquoi parlez-vous pour l’enseignant chrétien de vocation à une sainteté ordinaire ?
Nous imaginons l’appel à la sainteté loin de notre quotidien, a fortiori de notre engagement professionnel. Or, le professeur chrétien à la chance de pouvoir incarner cette vocation à la sainteté dans l’ordinaire des conditions de son métier, dans les actes minuscules où tout se joue : la ponctualité en classe, la justice d’une appréciation, la bienveillance d’un conseil… Mais cette incarnation a un prix. Elle suppose :
– d’habiter un lieu particulier : et pour cela y passer du temps, écouter ses élèves et ses collègues, être force de propositions, etc. Cela demande de surmonter une mentalité d’exécutant trop fréquente chez les enseignants.
– de s’inscrire dans une durée : ce qui se joue dans l’enseignement ne relève pas de l’immédiateté ou du spectaculaire. Il faut tenir bon, s’enraciner dans l’espérance, car l’éducation relève des germinations lentes, de la fécondité et non de l’efficacité. Je crois aussi peu aux « méthodes pédagogiques » qu’aux « méthodes d’évangélisation », car celles-ci et celles-là ne valent que par les acteurs qui les incarnent et les réinventent sans cesse.
– d’accepter d’enseigner avec ce que nous sommes, notre personnalité, nos ressources et nos limites : la relation éducative nous renvoie sans cesse à nous-mêmes, notre équilibre intérieur, notre capacité d’espérance, notre faculté à transmettre et à aimer nos élèves. Cela reste donc toujours un combat et un appel à la conversion !
Beaucoup de jeunes chrétiens ont une mauvaise image de l’Education nationale et parfois des écoles catholiques sous-contrat. Ils craignent de n’y pouvoir enseigner avec assez de liberté. Que leur répondre ?
Les contraintes et les croix ne manquent pas. Pourtant, la vraie liberté naît de la vie intérieure. Un adulte cohérent et enthousiaste peut être un éveilleur pour sa classe, quel que soit le contexte. Le professeur a une véritable liberté s’il veut bien l’assumer. Et c’est parfois dans les lycées publics les plus difficiles que s’expriment les plus belles audaces. Quant aux écoles catholiques, il est vain d’en déplorer le peu d’ardeur missionnaire : il faut retrousser ses manches et monter au front. Les jeunes enseignants chrétiens y sont clairement attendus ! Puissent-ils passer d’une attitude critique facile, à ce véritable engagement qui suppose de payer de son temps et de sa personne.
Nos élèves n’attendent qu’une chose : rencontrer des adultes attentionnés qui les prennent au sérieux et leur ouvre une véritable espérance. La culture qui s’impose à eux est foncièrement nihiliste, hédoniste en surface, désespérée en profondeur. Il s’agit de réintroduire dans cette culture l’inquiétude du sens, l’affrontement aux grandes questions de l’humanité : peut-on aimer ? quel est le but de la vie ? pourquoi le mal ? Nous, chrétiens, nous savons que l’homme est fait pour la vie en plénitude. Implicitement ou explicitement, à travers les enseignements disciplinaires comme dans tous les actes de notre métier, c’est de cette espérance que nous sommes appelés à témoigner au quotidien !